En raison d’une opération de gestion, il n’y aura exceptionnellement
pas d’ouverture anticipée ce vendredi 28 novembre.
Ouverture des portes de la Réserve à 10h.
👉 calendrier des ouvertures anticipées
Merci à tous pour votre compréhension.

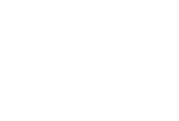
La Réserve Ornithologique du Teich est un espace naturel préservé, aménagé pour accueillir les oiseaux sauvages et favoriser leur observation par le public. 110 hectares de boisements, roselières, prairies, marais maritimes et lagunes se répartissent du secteur continental jusqu’aux rivages maritimes du bassin d’Arcachon.
Cette diversité d’habitats naturels conditionne la présence d’un grand nombre d’espèces
En raison d’une opération de gestion, il n’y aura exceptionnellement
pas d’ouverture anticipée ce vendredi 28 novembre.
Ouverture des portes de la Réserve à 10h.
👉 calendrier des ouvertures anticipées
Merci à tous pour votre compréhension.

Chaque année, les oiseaux des jardins doivent redoubler d’énergie pour trouver leur nourriture et survivre aux basses températures de la saison froide. Nous pouvons les aider à traverser l’hiver, mais pas n’importe comment !
Quand nourrir les oiseaux en hiver ?
Il est recommandé de commencer le nourrissage lors des premiers vrais froids de novembre, lorsque les températures ne dépassent plus les 10°C. Il faudra continuer jusqu’à la fin de l’hiver, au plus tard à la mi-mars dans nos régions. Si vous commencez à nourrir les oiseaux au début de l’hiver, arrêter le nourrissage en cours de saison pourrait être fatal pour les habitués de la mangeoire, qui pourraient avoir beaucoup de mal à trouver leur nourriture ailleurs.
Veillez à remplir les mangeoires tous les jours, sans interruption et sans mettre trop de nourriture en même temps au même endroit. Dans la mesure du possible, déposez la nourriture tôt le matin et en fin de journée.
Au retour des beaux jours, diminuez jour après jour la quantité de nourriture distribuée avant d’arrêter complètement.
Où placer les mangeoires ?
Les mangeoires doivent être placées suffisamment en hauteur pour que les oiseaux échappent aux prédateurs, notamment au chat domestique. Installez-les à l’abri des intempéries.

Quel menu proposer ?
– Des graines riches en matières grasses : tournesol noir (riche en lipides), cacahuètes non salées, millet, avoine, pignons, amandes, noix, noisettes ou maïs concassés… ;
– Des boules de graisse ou pains de suif sans filets (ceux-ci peuvent emprisonner ou blesser les oiseaux !) : privilégiez les graisses d’origine végétale, comme l’huile de colza ;
– Des fruits de saison : pommes, poires… même en mauvais états ;
– Pour les insectivores, les vers de farine déshydratés peuvent être une source de protéines, ne donnez pas d’autres insectes.
Ne proposez JAMAIS de lait ni de pain. Celui-ci gonfle dans l’estomac des oiseaux et peut les rendre gravement malades.
Sans oublier l’eau !
Mettre un abreuvoir d’eau peu profond permettra aux oiseaux de s’hydrater, mais aussi de se baigner. Entretenir leur plumage est indispensable pour résister aux températures hivernales. Il convient de changer l’eau tous les jours, surtout lors des périodes de gel.
Pour éviter la transmission de maladies, mangeoires et abreuvoirs doivent être nettoyés au moins une fois par semaine, à l’eau chaude.
Pour plus de détails :
LPO – Quand nourir les oiseaux
Ornithomedia – Quand arrêter de nourrir les oiseaux
Ornithomedia – Pourquoi et comment donner des vers de farine aux oiseaux des jardins
MNHN – Faut-il nourrir les oiseaux en hiver
La Bernache cravant, cette petite oie migratrice emblématique, est une espèce que l’on peut observer à partir de l’automne sur le Bassin d’Arcachon, un site majeur pour son hivernage. Retrouvez les animateurs de la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon pour des accueils naturalistes à Lanton et des sorties sur l’eau en canoë collectif :
Alors que la migration se poursuit chez les populations de grues cendrées (🗺️suivis journaliers), de nombreux individus ont été retrouvés morts à proximité de sites de halte, tous touchés par la grippe aviaire.
Selon la préfecture de la Marne, près de 500 cadavres ont été dénombrés parmi les 42 000 grues cendrées arrivées autour du lac du Der la semaine dernière. Important site de halte sur le trajet des grues qui cherchent à rejoindre l’Espagne ou l’Afrique du Nord, le lac du Der n’est pas le seul site concerné. Des décès liés à la grippe aviaire ont aussi été constatés en Allemagne et dans le sud-ouest de la France. La mortalité semble s’étendre avec l’avancée de la migration.
La préfecture des Landes a confirmé ce vendredi que des grues cendrées retrouvées mortes près du lac d’Arjuzanx étaient bien porteuses du virus de l’influenza aviaire. Le niveau de risque lié à cette épizootie sur le territoire métropolitain français est désormais élevé.
ℹ️ 𝗤𝘂𝗲 𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲 𝘀𝗶 𝘃𝗼𝘂𝘀 𝘁𝗿𝗼𝘂𝘃𝗲𝘇 𝘂𝗻𝗲 𝗴𝗿𝘂𝗲 𝗼𝘂 𝘂𝗻 𝗮𝘂𝘁𝗿𝗲 𝗼𝗶𝘀𝗲𝗮𝘂 𝗺𝗮𝗹𝗮𝗱𝗲 𝗼𝘂 𝗱𝗲́𝗰𝗲́𝗱𝗲́ ?
– Les services de l’État préconisent de ne surtout pas toucher les oiseaux, de ne pas les approcher et de tenir vos animaux domestiques à distance.
– Signalez immédiatement votre observation auprès de la commune concernée ou de l’OFB (📞05 45 39 00 00).
Pour permettre l’installation d’un nouvel ouvrage, les techniciens de gestion du site ont procédé à une baisse du niveau d’eau de la Vasière Spatule. Des interventions à la mini-pelle sont prévues aujourd’hui et demain pour la mise en place d’une écluse toute neuve.
En parallèle, la mini-pelle servira à retravailler une île sur la Lagune Avocette.
Merci pour votre compréhnsion.
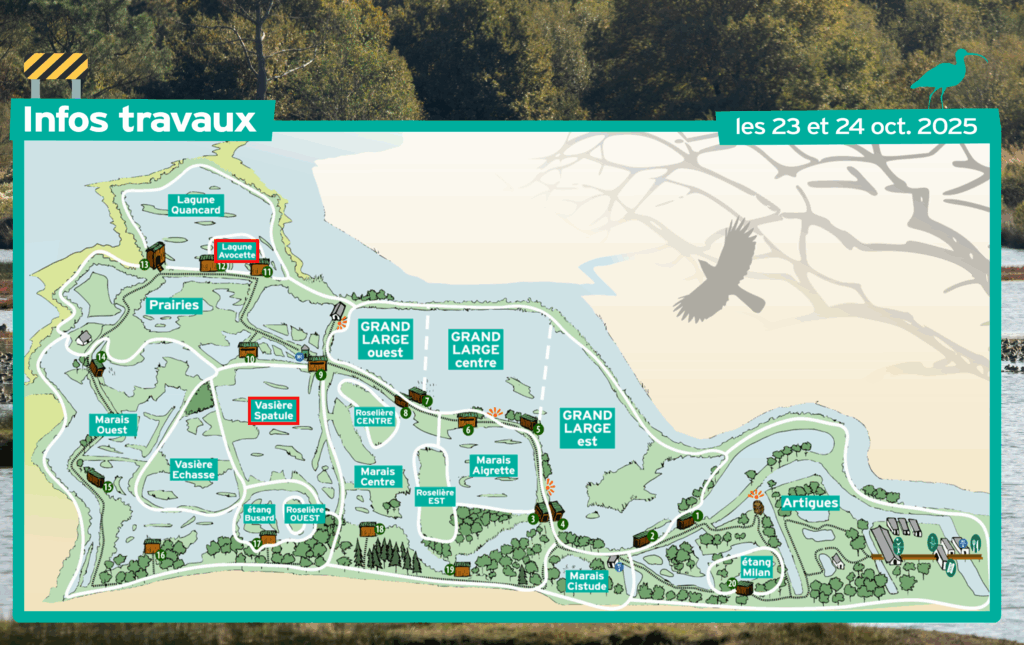
Cet hiver, les animateurs du Parc naturel régional des Landes de Gascogne vous invitent à venir découvrir les grues cendrées. Observer et perfectionner son regard, participer aux comptages, en balade ou depuis les observatoires… plusieurs formules sont proposées :
📅 Les 14 décembre et 11 janvier :
Partez pour un après-midi à la rencontre des grues cendrées, avec prêt de matériel d’observation et goûter offert !
🔸 20e/adulte, 13e/enfant
🔸 Départ à 14h du parking de l’église de Callen.
🔸 Infos et réservations : 📞 05 24 73 37 33
📅 Du 26 au 28 janvier :
Embarquez pour un voyage ornithologique placé sous le signe de la diversité des habitats traversés et des espèces observées. Vous partirez à la rencontre des emblématiques grues cendrées et des bernaches cravants à ventre sombre. Vous découvrirez également l’exceptionnelle diversité des oiseaux littoraux hivernants sur le bassin d’Arcachon et des passereaux de la Lande. Accompagné de Christophe Troquereau, animateur naturaliste du Parc naturel régional, vous prendrez vos quartiers d’hiver à la Ferme des filles, exploitation agricole bio, dans d’agréables gîtes forestiers situés au cœur d’un airial traditionnel.
480 € / personne
Incriptions : julien@escursia.fr
Et bien d’autres encore !
👉ℹ️ PAR ICI LE PROGRAMME
📚 Aujourd’hui, dans le petit glossaire du monde des oiseaux :
Ce n’est pas une légende, son plumage est une véritable illusion d’optique appelée « effet Tyndall » !
🪶 Les plumes du Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) ne contiennent aucun pigment de couleur. Le bleu qu’on lui connaît si bien vient de structures microscopiques qui décomposent la lumière. Plus précisément, les micro-bulles d’air contenues dans les barbes et les barbules de ses plumes associées à une couche de mélanine sombre dispersent et absorbent les autres couleurs pour ne plus diffuser que des longueurs d’onde bleues. En résulte un bleu irisé, qui change de teinte selon la lumière.
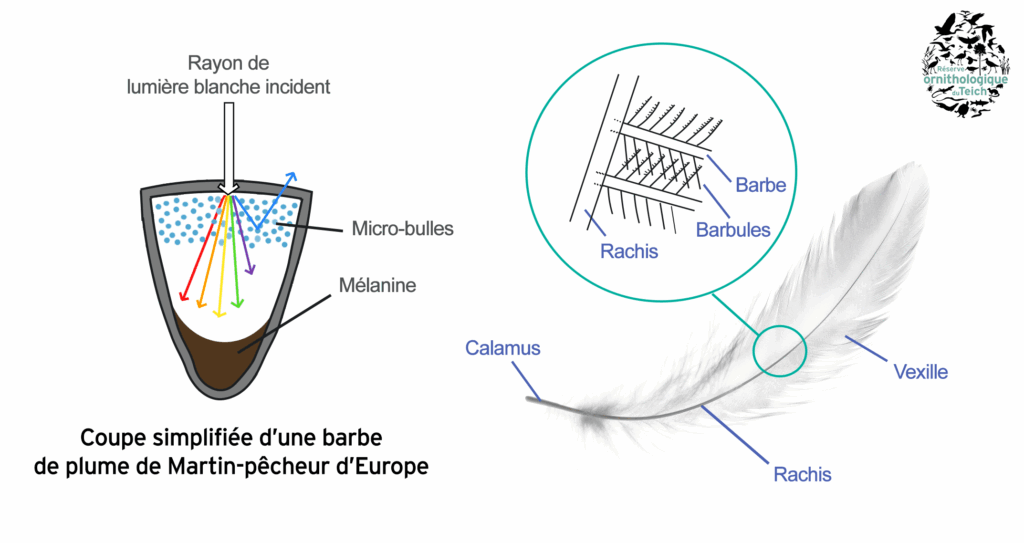
Du nom du physicien britannique John Tyndall, qui l’a décrit pour la première fois en 1869, l’effet Tyndall (plus tard aussi appelé « diffusion de Rayleigh ») s’applique à bien d’autres phénomènes autour de nous, du bleu du ciel à celui des yeux (👁️en savoir plus).

📸 Jean-Paul GRAO
Pour aller plus loin :
Aprés plusieurs jours de travaux, le nouvel observatoire 20 est prêt à accueillir ses premiers visiteurs !
Rendez-vous dans la Réserve dès le mercredi 15 octobre pour profiter de la réouverture de cette portion du sentier.
🐢 Aprés plusieurs mois de mise en assec, l’eau est aussi de retour au Marais Cistude.
Belles observations à tous !



Retour sur le chantier :
démontage de l’ancien observatoire


Montage du nouvel observatoire :


Depuis le 8 septembre et jusqu’en février 2026, le SIBA engage une opération de dragage afin d’améliorer la navigabilité dans la Leyre et au Port du Teich. Une intervention indispensable et habituelle pour garantir le bon fonctionnement du plan d’eau.
Afin de préserver l’accès et la sécurité de navigation, une opération de désensablement est conduite sur le Port du Teich. Au total, près de 20 000 m³ de sable seront extraits.
Les travaux mobilisent la drague stationnaire Dragon et le remorqueur SIBA II, ainsi qu’un dispositif d’installations maritimes adapté. Après une phase d’installation en septembre, l’extraction du sable est prévue à partir du 13 octobre et se poursuivra jusqu’à fin février 2026, exclusivement du lundi au vendredi.
Le sable prélevé sera déposé à proximité des balises, ainsi que sur la plage du Teich.
Les caractéristiques de la drague « Dragon »
Cette opération, habituelle sur le port, est essentielle pour maintenir la navigabilité et préserver la qualité du plan d’eau.
Le contournement de la drague :
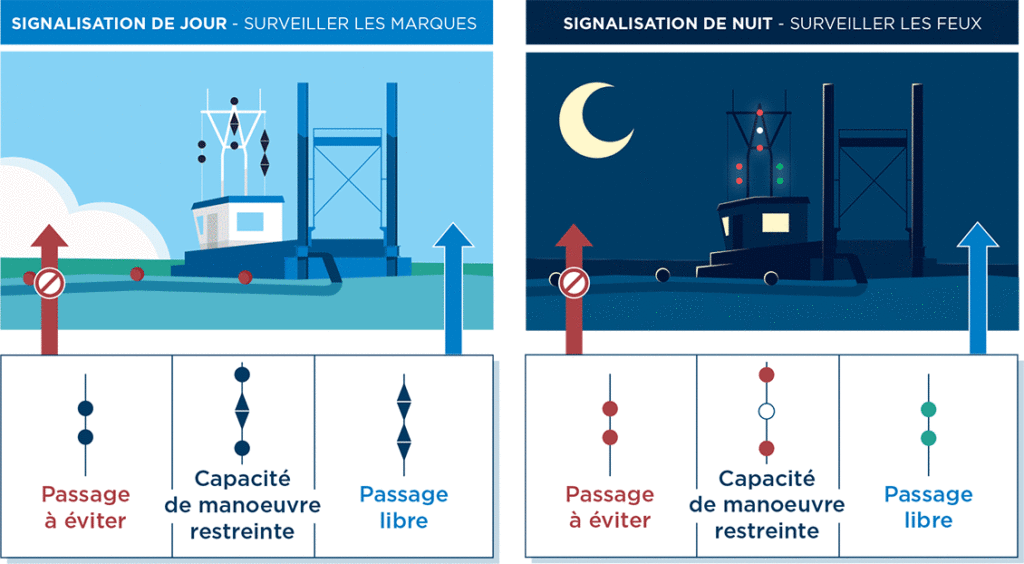
Vous avez été quelques-uns à remarquer la présence d’un individu peu commun parmi les hirondelles rustiques de passage dans la Réserve ces derniers jours : une Hirondelle rustique toute de blanc vêtue !
Chez les oiseaux, les aberrations dans la couleur des plumes peuvent prendre plusieurs formes :
👉📰 Ornithomedia : l’albinisme et le leucisme chez les oiseaux
Les oiseaux atteints d’albinisme présentent une absence de pigments sur les plumes et des teintes rouge rosée sur la cire du bec, sur les pattes et dans les yeux. Le taux de mortalité étant très élevé chez les jeunes albinos, il est très rare de les observer.
L’Hirondelle observée ici serait plutôt atteinte de leucisme. Son plumage blanc présente des teintes grises sur le bord des ailes et la poitrine, et ses yeux ne sont pas rouges. Le leucisme est dû à une mutation qui, lors du développement embryonnaire, entraine l’absence de mélanocytes (cellules qui synthétisent la mélanine) à certains endroits ou sur tout le corps de l’oiseau.
Le plumage atypique de ces oiseaux peut les exposer à de terribles dangers : détection plus facile pour les prédateurs, rejet de la part de leurs semblables…
Chez les oiseaux leuciques, la reproduction n’est cependant pas toujours impossible :
👉 📰 LPO – Pourquoi certains oiseaux sont blancs ?

📸 Hirondelle rustique leucique, photographiée par Inge van Halder dans la Réserve ornithologique du Teich, le 26 sept. 2025.
Merci à la plateforme Ornithomedia, pour l’article fascinant
et les précieuses précisions apportées à la suite de cette observation :
Du samedi 27 septembre 2025 au dimanche 26 avril 2026, l’espace muséographique du Domaine de Certes et Graveyron (à Audenge) accueille une exposition unique signée Anne Hernalsteen et Xavier Lebrun de l’association APEX.
Une immersion sensorielle pour découvrir le monde fascinant des oiseaux : écouter leurs chants, observer leurs plumes, comprendre leurs migrations et s’émerveiller de leurs parades… Tout un voyage au cœur de la vie ailée.
Une partie spécialement conçue pour les 3-6 ans, intitulée « Boules de plumes », permettra aussi aux plus petits de s’initier à la magie des oiseaux à travers des modules ludiques et adaptés.
Exposition en accès libre et gratuit, tous les jours aux heures d’ouverture du Domaine
Horaires : 10H-13H / 14H-18H (puis 10H-13H / 14H-17H de novembre à mars)
En parallèle, de nombreuses animations seront proposées par le Département et ses partenaires autour de la thématique des oiseaux !
Découvrez le programme >> ICI
Plusieurs opérations sont programmées pour début octobre 2025 dans la Réserve :
🚧 Des interventions à la minipelle sont prévues entre le 29 septembre et le 10 octobre pour la création d’un barrage derrière le marais Cistude, pour reprofiler le plan d’eau au niveau de l’observatoire 20 et pour diverses opérations de maintien au fond de la Réserve.
🚧 Il est temps pour l’observatoire 20 de se refaire une beauté ! Le sentier pour s’y rendre sera fermé du 29 septembre au 14 octobre. Cet observatoire nécessitant d’être totalement reconstruit, nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension.
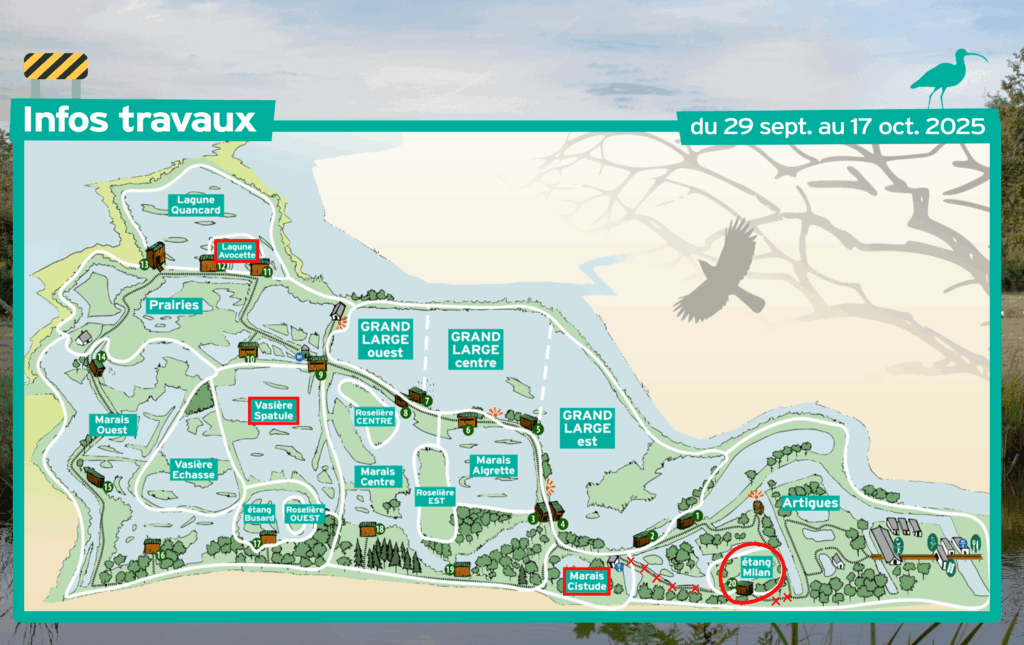
Les martins-pêcheurs sont nombreux dans la Réserve cette année, il est possible de les observer ailleurs qu’à l’observatoire 20.
Nos conseils ? Jetez un œil du côté des observatoires 9, 10, 14, 15 ou 19 !
Alors que la migration postnuptiale bat son plein, il est temps de revenir sur la saison de nidification 2025 des oiseaux d’eau. Pour les 3 espèces de laro limicoles nicheuses régulières, le bilan est plutôt positif :
🔹 L’𝗔𝘃𝗼𝗰𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗲́𝗹𝗲́𝗴𝗮𝗻𝘁𝗲 signe un retour attendu après deux ans d’absence. Grâce aux aménagements réalisés cet hiver, 7 couples se sont installés. Malgré la prédation du Renard, 4 jeunes ont pris leur envol : un succès reproducteur de 0,57 jeune par couple, au-dessus du seuil de renouvellement des populations (0,3).
🔹 La 𝗠𝗼𝘂𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗿𝗶𝗲𝘂𝘀𝗲, avec 57 couples nicheurs, a connu une saison plus difficile, victime des attaques du Milan noir. Résultat : 9 jeunes à l’envol, un chiffre dans la moyenne des années passées.
🔹 L’𝗘́𝗰𝗵𝗮𝘀𝘀𝗲 𝗯𝗹𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 réalise une performance record ! Sur 42 couples nicheurs, 40 jeunes ont atteint l’envol, soit un succès reproducteur exceptionnel de 0,95 jeune par couple. C’est le succès reproducteur le plus élevé depuis la mise en place de ce suivi.
Deux couples de 𝗣𝗲𝘁𝗶𝘁 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗲𝗹𝗼𝘁 se sont aussi installés avec succès, donnant chacun 2 jeunes ! Autre surprise de la saison, deux couples de 𝗚𝗿𝗲̀𝗯𝗲 𝗰𝗮𝘀𝘁𝗮𝗴𝗻𝗲𝘂𝘅 se sont installés et ont chacun mené 2 jeunes à l’envol. Une excellente nouvelle, puisque l’espèce n’avait plus niché sur le site depuis 2020. Chez les anatidés et autres oiseaux d’eau, le nombres de couple (ou nichées) est stable par rapport aux années précédentes :
🔹 𝗖𝗮𝗻𝗮𝗿𝗱 𝗰𝗼𝗹𝘃𝗲𝗿𝘁 : 17 couples
🔹 𝗧𝗮𝗱𝗼𝗿𝗻𝗲 𝗱𝗲 𝗕𝗲𝗹𝗼𝗻 : 7 couples
🔹 𝗖𝘆𝗴𝗻𝗲 𝘁𝘂𝗯𝗲𝗿𝗰𝘂𝗹𝗲́ : 5 couples
🔹 𝗚𝗮𝗹𝗹𝗶𝗻𝘂𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗹𝗲-𝗱’𝗲𝗮𝘂 : 11 couples
🔹 𝗥𝗮̂𝗹𝗲 𝗱’𝗲𝗮𝘂 : 2 couples

Avocettes élégantes juvéniles – Josselyne Camiade
Merci à Carolanne (étudiante en Gestion et Protection de la Nature à Périgueux) et Juliette (en licence 3 de biologie à l’université de La Rochelle) pour leur implication dans ces différents suivis.
📅 𝗦𝗔𝗠𝗘𝗗𝗜 𝟰 𝗢𝗖𝗧𝗢𝗕𝗥𝗘
À l’occasion des Journées européennes de la migration (organisées en France par la LPO), la Réserve ornithologique du Teich et les guides naturalistes de la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon vous invitent à une journée de rencontres et d’observations le samedi 4 octobre 2025 !
🔸 𝗩𝗶𝘀𝗶𝘁𝗲 𝗴𝘂𝗶𝗱𝗲́𝗲 𝗶𝗺𝗺𝗲𝗿𝘀𝗶𝘃𝗲 :
Rendez-vous de 15h à 18h pour une balade guidée au cœur de la Réserve ornithologique.
16€/adulte, 11€/tarif réduit, 48€/famille
À partir de 10 ans, jumelles fournies.
Complet.
🔸 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲́𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 :
« 𝗟𝗮 𝗺𝗶𝗴𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗼𝗶𝘀𝗲𝗮𝘂𝘅 : 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗹𝗲𝘀 𝘃𝗼𝘆𝗮𝗴𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗱𝘂 𝗰𝗶𝗲𝗹 » avec Maxime ZUCCA !
Qui sont les oiseaux migrateurs ? Pourquoi migrent-ils ? Comment trouvent-ils leur route ? Comment survivent-ils à de si longs et périlleux voyages ?
Réponses à 19h, à la Salle multimédia de la Réserve ornithologique du Teich.
Entrée gratuite, sur inscription.
Complet.
Réservations obligatoires au 05 24 73 37 33
ou via ce formulaire 👉 https://bit.ly/EuroBirdWatch2025
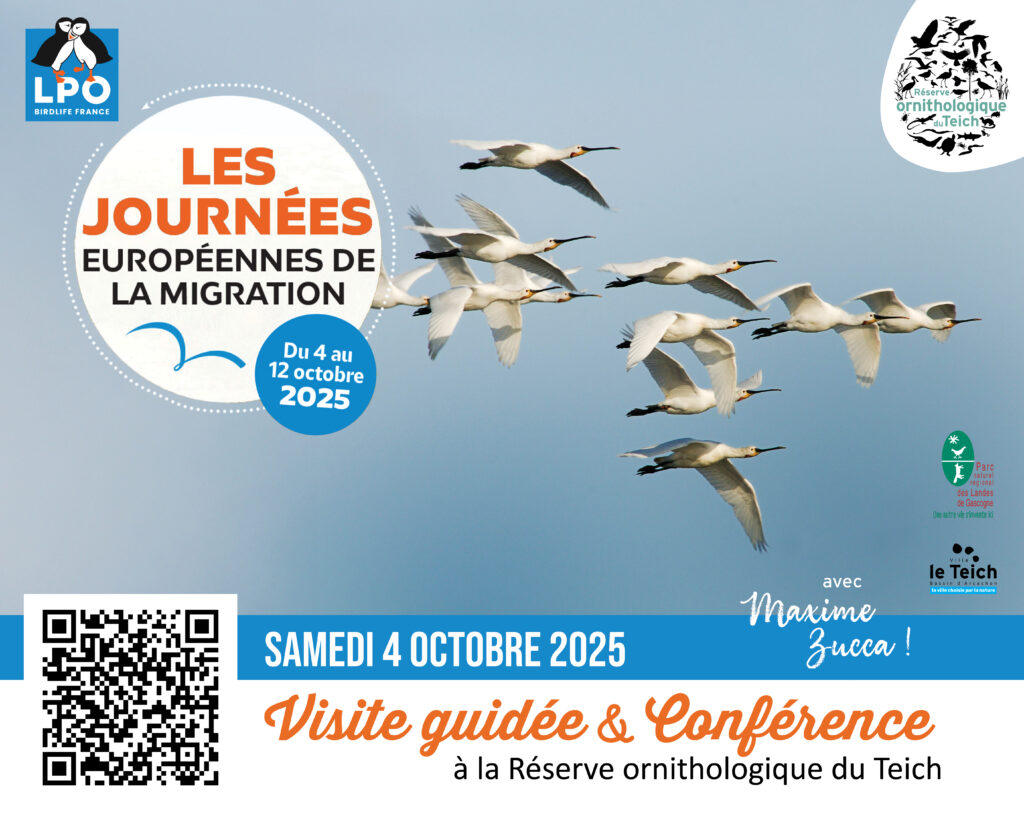
🔸Samedi 6 septembre
Visite guidée et conférence : à la découverte des limicoles du bassin d’Arcachon
👉 infos et inscriptions
🔸3, 10, 17 et 24 septembre, 1er octobre
Visite guidée de la Réserve ornithologique en matinée
👉 infos et inscriptions
🔸Lundi 15 septembre
Formation : les limicoles en migration
👉 infos et inscriptions
🔸20 et 21 septembre
Visite, exposition & atelier gratuits pour les Journées européennes du Patrimoine
👉 infos et inscriptions
🔸4 et 5 octobre
Week-end de formation : les oiseaux migrateurs
👉 infos et inscriptions
🔸Samedi 4 octobre
Journées européennes de la migration : visite guidée suivie d’une conférence de Maxime Zucca !
👉 infos et inscriptions
La Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon (antenne du Parc naturel régional des Landes de Gascogne) et le département de la Gironde proposent des sorties gratuites pour découvrir la biodiversité et explorer les paysages du bassin d’Arcachon. En balade au coeur du delta de la Leyre, en forêt ou sur l’estran… embarquez pour quelques heures aux côtés de naturalistes passionnés :
GRATUIT !
Réservation au 05 24 73 37 33.
📚 Aujourd’hui, dans le petit glossaire du monde des oiseaux :
Le commensalisme est une interaction entre des individus d’espèces différentes, dans laquelle une espèce tire un avantage de l’autre sans que celle-ci n’en trouve ni avantage ni inconvénient. Théorisé au XIXe siècle par le zoologiste Pierre-Joseph Van Beneden, on oppose ce type de relation au mutualisme, où les deux espèces tirent profit de l’interaction avec l’autre. Contrairement au mutualisme, le commensalisme repose sur une asymétrie : seule une des deux espèces trouve un bénéfice à l’action de l’autre.
Chez les oiseaux, le commensalisme peut prendre des formes diverses. Le Héron garde-bœufs (Ardea ibis) accompagne par exemple souvent les troupeaux. En marchant et en retournant la terre, les bovins, les chevaux ou même les moutons mettent à jour les petits invertébrés dont se nourrissent les échassiers. Les hérons profitent de la présence de ces animaux pour se nourrir sans difficulté, sans pour autant les déranger.
De même, de nombreuses espèces d’oiseaux profitent pour s’abriter ou pour nicher des cavités creusées dans les arbres par les pics. Après la période de nidification, les loges creusées par les pics pourront recevoir la visite d’autres oiseaux (mésanges, étourneaux, chouettes, etc.), de chauves-souris ou même de petits mammifères. Les pics jouent ici un rôle d’ingénieurs de l’écosystème. Ils créent des ressources pour de multiples espèces, sans en retirer de bénéfice.

📸 Joël Chassin – Hérons garde-boeufs avec les brebis de la Réserve ornithologique du Teich.
📸 Photo de couverture : Pic noir dans sa loge, photographié par Amandine Soyez
Pour aller plus loin :
Les 20 et 21 septembre 2025, la ville du Teich vous invite à célébrer le patrimoine à travers un programme riche et gratuit ! Balades nature, visites guidées, immersion au sommet du Belvédère, animations marines ou encore expositions vous attendent tout au long du week-end.
Pour l’occasion, la Réserve ornithologique du Teich et la MNBA vous proposent de partir à la découverte des trésors naturels du Teich :

Samedi 20 septembre
de 9h30 à 12h00 – COMPLET
Tous à la vase !
Du haut de plage à l’estran vaseux, de la laisse de mer aux crabes dont on ne distingue que les yeux, venez découvrir, en compagnie d’un animateur nature du Parc naturel régional des Landes de Gascogne, les paysages du bassin d’Arcachon à marée basse et comprendre comment la vie s’organise avec le balancement des marées. Arpenter, explorer, chercher, contempler seront les maîtres mots de nos découvertes !
Rendez-vous : Sentier du Littoral (parking situé allée de Canteranne, à Gujan-Mestras)
Réservation obligatoire au 05 24 73 37 33.
GRATUIT avec le soutien du Département de la Gironde
À partir de 5 ans.

Samedi 20 septembre
de 13h30 à 17h00
EXPOSITION
Portraits d’oiseaux et accueil naturaliste au Belvédère du port du Teich !
La Réserve ornithologique du Teich propose une exposition hors les murs inédite, au pied du Belvédère du Teich. Venez découvrir les portraits d’oiseaux réalisés au cœur de la Réserve par des visiteurs passionnés !
Et pour prendre un peu plus de hauteur, grimpez à la rencontre de l’animateur nature qui, au sommet du Belvédère, vous apprendra à lire les paysages et comprendre les mouvements des oiseaux du delta de la Leyre.
Gratuit – Accès libre.
(photo ci-dessus : Didier Lae)

Dimanche 21 septembre
de 9h30 à 12h00 – COMPLET
Visite « ornitho-historique » de la Réserve ornithologique du Teich
Les guides naturalistes de la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon vous invitent à une balade « ornitho-historique » sur les sentiers de la Réserve. Un parcours de 4 kilomètres évoquant l’histoire du site et de ses paysages, façonnés par l’activité humaine pour les oiseaux sauvages. « Parc » devenu « Réserve » ornithologique, 110 hectares contribuent depuis 1972 à la richesse et à la protection du patrimoine naturel local. Le temps d’une matinée, venez découvrir les oiseaux et l’évolution de cet ancien lit de La Leyre.
Rendez-vous à l’accueil de la Réserve Ornithologique du Teich
Réservation obligatoire au 05 24 73 37 33.
GRATUIT dans la limite des places disponibles.
Maximum 20 places – à partir de 7 ans

Dimanche 21 septembre
de 13h30 à 17h30
Accueil naturaliste à la pointe du Teich
Un guide naturaliste et sa longue-vue seront présents tout l’après-midi sur le Sentier du Littoral, à la pointe du Teich. Venez à sa rencontre pour découvrir les richesses naturelles du littoral et observer les oiseaux du Bassin d’Arcachon !
Gratuit – Accès libre.
Visiteur régulier à la Réserve ornithologique du Teich et photographe de talent, Joël Chassin a récemment eu l’occasion d’explorer de nouveaux paysages et d’observer dans un autre contexte des espèces habituellement croisées au Teich. Il partage avec nous le souvenir de rencontres exceptionnelles, en mai et juin dernier, au cœur du fabuleux Parc national de Doñana, en Espagne.
Situé sur la rive droite du Guadalquivir, le Parc national de Doñana est la plus grande zone humide du sud de l’Europe. Déclarée réserve de la biosphère et patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO, elle accueille l’une des plus grandes héronnières de la région méditerranéenne !
Marais, lagunes, dunes mobiles, falaises, pinèdes et plages couvrent sur plus 54 000 hectares une mosaïque d’habitats essentiels à la préservation d’espèces menacées. Le Lynx ibérique, l’Aigle impérial ibérique, la Sarcelle marbrée, l’Érismature à tête blanche, la Foulque à crête, le Fuligule nyroca, le Butor étoilé ou encore la Guifette noire y trouvent refuge.
Sur le couloir de migration Est-Atlantique, les marais du Parc offrent des zones de halte, d’hivernage et de reproduction pour des milliers d’oiseaux d’eau. Joël Chassin a pu y observer des spatules blanches et des ibis falcinelles… avec leurs petits !


Nichant en colonie, ces deux espèces construisent leurs nids avec de fines branches. La Spatule blanche pond 3 à 5 œufs (parfois 6) entre avril et mai. Ils seront couvés pendant 24 jours. Les jeunes spatules commenceront à voler à 7 semaines, mais n’atteindront leur maturité sexuelle qu’après 3 ans.
L’Ibis falcinelle pond généralement 4 œufs d’un gris-bleu intense. Ils seront couvés par les deux parents pendant 3 semaines. Les jeunes peuvent essayer de voler à partir de 28 jours. Ceux qui quittent le nid se regroupent pour être nourris par l’ensemble des adultes.

Un grand merci à Joël Chassin pour le partage de ces belles rencontres !
Pour aller plus loin :
👉 Un site classé à l’Unesco
Pour visiter le Parc :
👉 Parc national de Doñana
À l’occasion de la Journée mondiale des Limicoles, la Réserve ornithologique du Teich et la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon (antenne du Parc naturel régional des Landes de Gascogne) vous invitent à venir observer et étudier les oiseaux du bassin d’Arcachon !
🔶 𝗩𝗶𝘀𝗶𝘁𝗲 𝗴𝘂𝗶𝗱𝗲́𝗲 𝗶𝗺𝗺𝗲𝗿𝘀𝗶𝘃𝗲 :
Rendez-vous de 15h30 à 18h30 pour une balade guidée au cœur de la Réserve ornithologique !
🔸16€/adulte, 11€/tarif réduit, 48€/famille
🔸À partir de 12 ans, jumelles fournies.
Visite guidée complète – il reste des places pour la conférence :
🔶 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲́𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 :
Adrien de Montaudouin, ornithologue à la Réserve Naturelle Nationale du Banc d’Arguin (SEPANSO), donnera à partir de 19h une conférence pour tout comprendre de l’écologie et de la migration des limicoles sur le bassin d’Arcachon.
🔸À la Salle multimédia de la Réserve ornithologique du Teich.
🔸Entrée gratuite, sur inscription.
Réservations obligatoires au 05 24 73 37 33
ou via ce formulaire :👉 Formulaire de réservation
Détails du programme :
🔎👉 Tout le programme
Photo de couverture : Guy David
Image ci-dessus : Jacques Gillon
Outre-Atlantique, Bryce Robinson et le Cornell Lab of Ornithology étudient l’incroyable diversité des buses à queue rousse. Bien que très répandue en Amérique du Nord, l’espèce n’a jusqu’ici été que très peu étudiée.
Le projet « Buse à queue rousse » regroupe les données de chercheurs des États-Unis et du Canada pour analyser les variations de plumages et l’évolution des 16 sous-espèces reconnues.
À l’est de l’Amérique du Nord, les buses à queue rousse ont presque toujours le dessus brun, la poitrine et le ventre clairs, une ceinture rayée et une queue rousse. À l’ouest de l’Amérique du Nord, de nombreux individus sont châtain foncé ou chocolat. Un groupe nichant à l’extrême nord-ouest du continent est encore plus sombre, avec une queue qui n’est même pas rousse.
À l’ouest des États-Unis et du Canada, 80% de la population de la sous-espèce calurus présente des formes claires, les 20% restant étant des formes sombres ou intermédiaires.
🔎 L’objectif des chercheurs est de comprendre comment des oiseaux d’une même espèce peuvent maintenir une telle multiplicité de couleurs ? Comment coexistent ces différentes colorations ? Dans quelle mesure ces variations reflètent-elles la structure génétique de l’espèce et son histoire évolutive ?
En attendant les premières analyses, Bryce Robinson et Nicole Richardson partagent un échantillon des centaines de photographies compilées pour ce projet :
👉 Cracking the Red-tail Code: Exploring the Diversity of America’s Most Widespread Hawk

📸 Nicole Richardson – projet Buse à queue rousse.
Qui sont les goélands qui visitent la Réserve ?
Apprenez à différencier les 5 espèces les plus observées sur le site :

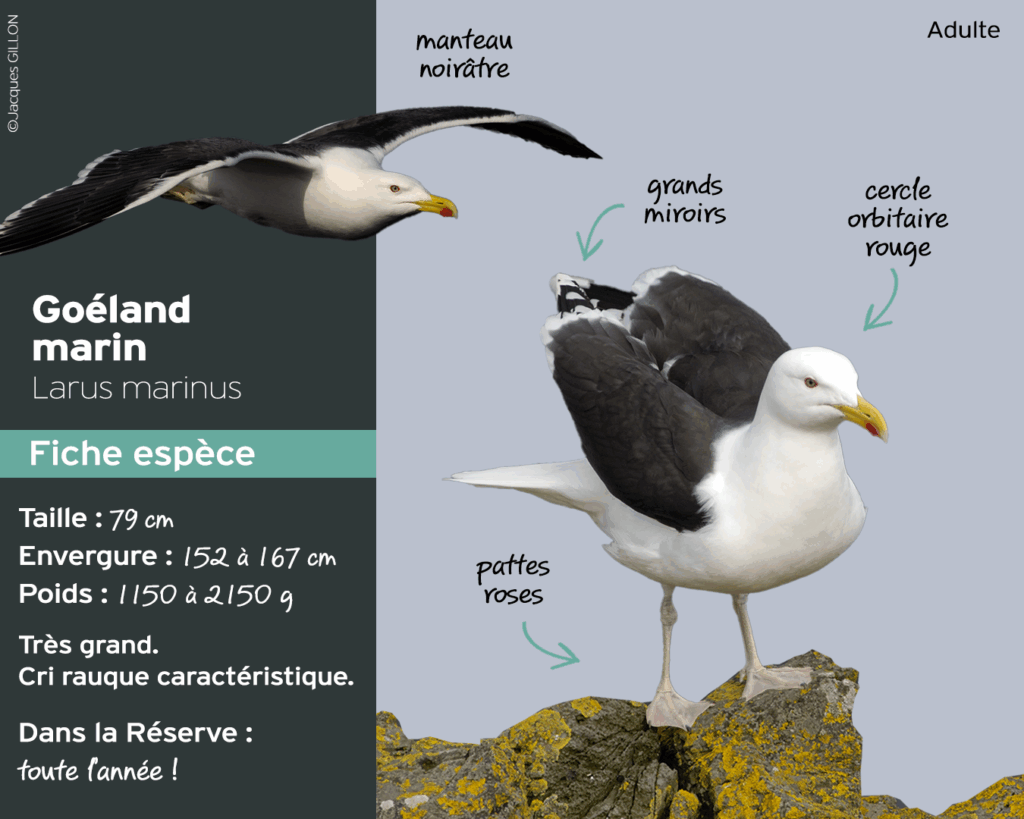
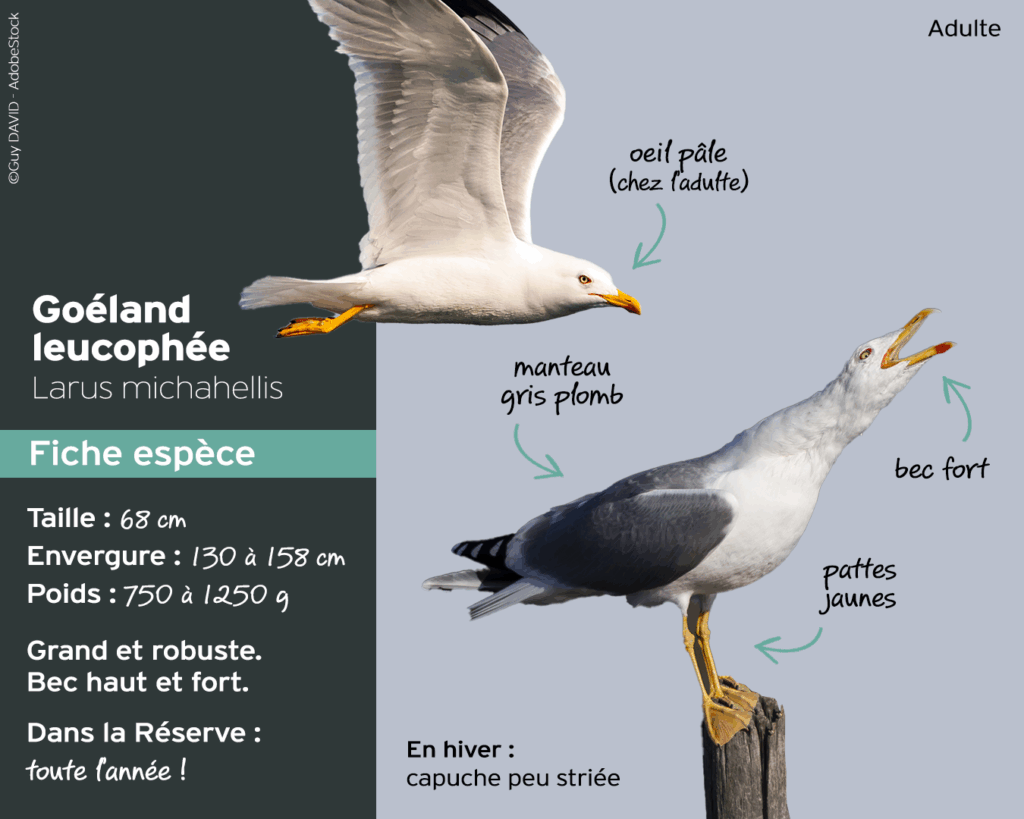
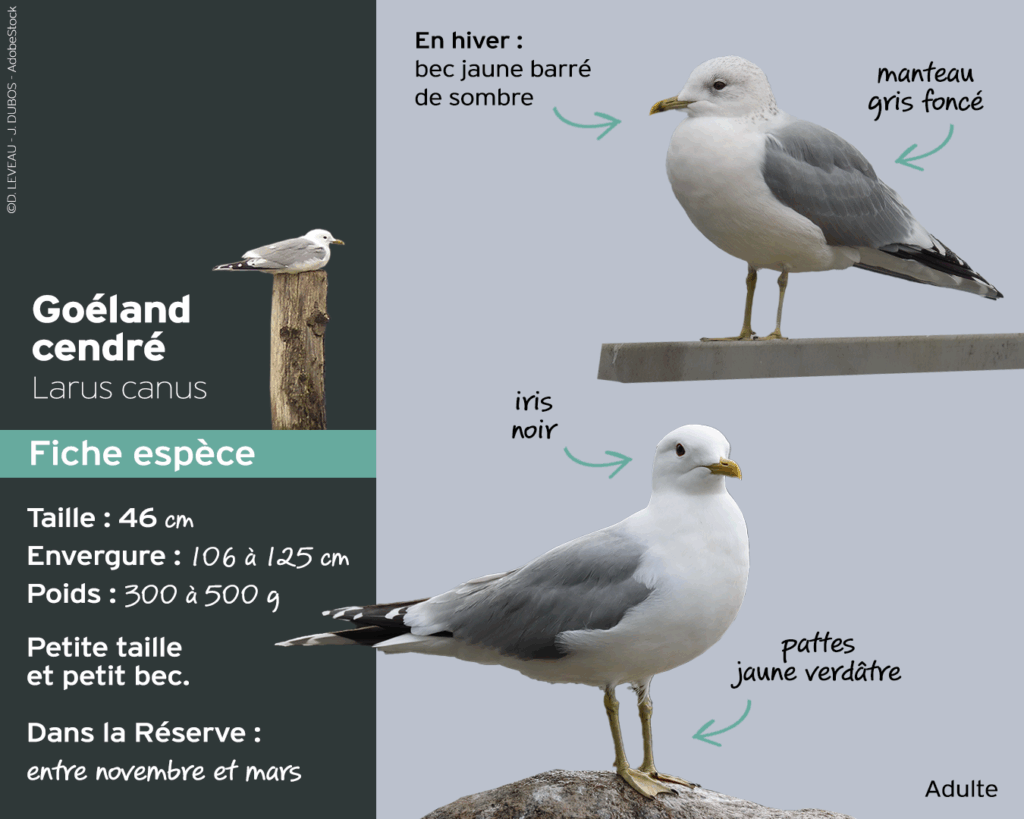
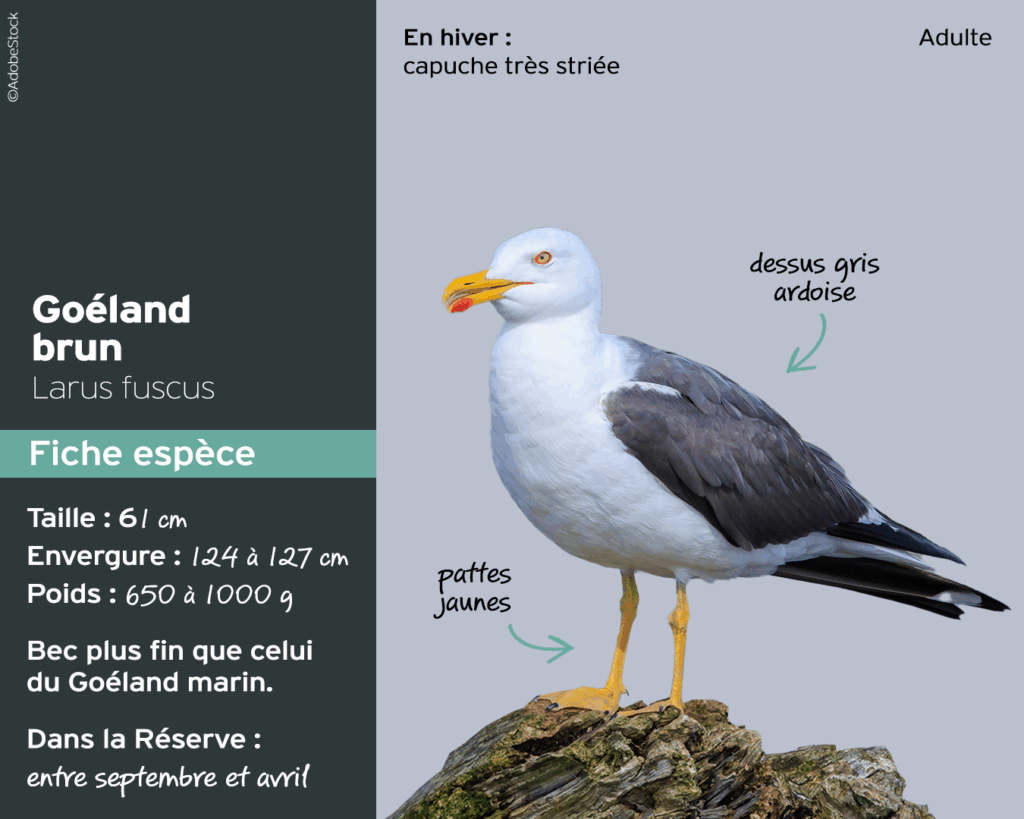
Pour aller plus loin, la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon propose une formation « Laridés et oiseaux côtiers » en fin d’année :
👉 Les formations de la MNBA
L’heure du rassemblement a sonné chez les milans noirs. Dès le mois de juillet, ces migrateurs au long cours forment des groupes pour regagner l’Afrique subsaharienne. Planeur accompli, le Milan noir tire profit de courants aériens pour parcourir de longues distances sans recourir au vol battu, particulièrement énergivore. Capable de franchir jusqu’à 500 kilomètres en un seul jour (bien qu’il s’en tienne en général plutôt à une distance de 150 à 350 km), il affiche une vitesse moyenne de 48,5 km/h en vol plané.
Son secret ? L’usage des ascendances : des courants d’air verticaux qui élèvent les oiseaux sans qu’ils aient besoin de battre des ailes. On distingue principalement deux types de courants, les ascendances thermiques et les ascendances dynamiques.
Les ascendances thermiques sont produites par le réchauffement du sol par le soleil. L’air chaud, plus léger, s’élève en colonnes invisibles dans l’atmosphère. Souvent marquées par la présence de cumulus (l’air chaud refroidit en altitude pour former des nuages), ces colonnes apparaissent généralement en fin de matinée pour s’estomper en fin de journée. Elles sont totalement absentes en cas de couverture nuageuse.
Une fois engouffrés dans ces courants d’air chaud, les rapaces comme les milans noirs déploient leurs ailes et décrivent des cercles jusqu’à atteindre une certaine altitude. Tant que la vitesse de l’air ascendant dépasse la vitesse de chute propre à l’oiseau, celui-ci peut continuer de s’élever. Lorsqu’il atteint une hauteur suffisante, l’oiseau peut se laisser glisser en vol plané vers la prochaine colonne.
Cet enchaînement de spirales ascendantes et de vols planés en ligne droite est appelé vol à voile. Il permet de couvrir de très longues distances sans effort musculaire. Par temps favorable, un oiseau peut ainsi parcourir plusieurs dizaines de kilomètres sans battre une seule fois des ailes.
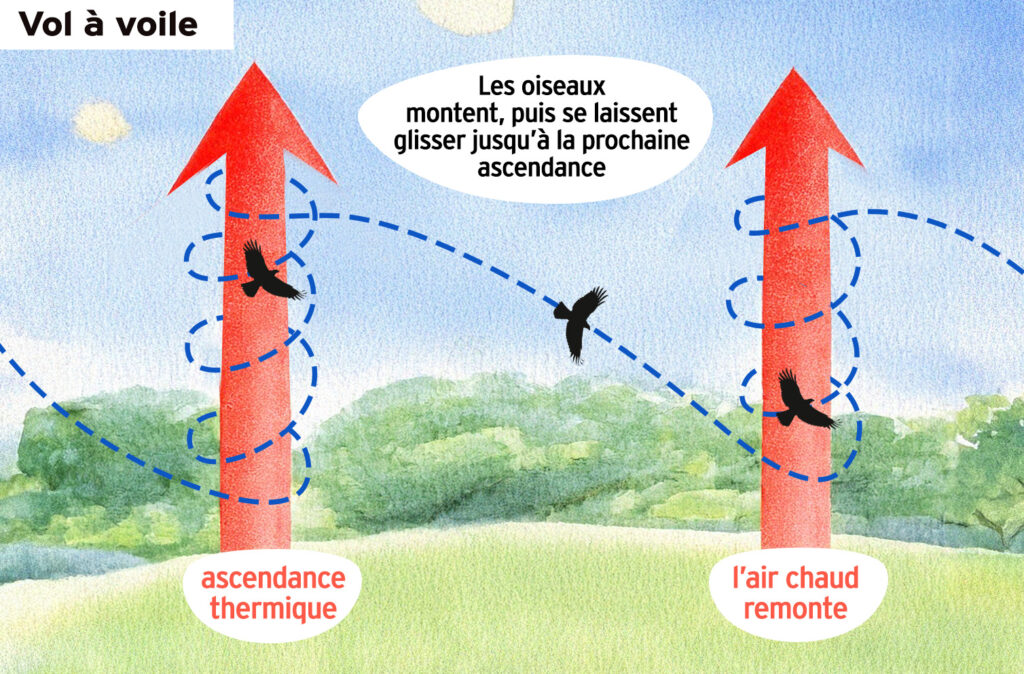
Les ascendances dynamiques apparaissent lorsque le vent heurte un relief. Le soulèvement de l’air produit par le vent sur une colline, une montagne ou une élévation modeste créé une portance suffisante pour les oiseaux.
L’utilisation des ascendances est déterminante dans le choix des routes migratoires. Il est, par exemple, très rare de trouver des ascendances efficaces au-dessus de la mer. C’est ce qui conduit les rapaces comme les milans noirs à emprunter des détroits comme Gibraltar, large de seulement 14 kilomètres. Les populations de Milan noir y transitent en groupes parfois très denses. Plus de 91 000 individus ont pu y être recensés en une seule journée. Autre point de passage, ici également soumis aux ascendances dynamiques, le col pyrénéen d’Organbidexka est emprunté par une moyenne de 32 935 milans noirs chaque année (selon les données saisies de 2018 à 2024).
Données Trektellen – Col pyrénéen d’Organbidexka :

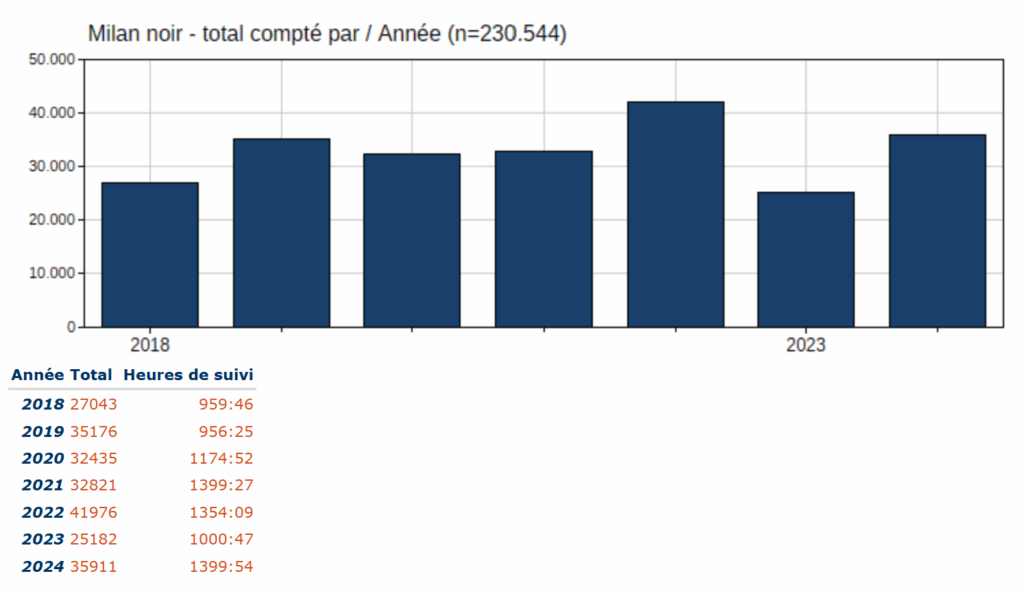
Pour aller plus loin :
Ornithomedia – L’utilisation des ascendances thermiques et dynamiques par les oiseaux
Migraction.net – Milan noir (Milvus migrans)
Trektellen.org – Totaux Col d’Organbidexka, Pyrénées-Atlantiques (64) 2016 – 2025
Ornithomedia – La migration : les méthodes de vol actives
Oiseaux.net – Dossier Milan Noir
Plusieurs opérations de gestion sont programmées dans la Réserve pour ce mois de juillet :
✅️ Entretien des digues entre les observatoires 14 et 15 (Marais Ouest).
✅️ Entretien et arasement des îlots de la Vasière Spatule, au niveau de l’observatoire 10 (entre les 18 et 21 juillet).
✅️ Entretien de la roselière Est.
🪧 Pour être informés des opérations en cours le jour de votre venue, consultez les panneaux à l’accueil de la Réserve.

📚 Aujourd’hui, dans le petit glossaire du monde des oiseaux :
🖊️ Zoom sur : la « SYRINX »
Les oiseaux sont capables de produire une grande diversité de sons. Les pics tambourinent, les cigognes craquettent, certaines espèces font vibrer leurs plumes… Mais bien qu’extrêmement variés, la majorité des sons produits par les oiseaux sont des chants ou des cris. Ils sont générés par un organe vocal que les oiseaux sont seuls à posséder : la syrinx.
Alors que les autres vertébrés utilisent le larynx (situé au-dessus de la trachée) pour émettre des sons, les oiseaux vocalisent exclusivement grâce à la syrinx, située à la jonction entre la trachée et les bronches. Ce positionnement unique dans la cage thoracique, plutôt qu’à l’entrée des voies respiratoires comme le larynx, soulève encore des questions sur son origine évolutive.
Anatomiquement, la syrinx est composée de cartilages et de cavités contenant des membranes vibrantes, mises en action par l’air expiré ou inspiré. Ce sont les muscles qui entourent cet organe qui permettent d’ajuster les tensions et les mouvements des membranes, modulant ainsi le son en fréquence, en intensité et en rythme. Chez certaines espèces, chaque côté de la syrinx peut fonctionner indépendamment, produisant simultanément deux sons différents. C’est cette prouesse que l’on retrouve, par exemple, dans les vocalises des étourneaux sansonnets.
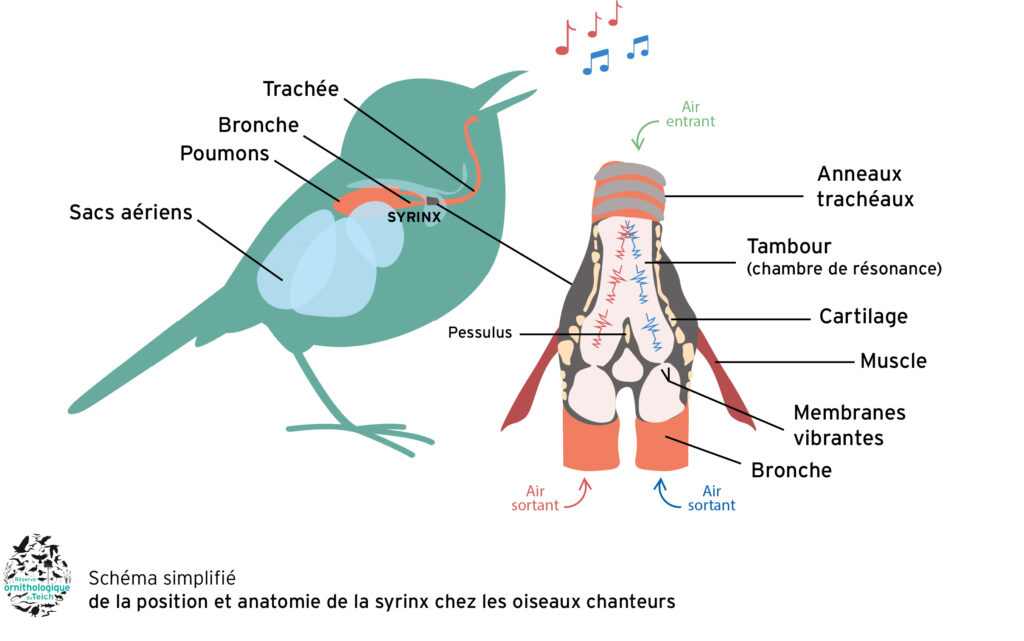
Le système respiratoire des oiseaux joue un rôle essentiel dans le soutien de cette performance vocale. Contrairement aux mammifères, leur respiration repose sur un flux d’air continu, permis par un ensemble de sacs aériens (9 chez la majorité des espèces) et de fins canaux appelés parabronches. L’un de ces sacs, le sac claviculaire, entoure la syrinx et pourrait participer à son efficacité.
Retenons que la syrinx, les muscles qui l’entourent et le système respiratoire des oiseaux sont le fruit d’une coévolution remarquable, qui explique leur capacité à produire des sons exceptionnels.

Le saviez-vous ?
Dans la mythologie grecque, Syrinx est une nymphe. Fille du dieu-fleuve Ladon et suivante d’Artémis, elle se serait changée en roseaux pour échapper aux avances du dieu Pan, qui transforma les tiges en sa célèbre flûte.
Pour aller plus loin :
Planet Vie – Comment et pourquoi les oiseaux chantent-ils ?
Pour la science – Le secret de la syrinx
RadioFrance – Pourquoi et comment les oiseaux chantent ?
Science & Vie – Une origine commune pour le larynx des mammifères et la syrinx des oiseaux
Franz Goller, Current biology – The syrinx
Ornithomedia – La respiration chez l’oiseau
Vogelwarte – Chants et autres sons
Jean-Claude Roché : l’art de capter le chant des oiseaux
BirdNote – Some Birds Have Two Voices
Espèces protégées, les Martinets sont menacés partout en Europe par la disparition des bâtiments propices à leur nidification (renfoncements entre les tuiles, anfractuosités des façades…), par la disparition des insectes et par la prédation.
Découvrez notre dossier spécial :
👉 À LA DECOUVERTE DES MARTINETS
𝗣𝗼𝘂𝗿 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲́𝗴𝗲𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻𝗲𝘁𝘀, 𝘃𝗼𝘂𝘀 𝗽𝗼𝘂𝘃𝗲𝘇 :
L’équipe de gestion de la Réserve accueille une nouvelle stagiaire pour les deux prochains mois. Étudiante en master BEE (Biologie, écologie, évolution) à l’université de Toulouse, Carmen suit le parcours MAB (Man and Biosphere).
Sa mission pour les prochaines semaines ?
Rassembler, tirer et analyser les données de toutes les espèces baguées contactées dans la Réserve depuis 2020.

Les données collectées par lecture de bagues offrent des informations précieuses pour le suivi des populations d’oiseaux. Tous les oiseaux bagués observés sur nos sentiers sont répertoriés et signalés auprès des organismes à l’origine du baguage. Chaque code raconte l’histoire de l’oiseau qui le porte. Il peut permettre de connaître son lieu de naissance, son âge, la route migratoire qu’il emprunte…
Il est ainsi possible de savoir que, parmi les 104 avocettes élégantes porteuses de bagues observées dans la Réserve depuis 2021, 57 ont été baguées en France, 39 aux Pays-Bas, 3 en Belgique et en Espagne et seulement 2 en Pologne.
Du côté des spatules blanches, plusieurs observations établissent que la majorité des individus qui transitent par la Réserve arrivent également des Pays-Bas. Cette semaine, un individu a été observé avec, à la patte gauche, le code alphanumérique NDS1. Cette donnée, comme les précédentes, a été transmise à l’organisme à l’origine de la bague, posée en 2022. Parfois porteurs de balises, certains individus peuvent aussi être suivis en temps réel : carte Global Flyway Network

Spatule blanche NDS1 – photographiée par Gilles TRICHEUX le 15 mars 2025
Récemment, le code nasal B(O5WO) observé au niveau de l’étang Busard sur une Sarcelle d’hiver a indiqué un individu en provenance du Portugal (plus d’informations ici). Sa bague a été posée en 2021 à EVOA, dans la Réserve Naturelle de l’estuaire du Tage.

Sarcelle d’hiver, photographiée par François VIGNAUD à l’observatoire 17 en février 2025
Chez les barges à queue noire, un mâle bagué en Angleterre revient dans la Réserve chaque année depuis 2021. Sa bague a été posée par la Royal Society for the Protecion of Birds en 2021. Baptisé Halrar, il a été vu pour la première fois dans la Réserve en août 2021. Il fréquente souvent la lagune avocette en début de saison (observatoires 11 et 12), et également la zone Quancard. Souvent seul, il est arrivé blessé cette année.

Barge à queue noire Halrar, photographiée par Marc Weiss en janvier 2025
En 2024, un Pluvier argenté bagué en Guinée-Bissau ou encore un Bécasseau maubèche en provenance de Mauritanie ont pu être observés.

Bécasseau maubèche, photographié par Patrick DABE sur Grand large Est le 7 mai 2024
Depuis 2020, des centaines de données ont ainsi été collectées. Merci à Carmen qui, par son travail assidu, nous permet de les faire parler et de vous les partager !
Pour consulter le rapport rédigé par Carmen, cliquez ici :
Phénologie de migration des Spatules blanches
et valorisation de données de lecture de bagues
sur la Réserve Ornithologique du Teich
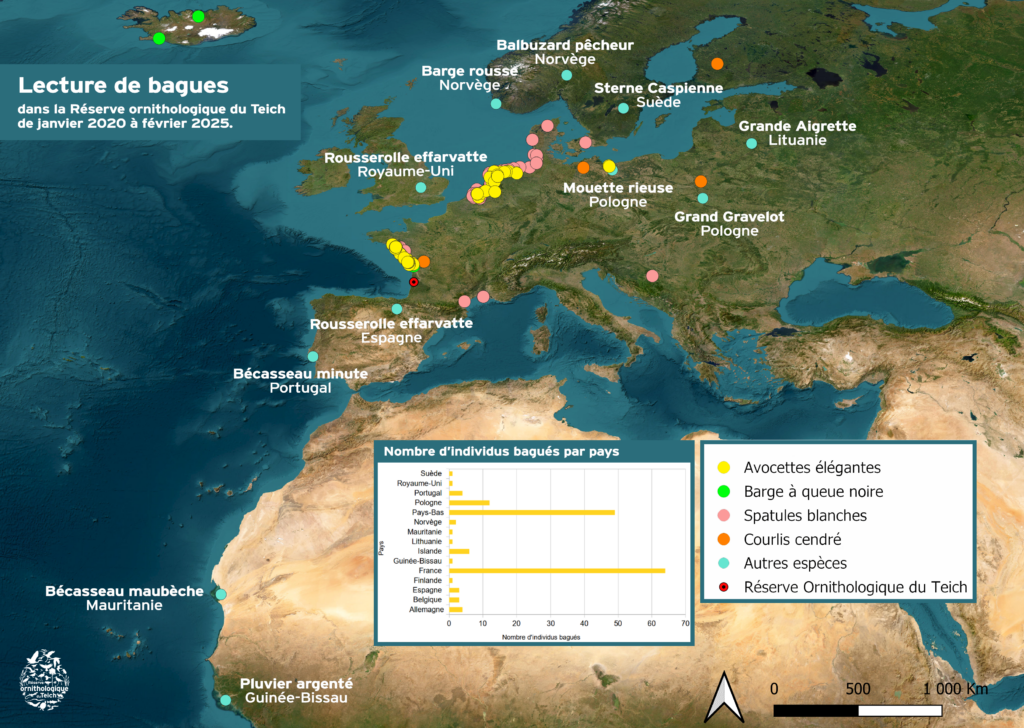
Vous avez observé et photographié un oiseau bagué dans la Réserve ?
Voici comment nous transmettre vos images : vos données
Les premières mouettes rieuses sont nées, du côté de l’observatoire 14. Avec plus de 30 nids occupés, pas facile de tenir à jour le calendrier des naissances ! Heureusement pour Carolanne et Juliette (chargées des suivis nidification cette année), des indices plutôt évidents permettent d’estimer l’âge des nouveau-nés.
🔹𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲 𝟭 𝗲𝘁 𝟯 𝗷𝗼𝘂𝗿𝘀 :
le poussin a du duvet et un petit « diamant » sur le bec, une sorte de dent qui facilite la sortie de la coquille.

🔹𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲 𝟰 𝗲𝘁 𝟲 𝗷𝗼𝘂𝗿𝘀 :
le duvet est toujours là, mais le diamant a disparu.

🔹𝗗𝗲 𝟳 𝗮̀ 𝟴 𝗷𝗼𝘂𝗿𝘀 :
les poussins commencent à muer au niveau du ventre.
🔹𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲 𝟵 𝗲𝘁 𝟭𝟰 𝗷𝗼𝘂𝗿𝘀 :
leur ventre devient de plus en plus blanc.

🔹𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲 𝟭𝟱 𝗲𝘁 𝟮𝟭 𝗷𝗼𝘂𝗿𝘀 :
des plumes brunes apparaissent.
🔹𝗔𝘂-𝗱𝗲𝗹𝗮̀ 𝗱𝗲 𝟮𝟭 𝗷𝗼𝘂𝗿𝘀 :
ils sont presque entièrement couverts de plumes.

Chez cette espèce, la femelle dépose chaque année 2 à 3 œufs dans le nid. L’incubation dure entre 22 et 26 jours. Semi-nidicoles, les petits restent exclusivement au nid pendant environ une semaine après leur naissance. Ils ne prendront leur envol définitif que vers l’âge de 32 à 35 jours.
Pour aller plus loin, voici les méthodes de suivi des oiseaux marins nicheurs du Groupement d’intérêt scientifique oiseaux marins (GISOM) :
👉 Méthodes de suivi des colonies d’oiseaux marins : dénombrement de l’effectif nicheur et suivi de la production en jeunes
📸 Couverture : Joël Chassin – 1. Marion Dal Bello – 2. Joël Chassin – 3. et 4. Guy David
De la rencontre de la Leyre avec le Bassin d’Arcachon naît un delta : une mosaïque de paysages naturels à explorer au travers et autour de la Réserve Ornithologique du Teich ! Peut-être connaissez-vous déjà le Bassin d’Arcachon et les panoramas que dévoilent la Réserve et le Sentier du littoral, mais avez-vous déjà exploré la “petite Amazone” et sa forêt-galerie ?
La Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon propose tout l’été des visites guidées en canoë collectif ou en kayak, ainsi que des kayaks en location libre ! En famille, en couple ou entre amis, venez voguer sous un dôme de feuillus et de pins, entre roselières, îlots et prés salés, jusqu’à ce que l’eau douce rencontre l’eau salée, à la découverte d’une zone humide paisible et préservée, au cœur de la nature sauvage.
Pour explorer ce trésor naturel à votre rythme et en toute autonomie, il est possible de louer des bateaux une, deux ou trois places :
🛶 𝗦𝗔𝗟𝗟𝗘𝗦 – 𝗟𝗘 𝗧𝗘𝗜𝗖𝗛
20 km, 5h, 27€/pers, 28€ pour un monoplace
Accueil à 8h45
🛶 𝗠𝗜𝗢𝗦 – 𝗟𝗘 𝗧𝗘𝗜𝗖𝗛
10 km, 2h à 3h, 21€/pers, 22€ pour un monoplace
Accueils à 9h00, 10h40 ou 12h55
🛶 PASS 2 ACTIVITÉS
Découverte de la Leyre et visite de la Réserve à pied, à un tarif avantageux !
– Visite libre de la réserve + descente libre de 20 km en canoë, de Salles au Teich : 32€ /adulte
– Visite libre de la réserve + descente libre de 10km en canoë, de Mios au Teich : 26€ /adulte
(enfants à partir de 6 ans)
ℹ️ 👉 Location en descente libre
Réservations possibles tous les jours du 1er juillet au 31 août.
Accueil et rdv à l’entrée de la Réserve Ornithologique du Teich.
📞 05 24 73 37 33
📧 maison-nature-canoe@parc-landes-de-gascogne.fr
Sur présentation d’un justificatif de domicile, les habitants du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne bénéficient d’un tarif réduit de 2 euros par personne sur les bateaux biplaces en location libre !
Campagne internationale de sensibilisation, la Journée mondiale des oiseaux migrateurs œuvre pour la protection des oiseaux et de leurs habitats. Chaque année, le deuxième samedi de mai célèbre le voyage retour des oiseaux vers leurs sites de nidification.
2025 met à l’honneur les espaces partagés pour « créer des villes et des communautés accueillantes pour les oiseaux. »
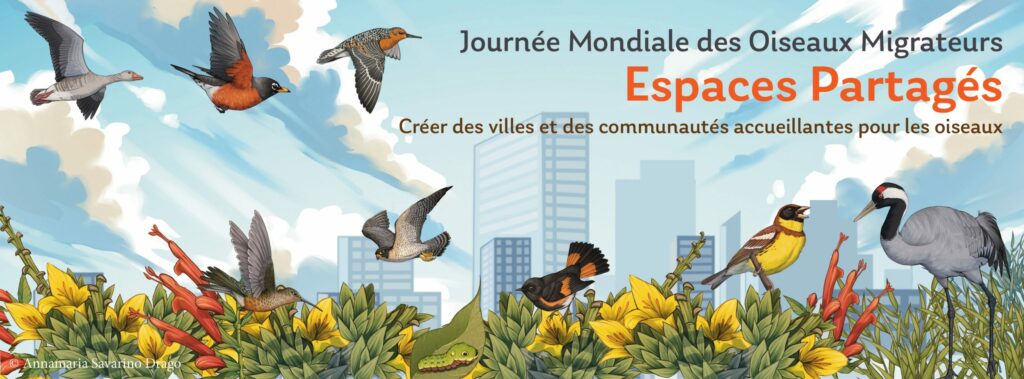
L’expansion des zones urbaines est porteuse de défis croissants pour les oiseaux migrateurs, qui voient les habitats naturels se réduire et la pollution sonore et lumineuse s’intensifier. Face à ce constat, la Journée mondiale des oiseaux migrateurs invite les communautés du monde entier à adopter des pratiques simples, pour rendre nos villes, nos écoles et nos jardins plus accueillants et plus sûrs pour les oiseaux.
Alors, par où commencer ?
🔹𝗥𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲 𝘃𝗶𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲𝘀 𝗹𝗲𝘀 𝗳𝗲𝗻𝗲̂𝘁𝗿𝗲𝘀.
Les surfaces vitrées peuvent faire croire aux oiseaux que le paysage continue. Pour prévenir les collisions, il est important de casser les reflets (installer des rideaux, coller des stickers, placer des objets à l’extérieur des fenêtres, etc.).
🔹 𝗣𝗿𝗼𝘁𝗲́𝗴𝗲𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝗶𝗻𝘀𝗲𝗰𝘁𝗲𝘀.
Soutenez l’agriculture biologique et évitez d’utiliser des pesticides et des produits chimiques, qui contribuent au déclin des papillons, libellules et autres insectes dont dépendent les oiseaux.
🔹 𝗣𝗿𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲́𝗴𝗶𝗲𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝗽𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗶𝗻𝗱𝗶𝗴𝗲̀𝗻𝗲𝘀.
Elles fournissent la nourriture et les abris dont les oiseaux ont besoin. Éliminez les plantes envahissantes et laissez des litières de feuilles se créer dans les jardins et dans les cours.
🔹 𝗜𝗻𝘃𝗶𝘁𝗲𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝗼𝗶𝘀𝗲𝗮𝘂𝘅 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝘀𝗼𝗻 𝗷𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻, en posant des nichoirs et des sources d’eau claire.
🔹 𝗘𝘁𝗲𝗶𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗹𝗲𝘀 𝗹𝘂𝗺𝗶𝗲̀𝗿𝗲𝘀.
La nuit, la lueur de nos villes et de nos maisons peut perturber le cycle de repos des oiseaux et avoir un impact négatif sur leur migration et leur reproduction.
🔹 𝗔𝘁𝘁𝗮𝗰𝗵𝗲𝗿 𝘀𝗲𝘀 𝗮𝗻𝗶𝗺𝗮𝘂𝘅 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗴𝗻𝗶𝗲.
En liberté, les chats et les chiens peuvent perturber, voire tuer, les oiseaux. Lors de vos balades, surveillez et tenez vos animaux en laisse. Dans vos jardins, délimitez pour eux des espaces dédiés.
🔹 𝗗𝗶𝗿𝗲 𝗲𝗻𝗳𝗶𝗻 𝗡𝗢𝗡 𝗮𝘂 𝗽𝗹𝗮𝘀𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲.
Selon les derniers chiffres des chercheurs du laboratoire de l’ILE et des experts de LPO, 90% des oiseaux marins sont intoxiqués par le plastique. Un chiffre qui pourrait frôler les 100% dès 2050.
Et bien sûr : passez le message !
Nous avons tous un rôle à jouer pour la survie des oiseaux.

Ce 10 mai, c’est aussi le GLOBAL BIG DAY : une initiative du Cornell Lab of Ornithology pour recenser un maximum d’espèces d’oiseaux à travers le monde en l’espace de 24h.
Pour participer, il suffit d’entrer vos observations du jour sur la plateforme eBird :
👉 eBird – Global Big Day
Les techniciens de la Réserve effectuent une mise en assec temporaire du Marais Cistude pour la réalisation de travaux de gestion. Pour limiter l’impact sur le milieu et sur les espèces, la mise en assec se fera de manière progressive :

Merci pour votre compréhension.

DU 21 AU 25 MAI 2025
Partez à la découverte des trésors naturels du Teich !
À l’occasion de la Fête de la Nature, la Réserve ornithologique du Teich et la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon invitent petits et grands à venir explorer les paysages et les trésors naturels du Bassin d’Arcachon, en compagnie de guides naturalistes passionnés. Voguer sur La Leyre guidés par les récits enchanteurs d’une conteuse, explorer la Réserve et le sentier du littoral, observer les oiseaux et s’émerveiller devant les naissances du printemps… Au mois de mai, rendez-vous au cœur de la vie sauvage du Teich !
Visite guidée, accueil naturaliste sur le sentier du littoral et balade contée en canoë collectif sont au programme de cette semaine de célébration. Animées par des guides de terrain, ces sorties offrent une rare proximité avec la biodiversité locale. Novices ou passionnés, curieux et amoureux de la nature sont invités à venir s’émerveiller devant la diversité des espèces et la spécificité des écosystèmes du Bassin d’Arcachon.
Balade contée en Canoë
vendredi 16 mai de 19h15 à 21h30
Embarquez pour une descente de la Leyre à bord d’un grand canoë collectif, accompagnés d’un guide naturaliste et d’une conteuse d’histoires.
Départ de la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon
GRATUIT – à partir de 6 ans.
Réservation obligatoire au 05 24 73 37 33
Visite guidée de la Réserve ornithologique pour les enfants de 7 à 10 ans
mercredi 21 mai de 14h00 à 16h30
Venez découvrir et observer les oiseaux qui nichent dans la Réserve au printemps !
Vous serez équipés de jumelles.
GRATUIT – tous les enfants doivent être accompagnés de leur(s) parent(s)
Réservation obligatoire au 05 24 73 37 33
Accueil naturaliste à la pointe du Teich
samedi 24 mai de 14h00 à 17h00
Un(e) guide naturaliste et sa longue-vue accueilleront les passants sur le sentier du littoral, à la pointe du Teich. Vous y découvrirez les oiseaux du moment et le cabinet de curiosités des animateurs de la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon.
GRATUIT – sans réservation
INFORMATIONS & RÉSERVATIONS :
maison-nature-canoe@parc-landes-de-gascogne.fr
Créée en 2017, la Journée Mondiale du Courlis célèbre chaque 21 avril les initiatives prises à travers le monde pour protéger les populations de Courlis.
Sur 9 espèces de courlis décrites dans le monde, 2 ont cessé d’exister en moins de 40 ans. En France, les populations de Courlis cendré ont diminué de 68% depuis 2001. Pourquoi un tel déclin ? Quelles études et quels programmes de sauvegarde sont en cours pour y faire face ?
On vous en dit plus dans ce dossier spécial :
👉 Journée mondiale du Courlis
Suite à plusieurs demandes d’identification du Busard des roseaux,
voici quelques éléments clés pour vous permettre de le reconnaître à coup sûr, sans le confondre avec le Milan noir !
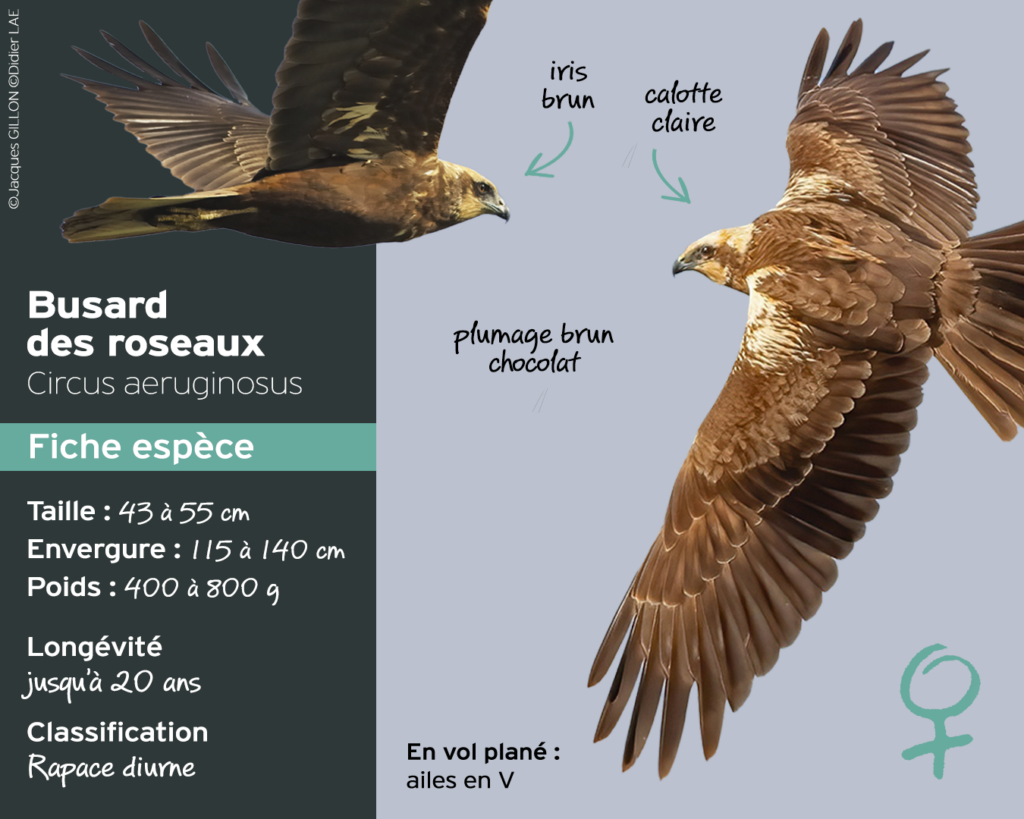

Généralement présent dans la Réserve du mois d’août au mois d’avril.
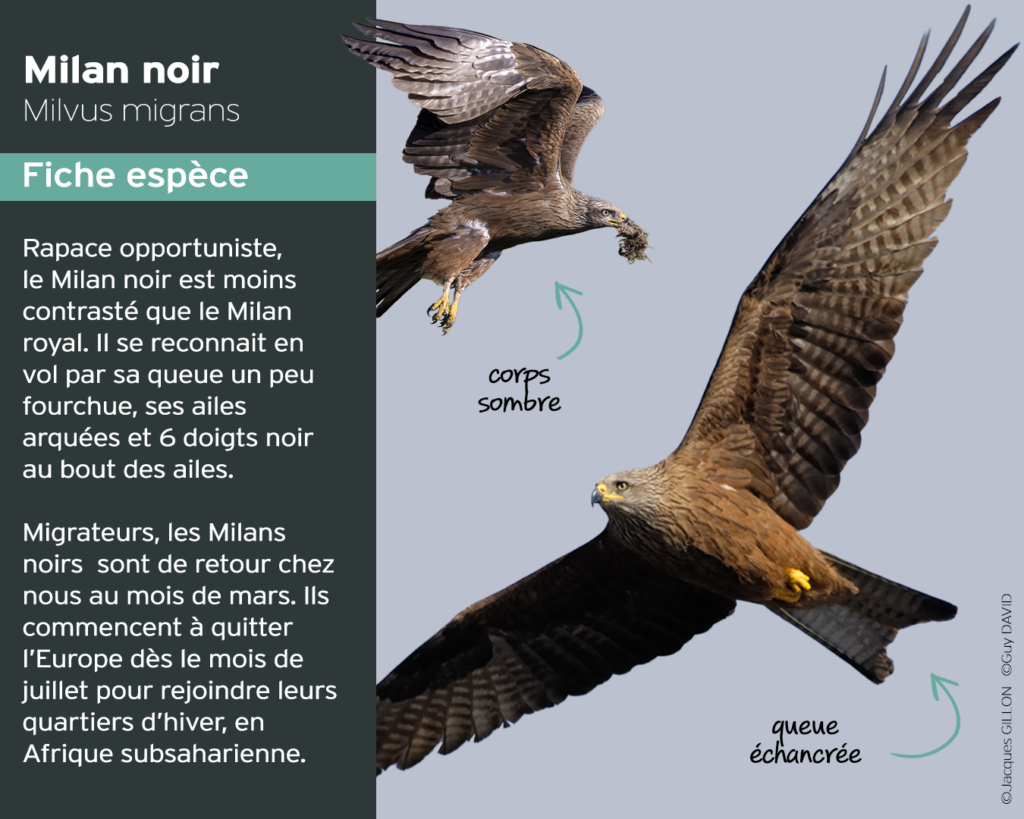
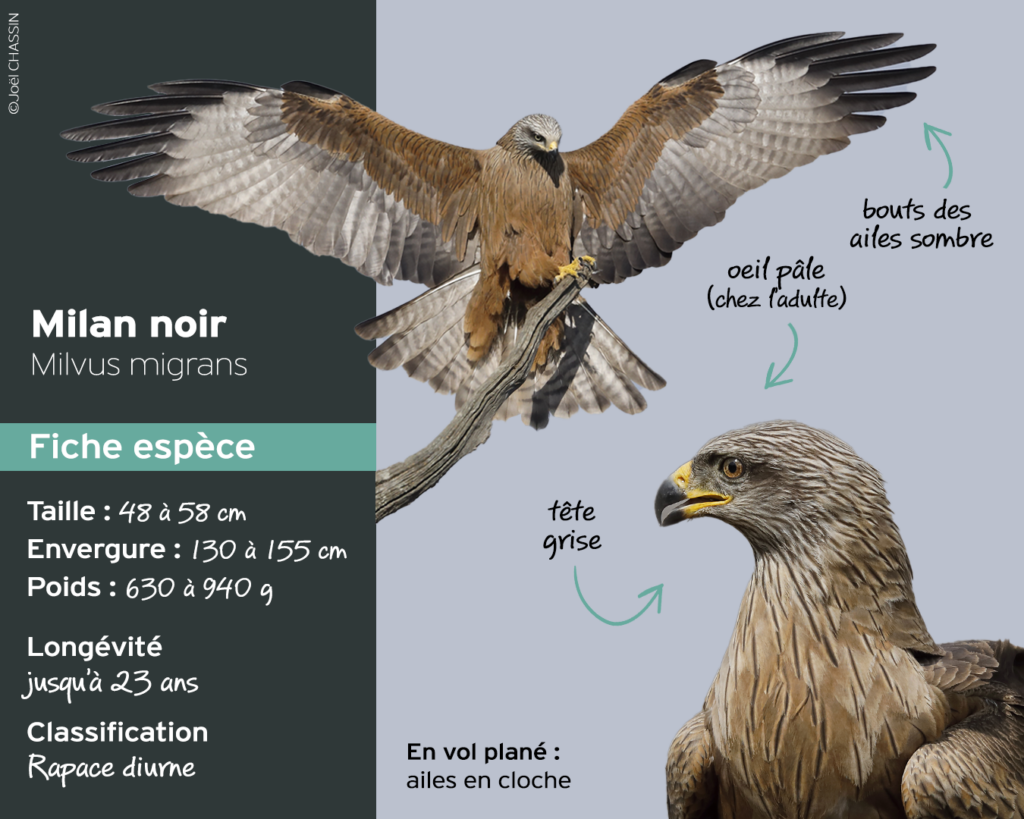
Généralement présent dans la Réserve de mars à août.
Merci aux photographes qui, par leurs images, nous ont permis de réaliser ces fiches :
📸 Joël CHASSIN, Didier LAE, Jacques GILLON, Guy DAVID, Alex Cooper, Piotr KRZESLAK
📚 Aujourd’hui, dans le petit glossaire du monde des oiseaux :
🖊️ Whiffling
Le « whiffling » est une technique spectaculaire utilisée en vol par certaines espèces d’oies, de canards ou de limicoles comme les chevaliers, les vanneaux ou les barges. En plein vol, l’oiseau se renverse brusquement, annulant la portance de ses ailes pour se laisser tomber. En se retournant, les oiseaux perdent rapidement de l’altitude, un peu comme si un avion faisait un piqué contrôlé. Ils utilisent l’aérodynamisme de leurs ailes pour descendre plus rapidement.
Souvent utilisé pour atterrir, le « whiffling » est aussi un moyen de déstabiliser d’éventuels prédateurs. En rendant leur trajectoire imprévisible, les oiseaux compliquent la tâche de leur agresseur. Dans un tout autre contexte, cette impressionnante manœuvre peut aussi servir à impressionner un potentiel partenaire lors des parades nuptiales.
🔎👉 Comment est-ce que ça fonctionne ?

📸 Jean-Paul GRAO
L’équipe de la Réserve ornithologique du Teich a entamé la semaine avec une immersion dans un nouveau décor :
la Réserve naturelle nationale des prés salés d’Arès et de Lège-Cap-Ferret !


Au nord du bassin d’Arcachon, entre Jane de Boy à Lège-Cap Ferret et le port ostréicole d’Arès, 330 hectares abritent une grande richesse floristique et des paysages composés d’un vaste pré salé, de dunes boisées, de prairies humides, de ripisylves (végétation bordant les cours d’eau) et d’un complexe endigué formé par d’anciens réservoirs à poissons.
Soumise à la double influence de l’eau salée et de l’eau douce arrivant des lacs médocains par le canal des étangs, cette Réserve Naturelle est une zone d’hivernage et de reproduction pour de nombreux oiseaux. 200 à 250 canards siffleurs hivernent chaque année sur le débouché du canal des étangs. Zone de halte pour les migrateurs, elle sert aussi de reposoir pour les oiseaux d’eau à marée haute.

Passerelle sur le canal des étangs


Ecluse de la digue
Recouverts d’eau, les prés salés se transforment en nourricerie pour de nombreuses espèces de poissons. À marée basse ou à mi-marée, ils représentent une importante zone de quiétude ou de chasse dans les esteys pour des mammifères tel que les loutres d’Europe. Derrière les digues, l’eau douce accueille d’autres espèces, comme la Cistude d’Europe.

Traces de Loutre d’Europe
Côté flore, les plantes qui composent les prés salés doivent supporter à la fois le recouvrement par les marées et la présence de sel dans l’eau et dans le sol. Avec 200 hectares de prés salés, la RNN des prés salés d’Arès et de Lège-Cap-Ferret abrite ici le plus vaste habitat du littoral aquitain pour les espèces halophiles. On y observe des espèces propres aux vasières, aux prés salés et aux zones de transition avec la dune. Toscart maritime, Obione ou encore Salicornes succèdent ainsi à la Romulée de Provence ou au Gazon d’Olympe. Sur le bassin d’Arcachon et en Nouvelle-Aquitaine, il n’y a qu’ici que vous rencontrerez le Troscart de Barrelier (ou Troscart des marais).



Troscart maritime

Troscart de Barrelier
En accès libre, les visiteurs peuvent parcourir la Réserve Naturelle en empruntant un réseau de sentiers balisés. Des visites guidées et de passionnants ateliers sont également organisés toute l’année par l’Office de tourisme d’Arès et l’Association Cap Termer.
Un grand merci à Benoît, Richard et Marie pour leur chaleureux accueil
et pour ce temps d’échange sur la gestion d’espaces naturels protégés !


Comptage des oiseaux depuis Jane de Boy
Pour plus d’infos sur la RNN des prés salés d’Arès et de Lège-Cap-Ferret :
👉 https://reserves-naturelles.org/reserves/pres-sales-dares-et-de-lege-cap-ferret/
Avec le printemps revient la Journée mondiale du Moineau !
Chaque année, le 20 mars est l’occasion de rappeler les menaces qui continuent de peser sur les populations de moineaux à travers le monde.
Que savez-vous vraiment des beaux passereaux que sont les moineaux ? Comment les reconnaître ? Comment les aider ? Quoi de neuf ces dernières années ?
Pour devenir incolable sur les moineaux de notre région, consultez et partagez notre dossier spécial :
🔎 Journée mondiale du Moineau

Moineau friquet, photographié par Joël CHASSIN
Photo en en-tête : Amandine SOYEZ
Le niveau d’eau de la zone Grand Large (observatoires 1, 2, 4, 5 et 7) est de nouveau plus bas que d’ordinaire.
Pourquoi ? Pour permettre aux échasses de s’y installer !
Souvenez-vous, plusieurs couples avaient jeté leur dévolu sur cette zone pour nicher l’an dernier.
La baisse des niveaux d’eau avait été très favorable à la dispersion des couples d’échasses blanches et à la survie des jeunes poussins.
➡️ Retrouvez ici le suivi détaillé réalisé par Amélie Garcia : Nidification 2024
Suite au succés de cette opération, les niveaux seront de nouveau baissés cette année.
L’objectif est de laisser à découvert les craquoys et bancs de sable pour que les oiseaux puissent s’y installer.
Rendez-vous dans les prochaines semaines pour suivre cette nouvelle saison de nidification !


Un nouveau concours photo démarre sur les sentiers de la Réserve !
Merci aux talentueux photographes qui, année après année, contribuent à faire connaître les oiseaux qui peuplent le site. Cette année, nous vous proposons de quitter un instant l’immensité du ciel pour nous concentrer sur un tout autre univers :

Équipés de téléphones ou d’appareils photo, embarquez pour un voyage vers une autre dimension. Zoomez entre les herbes, effleurez la surface de l’eau, cherchez la vie à vos pieds ou sur les branches pour changer d’échelle et explorer l’univers enchanteur du minuscule. Sur les sentiers de la Réserve, chaque pas nous rapproche d’un monde insoupçonné. Prenez le temps de le contempler et, si l’instant s’y prête, de le photographier !
Avez-vous déjà tenté de capturer la danse des demoiselles ? De saisir sur sa toile les multiples regards d’une araignée ? D’apercevoir les plumeaux des chironomes ou le mouvement des antennes d’une fourmis ? Avez-vous observé les ocelles d’une abeille, le cœur d’une fleur, la larve d’une libellule, la texture délicate des ailes d’un papillon ou les courbes d’un lichen ?
Accroupis au bord d’un chemin, penchés sur les perles de rosée près des fleurs sauvages, au détour d’un buisson, sur les arbres ou près des observatoires, le nez en l’air ou sur la pointe des pieds, laissez-vous émerveiller par les moindres détails.
Végétaux, insectes, minéraux … tout ce qui est petit est permis !
Les photos sélectionnées seront exposées en 2026 sur les sentiers de la Réserve.
Vous avez jusqu’au 15 décembre 2025 pour nous les envoyer.
12 lauréats et lauréates seront retenus.
Une carte cadeau leur sera remise, pour choisir la récompense de leur choix à la Boutique de l’Oiseau !
Comment participer ?
Envoyez vos clichés à cette adresse en précisant la date et le lieu de la prise de vue (photographies prises dans la Réserve uniquement) :
📧 photosabonnes.rot@gmail.com
Pensez à accompagner vos messages de la mention suivante :
“©J’autorise la Réserve Ornithologique du Teich à diffuser les photographies ci-jointes sur support print ou digital, sous réserve que mon nom soit crédité.”
Le règlement du concours est à retrouver ici :
Concours Photo 2025
Bonne exploration à tous !
📚 Aujourd’hui, dans le petit glossaire du monde des oiseaux :
❤️ Pour cette Saint-Valentin, nous vous proposons de découvrir ensemble
la fascinante stratégie de séduction de certaines espèces d’oiseaux : le « lek » !

Mot d’origine suédoise (de « leka » qui signifie jouer), le lek désigne l’espace sur lequel une population d’oiseaux vient parader et s’accoupler. Il peut s’agir d’un terrain dégagé, d’une petite clairière ou de tout espace où les oiseaux peuvent se regrouper sans obstacles. Les mâles se rassemblent et paradent sur cette forme d’arène pour séduire les femelles.
Les rassemblements ont lieu quotidiennement pendant la saison de reproduction. Les mâles reprennent chaque jour leur position dans l’arène pour y défendre un petit territoire. Chacun y exhibe son plumage, ses talents de danseur et ses capacités vocales. Les zones les plus centrales étant généralement les plus convoitées, on y trouve les mâles dominants, avec qui les femelles se reproduisent en priorité. Un très petit nombre de mâles peut ainsi s’accoupler avec la majorité des femelles.
Après l’accouplement, les femelles quittent le lek pour s’occuper seules de la ponte et de l’élevage des jeunes. Les mâles, eux, continuent de parader pour féconder d’autres femelles.
Souvent associé au Tétras Lyre ou au Grand Tétras, ce comportement se retrouve également chez certaines espèces de Paradisiers, de Manakins ou chez le Combattant varié.

En permettant aux femelles de trouver plusieurs mâles au même endroit, le lek facilite le choix du partenaire et diminue le risque de prédation pour les femelles, qui n’ont pas à effectuer de longs déplacements. Bien qu’il permette la diffusion génétique, ce comportement reste énergivore pour les mâles. Pour ceux qui ne parviennent pas à séduire de femelles, il peut représenter une perte de ressources considérable. Un tel rassemblement comporte aussi des risques. Concentrés en un seul endroit, mâles et femelles s’exposent davantage aux prédateurs ou à d’éventuelles maladies.
Une étude américaine publiée en décembre 2024 a toutefois démontré l’efficacité du lek sur le plan de l’évolution. Après avoir étudié les données de plus de 6600 espèces d’oiseaux, les chercheurs Rafael Marcondes et Nicolette Douvas ont souligné la stabilité de cette stratégie au fil du temps : 👉 https://bit.ly/4guJbHS
Chez certaines espèces, comme l’Outarde canepetière, on parle de « lek éclaté. » Les mâles sont plus dispersés, ils ne se regroupent pas en arène mais sont suffisamment proches pour que les femelles puissent entendre leurs vocalisations.
POUR ALLER PLUS LOIN
QUELQUES EXEMPLES EN VIDEOS

Une 7e édition sous le signe des relations, des liens et des interdépendances qui tissent et définissent le vivant
Ces relations sont bien plus qu’une simple coexistence : elles tissent le vivant. Passer en revue les relations et les interdépendances des vivants entre eux nous mènera à évoquer la pollinisation, les symbioses, le parasitisme, la chaîne alimentaire, l’organisation sociale des groupes, la communication…
En résumé, ce maillage, ces interactions de tout ordre, définissent les écosystèmes. Explorer ces connexions, c’est aussi interroger notre rapport au vivant : elles nous rappellent que nous sommes une espèce parmi tant d’autres.
Rejoignez-nous à la Halle du Port, au Teich, pour participer aux balades nature ou contées, pour déambuler dans les expositions et rencontrer les acteur.rice.s de la préservation du vivant, pour écouter des spécialistes ou regarder des documentaires animaliers puis échanger avec leurs réalisateur.rice.s.
Ce Festival est issu d’un partenariat avec le Festival International du Film Ornithologique de Ménigoute pour la programmation des films et avec la Mairie du Teich pour la logistique matérielle.
Bon festival à tous !
NB : Toutes les activités proposées dans le cadre du festival sont gratuites. Certaines supposent néanmoins de s’inscrire au préalable. Les pré-inscriptions seront ouvertes en mars.
Vous n’avez pas eu le temps de vous pré-inscrire ? Venez quand-même nous voir, des places restent disponibles sur inscription à l’accueil du festival (10h-18h) !
𝐋𝐞 𝐭𝐡𝐞̀𝐦𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓 : « 𝐕𝐢𝐯𝐚𝐧𝐭𝐬 𝐞𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 »
La vie est un tissu de relations, aucune espèce n’évolue déconnectée des autres. Ce réseau constitue les écosystèmes et permet à chacun d’être vivant. Symbiose, mutualisme, compétition, alimentation…cette année, venez illustrer la palette des relations qui constituent la vie !
ℹ️ Les détails du concours, les prix, le règlement et les conditions de participation sont ici :
👉 www.territoires-sauvages.fr/concours-photo
Vous avez jusqu’au 9 mars pour déposer vos photos.
Bonne chance à tous !

L’équipe de la Réserve ornithologique du Teich est heureuse de convier les visiteurs abonnés à un temps d’échange et de rencontre le samedi 5 avril 2025 à 17h à la salle multimédia (à l’entrée de la réserve).
Vous avez un abonnement en cours de validité ?
Venez à la rencontre des gestionnaires du site et de votre communauté de fidèles amoureux des oiseaux !
Un échange privilégié pour en apprendre davantage sur le fonctionnement de la Réserve ornithologique, son évolution, ses projets pour 2025, mais aussi sur les suivis scientifiques en cours et les dernières actualités des oiseaux.
La présentation sera suivie d’un temps de questions/réponses.
Un pot amical vous sera offert.
Vous souhaitez aborder un sujet en particulier ?
Faites-le-nous savoir !
Pour répondre au mieux à vos demandes d’informations, nous vous proposons (que vous soyez présents le jour J ou non*) de soumettre vos suggestions via le lien d’inscription à la rencontre :
Les gestionnaires de la Réserve vont entamer les travaux prévus sur la lagune avocette. Après plusieurs semaines à découvert, l’îlot principal de la lagune va être remodelé et restauré pour le rendre plus favorable à la nidification des laro-limicoles.
🌿Des opérations de gestion de la végétation (lutte contre le baccharis) ont également été menées sur le sentier entre l’observatoire 10 et 11. Des aplats de vase vont maintenant être posés pour favoriser la végétation des prés-salés, plus adaptées à l’alimenation de la Gorgebleue à miroir. Du côté de l’observatoire 10, les îlots de la vasière spatule vont également être restructurés.
Pour toutes visites entre le 27 janvier et le 7 février, privilégiez les autres zones d’observation la Réserve.
Merci pour votre compréhension.
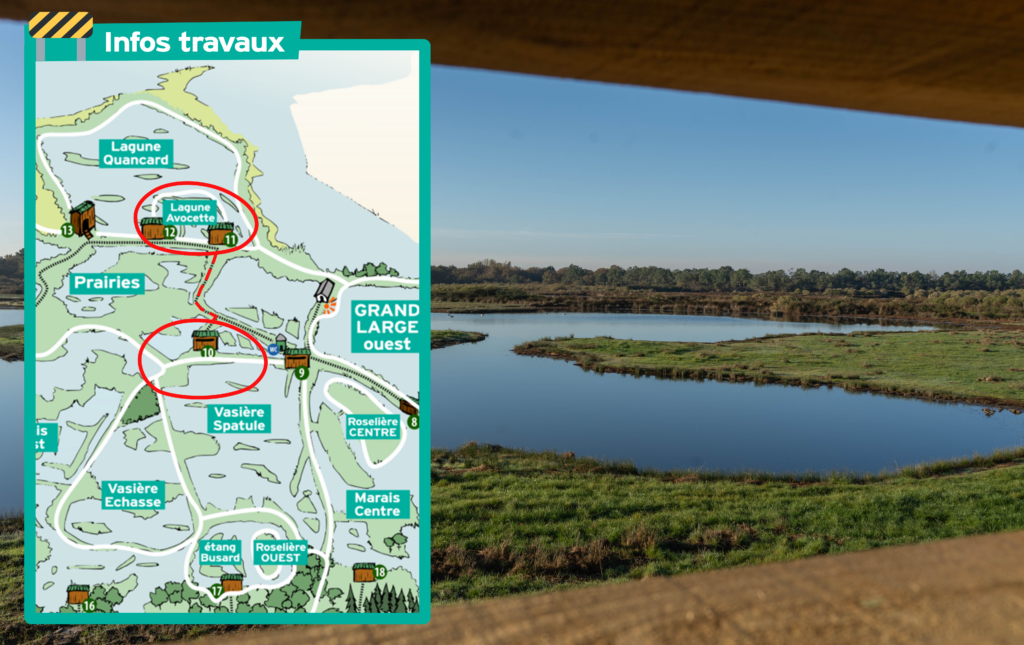
Une discrète cabane, des vitres sans tain, un bac d’eau peu profond agrémenté d’un peu de végétation… quel est donc ce nouvel aménagement ?
Imaginée et fabriquée par les élèves du Lycée de la mer de Gujan-Mestras, c’est une drink station ! Une installation qui permettra à tous les passionnés d’observer et de photographier les passereaux à moins de cinq mètres, sans jamais les déranger.
Au-delà des chances d’observation qu’elle offre aux visiteurs de la Réserve, la drink station rend service à la faune sauvage pendant les périodes difficiles. Elle sert de mangeoire en hiver (au plus tard jusqu’à début mars) et d’abreuvoir en été. Sa faible hauteur d’eau contribue à un rituel indispensable dans la vie quotidienne des oiseaux : le bain. Se baigner permet aux oiseaux de garder un plumage propre tout en se débarrassant de certains parasites.
De par sa configuration particulière et sa proximité avec la faune, la drink station doit respecter des règles plus strictes que les autres observatoires. Pour les animaux et pour votre confort d’observation, le calme et le silence doivent y être rois. Nous vous demandons de rester le plus silencieux possible et de ne pas faire de mouvements brusques à l’approche et à l’intérieur de la cabane.
Belle découverte à tous !
👉 liste des passereaux visibles dans la Réserve ornithologique du Teich
ℹ️ La Drink Station ne se privatise pas, elle est ouverte à tous les visiteurs de la Réserve de la même manière que les 20 autres observatoires. Un abonnement est nécessaire pour en profiter sur les horaires d’ouvertue anticipée : visiteurs abonnés.
📷 Il est tout à fait possible de faire des photographies de qualité au travers des vitres sans tain. Attention toutefois à ce que vos objectifs ne touchent pas les vitres. Cet observatoire n’a pas été conçu spécifiquement pour la photographie, c’est avant un outil de médiation pédagogique.
⚠️ Dans l’observatoire, pensez aux autres visiteurs : restez le plus silencieux possible et ne pas monopolisez pas les lieux.
A savoir :
Dans l’objectif d’éviter tout danger pour les oiseaux, la structure a été pensée suite à des recherches approfondies et de très nombreux retours d’expérience. L’emplacement de la drink station a notamment fait l’objet de longues réflexions. Pour éviter que les oiseaux ne viennent percuter les vitres, il a été décidé d’installer le bassin dans un sous-bois buissonnant, loin de tout couloir de déplacement.
Actuellement, des graines posées au bout du bassin concentrent l’attention des oiseaux qui se déplacent de branche en branche dans le sous-bois et ne sont pas attirés par les vitres. Le risque de collision reste tout de même surveillé de près par les techniciens de la Réserve, qui (en plus de bandes horizontales à l’extérieur des vitres) vont installer une avancée en bois au-dessus des vitres pour venir casser la ligne d’horizon et diminuer le reflet.
Comme toute nouveauté, cet outil pédagogique demande à être testé et adapté.
L’équipe de la Réserve prendra en compte les retours constructifs de chacun.


Écureuil roux à la Drink Station ©Joris Grenon


UN AN DANS LA VIE D’UN OISEAU
Chaque année voit se redessiner les grandes lignes d’un récit jalonné d’événements successifs, plus ou moins communs à toutes les espèces d’oiseaux : migration, formation des couples, reproduction, élevage et envol des oisillons, mue, hivernage… Nous vous proposons de découvrir ici, mois après mois, les diverses étapes du cycle annuel des oiseaux de la Réserve !
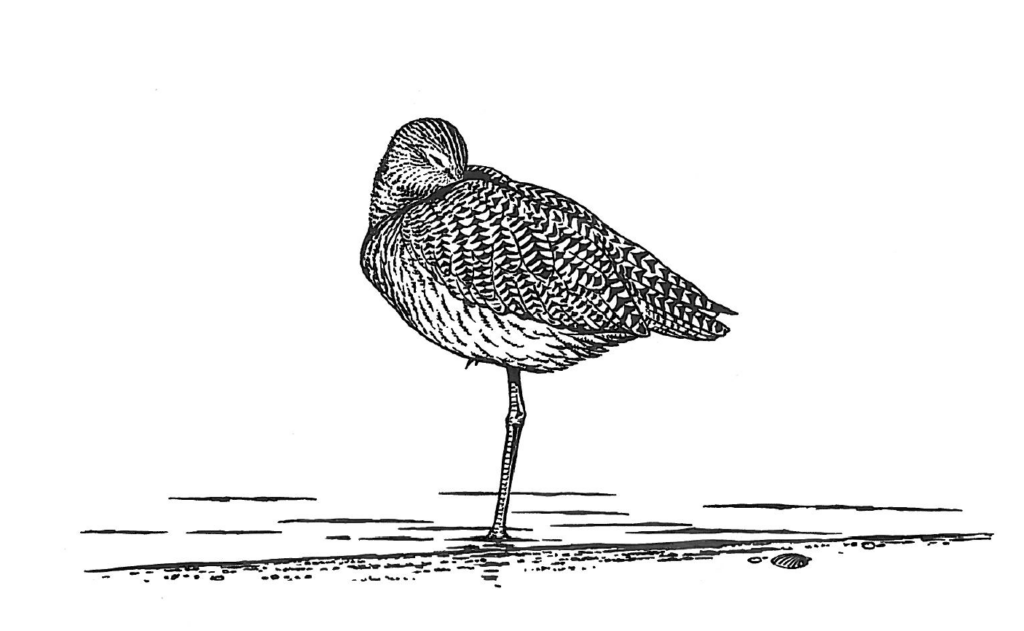
Considéré comme le cœur de l’hiver, le mois de janvier est une période cruciale pour les oiseaux. La plupart des espèces limitent leurs mouvements migratoires et se concentrent sur une tâche essentielle : faire face au froid. Le défi est de taille pour les oiseaux qui, chaque jour, doivent à la fois économiser leur force et compenser les pertes caloriques engendrées par les basses températures. Où trouver les calories suffisantes pour leurs besoins énergétiques ? Comment empêcher la chaleur corporelle de s’échapper ? Comment anticiper la migration à venir ?
Pour maintenir le fragile équilibre qui les maintient en vie, tous consacrent l’essentiel des journées froides à l’entretien de leur plumage et à la recherche de nourriture.
Le plumage, un véritable manteau
Le plumage est la principale protection des oiseaux contre le froid. Il piège l’air chaud près de la peau pour créer une isolation efficace. En hiver, les oiseaux développent un plumage plus épais, adapté aux températures plus froides. En plus de réfléchir la lumière pour éviter la surchauffe en plein soleil dans un environnement enneigé, les plumes blanches offrent aux oiseaux comme le Lagopède alpin un camouflage dans la neige. Les plumes foncées, en revanche, absorbent plus de chaleur en captant davantage la lumière du soleil, ce qui peut être avantageux dans un environnement froid, où la lumière du soleil est limitée.

Au-delà des plumes, des comportements tels que l’orientation face au vent ou le positionnement d’une patte sous le plumage permettent aussi de limiter les pertes thermiques. Se placer face au vent empêche le froid de s’infiltrer « à rebrousse-plumes. » Cachée sous le plumage, la patte relevée de l’oiseau endormi offre une autre économie de chaleur. Au moins une de ses deux pattes est maintenue à bonne température. De même pour le bec, lui aussi dépourvu de plumes. Niché sous l’aile de l’oiseau qui se repose, il conserve de précieuses calories en réchauffant l’air inspiré.

Les réserves adipeuses
Sous leur plumage, les oiseaux stockent de la graisse. Elle sert à la fois d’isolant thermique et de réserve d’énergie. Ces réserves sont particulièrement importantes pour les espèces aquatiques comme les Canards, exposés à des pertes thermiques accrues au contact de l’eau froide.
Pour éviter l’hypothermie, les oiseaux ont dans les pattes un échangeur thermique digne des plus grands ingénieurs. Pour limiter la déperdition de chaleur du sang circulant au niveau de la peau, les vaisseaux qui le conduisent vers les pattes de l’oiseau sont en contact avec ceux qui remontent vers le cœur. Le sang qui descend est ainsi refroidi par celui qui remonte. Le sang qui remonte est réchauffé par celui qui descend. Cet échange à contre-courant permet de mieux préserver la chaleur.
Pour vivre mieux, vivons nombreux
Plus facile à observer, se rassembler permet aux oiseaux de profiter de la chaleur du groupe. C’est, par exemple, la stratégie adoptée par les étourneaux en hiver. Sur l’eau, de nombreux limicoles en sont aussi arrivés aux mêmes conclusions. (voir notre article : “Pourquoi former des dortoirs ?”)

Les règles de Bergmann et Allen
Au 19ème siècle, Carl Bergmann a émis l’hypothèse que les animaux à sang chaud avaient tendance à être plus grands dans les régions froides que leurs congénères plus éloignés des pôles. Lié à l’efficacité de la thermorégulation, ce phénomène indique que les individus de plus grande taille sont favorisés par la sélection naturelle dans les régions froides (moins de risque d’hypothermie) alors que les individus plus petits le sont dans les régions chaudes (moins de mortalité liée à de fortes chaleurs). Sur une même durée et dans les mêmes conditions climatiques, un grand oiseau perd moins de chaleur qu’un oiseau plus petit. Ainsi, plus on s’approche du nord plus les Merles noirs ou Moineaux domestiques du Royaume-Unis seront massifs (Duncan McCollin, 2015). À l’inverse, mais dans un même souci d’économie de chaleur, la règle d’Allen stipule que les animaux des milieux froids ont des appendices (queue, bec, oreille…) plus courts que leurs congénères des milieux plus chauds.
Encore peu observées dans nos régions tempérées, ces différences pourraient être de plus en plus marquées au fur et à mesure que le climat se réchauffe. Les études des prochaines années s’efforceront de confirmer ou non cette hypothèse.
Nourrir les oiseaux de manière responsable
En période de froid prolongé, un apport alimentaire peut être vital pour les oiseaux. Attention toutefois à ne pas les rendre dépendants et à leur offrir des aliments appropriés.
Les bons aliments
– Graisses végétales mélangées à des graines
– Graines de tournesol (très riches en lipides), millet, avoine, chènevis…
– Fruits frais (pommes, poires) et fruits secs non salés (noisettes, noix fraîches)
– Cacahuètes non grillées et non salées
– Des coupelles d’eau propre, indispensables pour boire et entretenir le plumage
Les aliments à éviter
– Pain, biscottes, pâtisseries qui gonflent dans l’estomac
– Tous produits salés ou riches en sucre
– Pas de lait
– Pas d’insectes
À regarder : 👉 Nourrir au jardin, attention aux mauvaises pratiques !
Ne surtout pas déranger
Pour survivre, les oiseaux doivent économiser la moindre calorie. Faire s’envoler un groupe de limicoles sur une plage en hiver revient à leur faire gaspiller une quantité d’énergie difficile à retrouver. Un oiseau qui n’a plus assez d’énergie pour trouver la nourriture nécessaire au maintien de sa température corporelle verra immédiatement ses chances de survie compromises.
L’hiver est une période décisive pour les oiseaux. Seuls survivent ceux qui réussissent à maintenir leur poids et préserver leurs forces. Perturber leur hivernage compromet leur capacité à constituer des réserves vitales.
La période qui précède la migration prénuptiale doit permettre aux oiseaux hivernants d’accumuler assez de calories pour rejoindre les sites de nidification. Le voyage étant bien souvent long et périlleux, l’oiseau doit, là encore, ménager ses efforts. C’est d’autant plus vrai pour certaines espèces, comme l’Avocette élégante, dont les couples peuvent se former sur les sites d’hivernage.

Pour une approche respectueuse :
– Maintenez une distance suffisante entre vous et les oiseaux dans les espaces naturels.
– Évitez tout bruit ou geste brusque.
– Respectez les zones de quiétude réservées aux oiseaux.
Si l’hiver est une épreuve pour les oiseaux, c’est aussi l’occasion pour nous de les observer et de les aider sans les déranger. Offrir une nourriture adaptée, proposer des conditions favorables à l’entretien de leur plumage et respecter leur tranquillité sont des gestes simples mais précieux. Parlez-en autour de vous !
EN CE MOMENT :
Relevez le défi de la LPO Aquitaine ‘Bien nourrir les oiseaux, ça ne mange pas de pain‘
POUR ALLER PLUS LOIN :
Planet Vie – Régulation ultradienne de la température corporelle chez les oiseaux
CNRS – La régulation ultradienne de la température corporelle : un nouveau mécanisme d’économie d’énergie chez les oiseaux face aux contraintes environnementales
MNHN – Ces espèces qui rétrécissent avec le changement climatique
Le Monde – Les oiseaux rétrécissent au fur et à mesure que le climat se réchauffe
GEO – Certains animaux modifient la taille de leurs appendices pour faire face au changement climatique
CRBPO – Les passereaux communs sont plus grands les années chaudes
Sciencepost – Une étude sur les dinosaures remet en question la règle de Bergmann
MNHN – Faut-il nourrir les oiseaux en hiver ?
LPO – Quand et comment nourrir les oiseaux en hiver ?
LPO – Nourrir au jardin, attention aux mauvaises pratiques !
Ornithomedia – Quand faut-il arrêter de nourrir les oiseaux en hiver ?
Ornithomedia – Quelques adaptations des oiseaux pour supporter le froid
Commission Ornithologique de Watermael-Boitsfort – Les adaptations des oiseaux pour supporter le froid
Ornithomedia – Quelques conseils simples pour partager les plages avec les oiseaux
Pour la science : des oiseaux pas manchots en maths


La Journée mondiale des Zones Humides
Chaque 2 février, la Journée mondiale des Zones Humides commémore l’adoption de la Convention de Ramsar, un traité international servant de cadre à la conservation des zones humides. Associations et organismes du monde entier se mobilisent pour partager avec le plus grand nombre leur connaissance de ces milieux aussi fragiles qu’indispensables. Des sorties et des rencontres sont proposées partout en France. Rendez-vous ici pour découvrir celles près de chez vous :
📅 jagispourlanature.org
❝ Zone humide protégée par la convention Ramsar depuis le 27 octobre 2011, le delta de la Leyre fait l’objet d’un programme de gestion encadré par le PNR des Landes de Gascogne, en coordination avec les acteurs locaux, dont la Réserve ornithologique du Teich. A l’interface entre les eaux douces du bassin versant de la Leyre et les eaux salées de l’océan Atlantique, il forme une mosaïque de prairies et de boisements inondables, d’espaces endigués, de roselières, de prés salés, mais aussi de bancs sableux et de vasières sillonnés de nombreux chenaux. Cette diversité d’habitats offre des conditions favorables à l’accueil d’un très grand nombre d’espèces. ❞
Pour la deuxième année consécutive, les odonates ont été traqués dans la Réserve ! Attrapés parfois, zieutés de près souvent, identifiés minutieusement, photographiés avec précision et, bien évidemment, relâchés en pleine forme, ils ont comme l’an passé été étudiés avec la méthodologie du protocole STELI.
Malgré une année particulièrement pluvieuse et un mois de mai sans la moindre journée de suivi, les résultats sont intéressants. La promotion 2024 affiche 5 espèces non contactées en 2023. 21 espèces ont été identifiées, contre 16 en 2023.
Si le Sympétrum vulgaire (sur la liste rouge française des odonates) n’a pas été revu cette année, des espèces comme le Pennipatte blanchâtre ou le Crocothémis écarlate sont venu grossir le rang des espèces recensées sur le site.
Pour poursuivre sur le sujet, nous vous invitons à consulter le Plan National d’Action 2020-2030 en faveur des libellules ainsi que les listes rouges des libellules de France et de la région Nouvelle-Aquitaine :

Aeschne affine ©Joris Grenon

Crocothémis écarlate ©Joris Grenon

Pennipatte blanchâtre ©Joris Grenon

La Réserve ornithologique du Teich vous souhaite une année riche en découvertes !
Merci d’être toujours plus nombreux à suivre et relayer nos actualités. Plus que jamais, les oiseaux ont besoin d’être choyés. Merci de nous aider à faire connaître et protéger le vivant autour de nous. En 2025, continuons d’observer, apprendre et partager.
À bientôt sur nos sentiers !
📸 Carte de voeux réalisée par Mathilde BERNASCONI (disponible à la Boutique de l’Oiseau)
📚 Aujourd’hui, dans le petit glossaire du monde des oiseaux :
🖊️ 𝗚𝘆𝗻𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼𝗺𝗼𝗿𝗽𝗵𝗶𝘀𝗺𝗲
Le “gynandromorphisme bilatéral” se traduit chez les animaux par un corps divisé en deux : une moitié est mâle, l’autre est femelle. Ce phénomène rare et fascinant a pu être observé chez certaines espèces d’oiseaux, de papillons, d’araignées, de lézards ou de crustacés.
Chez les individus qui présentent un fort dimorphisme sexuel (différences morphologiques entre mâles et femelles), le gynandromorphisme est particulièrement flagrant.
Quelle différence avec l’hermaphrodisme ? Le gynandromorphisme est une coexistence permanente des deux sexes au sein d’un même corps. Chez les oiseaux, cela résulte d’une anomalie génétique particulièrement rare pendant la fécondation. Alors que les individus hermaphrodites sont capables de passer d’un genre à l’autre en fonction des circonstances et des besoins, les gynandromorphes présenteront toute leur vie une moitié mâle et l’autre femelle.
Il existe également une autre variante : le gynandromorphisme en mosaïque. Celui-ci affecte l’organisme de manière aléatoire, avec des zones féminines et masculines moins symétriques. Il n’est pas impossible que, selon la répartition des parties mâles ou femelles, certains individus puissent se reproduire, à condition bien sûr que leur allure singulière n’affecte pas leur recherche de partenaire.
Pour aller plus loin :
🎬 Tangara émeraude (Chlorophanes spiza), observé en 2023 par John Murillo au sud de Manizales, en Colombie :
Les animateurs de la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon (antenne du PNR Landes de Gascogne) vous invitent à plonger au cœur des réserves naturelles de la région pour partir à l’affût des majestueuses Grues cendrées :
🩶 𝗔̀ 𝗖𝗮𝗽𝘁𝗶𝗲𝘂𝘅, 𝗹𝗲 𝟭𝟵 𝗷𝗮𝗻𝘃𝗶𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟱
Venez observer les dames grises à l’affût en compagnie d’un guide naturaliste. Toilette, parade, quête alimentaire et autres gestuelles pourront être observées à la longue-vue, sans manquer le retour sur les zones de dortoir à la tombée du jour. Un encas à partager sera l’occasion d’une pause durant cet après-midi de découverte.
🔸De 14h à 18h30, maximum 15 personnes
🔸20€/adulte, 13€/enfant, avec goûter offert et prêt de matériel d’observation
🔸Réservation au 05 24 733 733
🩶 𝗔𝘂 𝗧𝗲𝗶𝗰𝗵, 𝗹𝗲𝘀 𝟮𝟰, 𝟮𝟱 𝗲𝘁 𝟮𝟲 𝗝𝗮𝗻𝘃𝗶𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟱
Entre littoral et landes humides, embarquez pour un voyage ornithologique placé sous le signe de la diversité des habitats traversés et des espèces observées. Des landes aux lagunes saumâtres en passant par les rivages marins, vous partirez à la rencontre des emblématiques Grues cendrées et Bernaches cravants à ventre sombre. Vous découvrirez l’exceptionnelle diversité des limicoles hivernants du bassin d’Arcachon et scruterez la mer à la recherche d’oiseaux marins poussés par le vent du Nord (plongeons, grèbes, laridés). Accompagné d’un animateur naturaliste du Parc Naturel Régional, vous prendrez pour 2 nuits vos quartiers d’hiver à la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon, au cœur de la Réserve Ornithologique du Teich !
🔸+ d’infos en page 13 : Découvrir le programme !
UN AN DANS LA VIE D’UN OISEAU
Chaque année voit se redessiner les grandes lignes d’un récit jalonné d’événements successifs, plus ou moins communs à toutes les espèces d’oiseaux : migration, formation des couples, reproduction, élevage et envol des oisillons, mue, hivernage… Nous vous proposons de découvrir ici, mois après mois, les diverses étapes du cycle annuel des oiseaux de la Réserve !
L’arrivée de l’hiver est une période difficile pour les oiseaux qui voient les journées raccourcir et les nuits s’allonger. Lors des nuits les plus froides, les petits passereaux comme les mésanges peuvent perdre jusqu’à 10% de leur masse corporelle. Alors que les ressources se raréfient ou deviennent moins accessibles, comment les oiseaux font-ils pour subvenir à leurs besoins alimentaires ?
Des baies
Certains arbrisseaux conservent leurs fruits jusqu’à tard dans la saison. Ce sont pour les oiseaux de précieuses sources de nutriments. Dans la réserve, les oiseaux peuvent profiter de la présence de mûres jusqu’en octobre. Ils passeront ensuite aux prunelles des prunelliers, qui sont un véritable cocktail d’antioxydants et de vitamine C. Il en va de même pour les cynorrhodons, ces petites baies rouges de l’églantier, ou pour les fruits de l’aubépine ou du houx. Plus tard dans la saison, ce sont les fruits particulièrement tardifs du lierre qui viendront offrir un répit alimentaire crucial pour les oiseaux frugivores.






Des Graines
Certaines plantes conservent leurs graines longtemps après le début de l’hiver, malgré les premières gelées. Le Chardonneret élégant tire par exemple une partie de ses ressources des graines des chardons ou de cardères. Si les graines viennent à manquer, certains oiseaux sont aussi capables de se tourner vers des bourgeons floraux comme ceux de l’aulne ou du pin, également riches en nutriments.

Les invertébrés : une ressource inestimable
Bien que moins abondants, les invertébrés continuent de jouer un rôle clé dans l’alimentation de nombreux oiseaux à la saison froide. La Mésange charbonnière modifie par exemple sa méthode de chasse : au lieu de capturer des insectes visibles dans la végétation, elle est notamment capable de trouver les larves, pupes ou chrysalides cachées en hiver dans les tiges creuses des roseaux. Les invertébrés aquatiques, comme les larves d’insectes, restent également accessibles, même sous de minces couches de glace. Certaines araignées s’activent également lors des radoucissement de température. Une aubaine pour des oiseaux opportunistes tels que les Grimpereaux.

Changements de régime
En hiver, de nombreux oiseaux modifient leur alimentation en fonction de la disponibilité des ressources. Les Mésanges, les Orites ou la Panure à moustaches passent, par exemple, d’un régime insectivore à un régime granivore. Chez la Panure, cette transition est facilitée par une modification structurelle : son gésier se renforce et devient capable, aidé par de petits cailloux ingérés par l’oiseau, de broyer les graines consommées durant les mois les plus froids.
Et chez les limicoles ?
Les oiseaux vivant près des côtes bénéficient de ressources renouvelées à chaque marée basse. Les marées exposent de nombreux vers, crustacés et mollusques, habituellement cachés sous le sable. Les talitres, communément appelés « puces de mer », sont également une proie de choix. Ils permettent aux oiseaux de maintenir un apport énergétique suffisant pour affronter le froid.
D’autres milieux aquatiques offrent aussi des opportunités uniques. Bien que cachés sous la glace, les poissons sont plus lents en hiver et plus faciles à attraper pour des oiseaux comme les Cormorans ou les Canards plongeurs.

Les ressources anthropiques : des opportunités risquées
L’activité humaine génère aussi des opportunités alimentaires pour les oiseaux. Les plaines agricoles, avec leurs champs en jachère ou les restes de récoltes, constituent un festin pour certaines espèces. Les décharges offrent aussi des ressources en abondance : des milliards de tonnes d’aliments sont jetés chaque année dans le monde. Une aubaine qui, pour de nombreux oiseaux, peut se transformer en véritable cauchemar en raison de la toxicité de certains déchets et des plastiques qui viennent entraver la gorge ou les membres de oiseaux.
À l’inverse, les mangeoires installées dans les jardins sont une aide précieuse pour de nombreux passereaux, la compétition à ces points de nourrissage pouvant tout de même augmenter la vulnérabilité des oiseaux face à des prédateurs comme l’Épervier d’Europe.
Sans oublier l’eau !
L’eau est aussi un facteur crucial pour la survie des oiseaux en hiver. Elle joue un rôle pour l’hydratation et pour la digestion des granivores, mais elle aussi peut représenter un danger : en hiver, les oiseaux qui se baignent risquent l’hypothermie. Pour alimenter des points d’eau, veillez à prévenir ce risque en les maintenant peu profonds.
POUR ALLER PLUS LOIN
Participer à la Formation “Les oiseaux des jardins”
à la Réserve ornithologique le 14 décembre 2024 (de 9h à 13h, 22€/personne).
Formation spéciale débutants : observation et identification des espèces fréquentant la mangeoire & aménagements pouvant favoriser l’accueil de l’avifaune. Réservation auprès de la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon au 05 24 733 733.
MNHN – Faut-il nourrir les oiseaux en hiver ?
Parc Naturel Marin du Bassin d’Arcachon – Où se nourrissent les oiseaux limicoles hivernants et quelles sont leurs proies ?
LPO – Le régime alimentaire des oiseaux des jardins
LPO – Le Houx commun
LPO – Conseil Biodiversité : la Cardère
Ornithomedia – Le Lierre grimpant, une plante utile pour les oiseaux toute l’année
RTBF –Les cynorhodons, les précieuses baies de l’églantier
Le Mag des Animaux – Quelles sont les baies préférées des oiseaux en hiver ?
Science & avenir – Chez les mésanges, réveil matinal et repas tardif sont gages de survie
Ornithomedia – Favoriser l’installation de la Panure à moustache
Ornithomedia – Le système digestif chez les oiseaux
📚 Aujourd’hui, dans le petit glossaire du monde des oiseaux :
🖊️ Mobbing
Le mobbing (ou houspillage) est un comportement défensif observé chez de nombreuses espèces d’oiseaux : c’est lorsqu’un ou plusieurs individus attaquent un prédateur potentiel.
Les Corvidés sont, par exemple, particulièrement connus pour ce comportement, souvent déclenché par la simple présence d’un rapace jugé menaçant. La manœuvre a pour but d’alerter les autres oiseaux du danger et d’augmenter les chances de survie des jeunes en décourageant les prédateurs en période de nidification.
Bien que coûteux, le mobbing offre un avantage considérable pour la protection des nids situés au cœur des colonies. À l’approche d’un rapace ou d’une Corneille, les Mouettes rieuses d’une colonie s’envolent par exemple pour foncer en groupe vers l’intrus en criant et en déféquant.
Lors du mobbing, les oiseaux font généralement mine d’attaquer. Le but est de désorienter et d’intimider le prédateur sans nécessairement entrer en contact physique. Le plus souvent, le mobbing reste une attaque simulée, conçue pour dissuader plutôt que pour blesser.

📸 Epervier d’Europe houspillé par un Geai des chênes, par Christian Grellety
L’observatoire 10 a ouvert ses portes … et ses fenêtres sur la vasière Spatule !
Reconstruite dans sa totalité, cette cabane d’observation est entièrement sur pilotis. Elle offre une vue panoramique sur l’étendue de la vasière Spatule, une zone appréciée des Spatules blanches et des limicoles comme les Courlis ou les Barges. Un double niveau permet aux visiteurs de choisir entre prendre de la hauteur ou rester proche du sol.
Belles observations en perspective, au cœur de la Réserve :




De véritables talents se cachent parmi nos visiteurs !
Vous êtes de plus en plus nombreux à faire connaître les oiseaux et autres merveilles de la Réserve au travers de vos images. Toute l’équipe vous en remercie ! Cette année, nous avons le plaisir de vous inviter à participer à 2 nouveaux appels à contribution :

📸 𝗝𝗘𝗨𝗫 𝗗𝗘 𝗟𝗨𝗠𝗜𝗘̀𝗥𝗘
✨ Qui mieux que l’œil affûté du photographe naturaliste pour jouer avec les oscillations ? De la douceur de l’aube à la dure clarté des après-midis d’été, le soleil projette sur la Réserve des ombres changeantes. Hésitante en hiver, flamboyante en été, caressante en automne, la lumière attise nos imaginaires et, au travers de la photo, propose à nos regards d’étonnantes possibilités créatives. Reflets, contre-jours, alternance d’ombre et de clarté… Un univers tout en contraste se dessine ici chaque jour. A vous de nous le révéler !
📸 𝗣𝗔𝗬𝗦𝗔𝗚𝗘𝗦
🌾 Prairies, lagunes, marais, bois et roselières habillent saisons aprés saisons la Réserve de verts, de jaunes et de bleus. Prisonniers du froid, bercés par les vents, gorgés d’eau ou baignés de soleil, les paysages de la Réserve ont de nombreux visages. Au ras du sol, à travers la végétation, en prenant de la hauteur depuis les observatoires, au trépied ou à main levée … Quelles images gardez-vous de vos contemplations sur les sentiers de la Réserve Ornithologique ? Qu’est-ce qui, pour vous, représente le mieux les paysages – grands ou petits – qui font la richesse du site ?
𝗟𝗲𝘀 𝗽𝗵𝗼𝘁𝗼𝘀 𝘀𝗲́𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲́𝗲𝘀 𝘀𝗲𝗿𝗼𝗻𝘁 𝗲𝘅𝗽𝗼𝘀𝗲́𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟱 𝘀𝘂𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝗲𝗿𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗥𝗲́𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲 !
Vous avez jusqu’au 15 décembre pour nous les envoyer 😉
𝗖𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗲𝗿 ?
Envoyez vos clichés à cette adresse en précisant la date, le lieu de la prise de vue et la thématique du concours auquel vous participez :
📧 photosabonnes.rot@gmail.com
Pensez à accompagner vos messages de la mention “©J’autorise la Réserve Ornithologique du Teich à diffuser les photographies ci-jointes sur support print ou digital, sous réserve que mon nom soit crédité.”
Belles observations à tous !
Photos ci-dessus : Joris Grenon
La ville du Teich et les équipes de la Réserve ornithologique du Teich et du Parc naturel régional des Landes de Gascogne sont heureux de convier les habitant(e)s du Teich à une Journée Portes Ouvertes de la Réserve ornithologique.
DIMANCHE 24 NOVEMBRE
de 10h à 18h
Entrée gratuite pour tous les habitant(e)s du Teich
sur présentation d’un justificatif de domicile à l’accueil de la Réserve ornithologique.
A savoir :
Dans la Réserve, les oiseaux sont plus nombreux à marée haute.
Le meilleur moment pour les observer ce jour-là sera de 11h à 14h !
Dernière entrée à 16h30.

Les visiteurs réguliers l’auront certainement remarqué, le niveau d’eau de la lagune Avocette (observatoires 11 et 12) est maintenu relativement haut ces derniers temps. La hauteur actuelle de l’eau n’a pas d’impact sur la fréquentation du site, elle permet de noyer les berges des îlots pour changer la végétation en faveur de la salicorne.
D’ici quelques jours, les gestionnaires de la Réserve baisseront volontairement les niveaux pour retirer le plus d’eau possible et laisser la vase se densifier. Les berges de la lagune resteront ensuite à découvert pendant un mois. Une intervention est programmée en janvier pour retravailler les îlots à l’aide d’une mini-pelle et retirer la végétation restante.
🌿 Au printemps et en été : une plus faible hauteur d’eau et des îlots sans végétation seront plus favorables à la nidification des Avocettes élégantes.
🍂 En automne et en hiver : le niveau d’eau est remonté pour faire des îlots des reposoirs que les techniciens de gestion continueront d’entretenir en les badigeonnant de vase.

⚠️ FERMETURE EXCEPTIONNELLE
La Réserve et le Sentier du Littoral seront exceptionnellement fermés ce lundi 4 novembre entre 10h et 15h.
Une battue est organisée afin de réguler la population de sangliers.
⌚ Ouverture de l’accueil de la Réserve à 15h, dernière entrée à 16h30.
Merci pour votre compréhension.

192-2024 Arrêté portant fermeture temporaire du sentier du littoral
📚 Aujourd’hui, dans le petit glossaire du monde des oiseaux :
🖊️ Qu’est-ce que le « jizz » ?
Le “jizz” est un terme utilisé par les ornithologues pour décrire l’apparence globale ou l’impression générale que peut donner un oiseau, avant même d’en observer les détails spécifiques. Il s’agit d’une perception intuitive qui repose sur une combinaison de facteurs tels que la taille, la silhouette, le comportement, la manière de voler… En d’autres termes, c’est un ensemble de caractéristiques visuelles et comportementales pour identifier un oiseau, même si l’observation est brève ou à distance.
Un ornithologue expérimenté pourrait, par exemple, reconnaître un Martinet noir en vol en se basant sur son vol rapide, sur sa taille et sur la forme de ses ailes. Il n’aura pas besoin de connaître la couleur de ses plumes ou d’observer l’oiseau à l’arrêt pour en déterminer l’espèce. De la même manière, il est relativement aisé de reconnaître « le jizz » du Faucon crécerelle à sa manière de voler en “Saint-Esprit” (vol stationnaire avec rapides battements d’ailes). Sa silhouette élancée, ses ailes pointues et sa longue queue permettent de le distinguer sans avoir besoin de jumelles. Dans un jardin, le rouge-gorge peut-être reconnaissable à sa posture fière comme à sa façon de se déplacer en sautillant au sol, même lorsque son plastron rouge n’est pas immédiatement visible.
Le mot « jizz » trouverait son origine dans le jargon militaire britannique du début du 20ᵉ siècle, mais il existe plusieurs théories quant à l’étymologie exacte du mot. Certains suggèrent qu’il pourrait provenir de l’expression « General Impression of Size and Shape » (impression générale de la taille et de la forme), utilisée par les pilotes pour identifier rapidement les avions alliés et ennemis.

Le jeu de piste revient pour les vacances dans la Réserve ornithologique !
✉️ Une mystérieuse lettre attendra les enfants de 6 à 15 ans (accompagnés d’au moins un adulte) à l’accueil de la Réserve ornithologique du Teich du 19 octobre au 3 novembre inclus. Avec vos enfants ou petits-enfants, venez déchiffrer les énigmes qui se dévoilent au fil du petit parcours de la Réserve !
🔎 Prévoir environ 2h pour vous balader et observer les oiseaux tout en menant votre enquête.
Un bon de réduction de 5€ (pour tout achat de plus de 15€, hors artisanat) vous sera remis à la Boutique de l’Oiseau sur présentation de la “mystérieuse lettre” complétée et validée par les agents de la Boutique ou de l’accueil.
Accès à la Réserve aux tarifs habituels.
Bonne chance à tous !

UN AN DANS LA VIE D’UN OISEAU
Chaque année voit se redessiner les grandes lignes d’un récit jalonné d’événements successifs, plus ou moins communs à toutes les espèces d’oiseaux : migration, formation des couples, reproduction, élevage et envol des oisillons, mue, hivernage… Nous vous proposons de découvrir ici, mois après mois, les diverses étapes du cycle annuel des oiseaux de la Réserve !
Chez les oiseaux, les dortoirs désignent à la fois le lieu où les individus se regroupent et le rassemblement lui-même. Contrairement aux colonies, qui servent principalement à la nidification, les dortoirs sont des lieux de repos. Ces rassemblements revêtent une importance capitale pour la survie de nombreuses espèces, qui affrontent ainsi le froid de l’hiver, échappent aux prédateurs ou y échangent de précieuses informations.
Sur l’eau, au sol ou perchés, les dortoirs peuvent être des arbres, des buissons, des roselières, des friches, des plans d’eau, des bâtiments, des antennes, des grues, des pylônes, des quais ou même des îlots. Les espèces qui les utilisent sont très diverses. Certains abritent seulement quelques individus, tandis que d’autres peuvent accueillir des milliers d’oiseaux, parfois de différentes espèces.

Dortoir d’Aigrettes Garzettes à la tombée de la nuit
dans la Réserve Ornithologique du Teich (septembre 2024)
Pourquoi former des dortoirs ?
L’un des principaux avantages des dortoirs est la protection qu’ils offrent contre les prédateurs. En se rassemblant en grand nombre, les oiseaux bénéficient d’un effet de dilution : la probabilité qu’un individu soit capturé diminue lorsqu’il se fond dans le groupe. De plus, la vigilance collective renforce la sécurité. Les oiseaux sont en mesure de détecter plus facilement les menaces, et l’envol simultané de nombreux individus peut déstabiliser un prédateur.
Les dortoirs jouent également un rôle essentiel dans la régulation de la température corporelle des oiseaux. En se regroupant, ils créent un « rempart » contre le froid et le vent. Les Mésanges à longue queue se rassemblent par exemple dans des cavités d’arbres ou des nichoirs pour passer les nuits glaciales de l’hiver. Elles profitent ainsi de la chaleur dégagée par leurs congénères.
Les dortoirs servent aussi de lieux d’interaction sociale. Ils facilitent la recherche de partenaires et l’échange d’informations sur les sources de nourriture. Les oiseaux qui connaissent les meilleures zones de nourrissage partagent ces informations de manière fortuite, faisant du dortoir un point névralgique pour la survie et l’alimentation.

Rassemblement d’Étourneaux sansonnets
La formation des dortoirs
L’arrivée au dortoir, qui se produit généralement en fin de journée pour les dortoirs nocturnes, peut être influencée par des facteurs tels que l’heure du coucher du soleil, les conditions météorologiques ou la distance des zones de nourrissage. Avant de rejoindre leur dortoir final, des espèces comme la Grue cendrée ou l’Étourneau sansonnet se rassemblent dans des lieux appelés « pré-dortoirs ». Ces regroupements progressifs joueraient un rôle dans la sécurité des oiseaux. Ils permettraient d’évaluer les dangers potentiels environnants et de naviguer dans l’obscurité, pour donner le moins d’information possible à d’éventuels prédateurs. En plus de favoriser l’alimentation juste avant la nuit, ils offrent un repère aux oiseaux et participent à l’organisation des arrivées au dortoir final.
Des dortoirs diurnes (reposoirs) sont également observés, notamment chez les oiseaux limicoles, qui adaptent leurs comportements au rythme des marées. Des groupes de plusieurs centaines d’individus peuvent ainsi être observés au repos à marée haute :

©Jacques Gillon
Pour plus de détails, prenez le temps de découvrir l’article de la plateforme Ornithomedia :
« LES PRÉ-DORTOIRS, DORTOIRS ET POST-DORTOIRS CHEZ LES OISEAUX »
A lire aussi :
LPO – Dortoirs hivernaux
– https://alsace.lpo.fr/index.php/dortoirs-hivernaux
La Salamandre – Dans le dortoir des étourneaux (🔊)
– https://www.salamandre.org/article/dans-le-dortoir/
LPO – Comment gérer les dortoirs d’étourneaux à l’échelle d’une ville ?
– https://www.lpo.fr/decouvrir-la-nature/conseils-biodiversite/conseils-biodiversite/accueillir-la-faune-sauvage/cohabiter-avec-les-etourneaux
Du neuf à l’observatoire 10 !
La prochaine étape de rénovation de cet observatoire est prévue pour les 9, 10 et 11 octobre 2024.
Les travaux risquent d’occasionner du dérangement sur la vasière spatule.
Pour observer les oiseaux sur ces trois journées, privilégiez les autres zones d’observation de la Réserve.
Les travaux se poursuivront dans les semaines qui suivent, avec un dérangement toutefois moins important sur la vasière spatule.
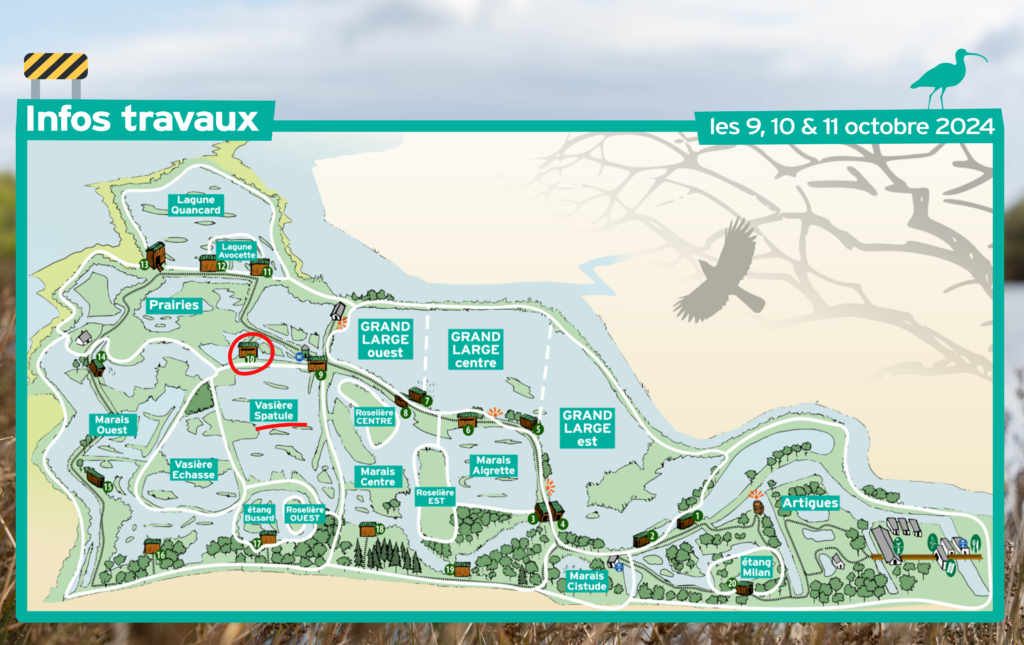

Depuis la création des premiers aménagements en 2008 (lagune Avocette notamment), plusieurs espèces de laro-limicoles se reproduisent dans la Réserve Ornithologique. Les effectifs de couples nicheurs variant d’une année à l’autre, l’Échasse blanche, l’Avocette élégante et la Mouette rieuse font l’objet d’un suivi tout au long de la période de reproduction.
Cette année, afin de faire face à l’impact de la prédation, des actions de gestion hydraulique ont été exercées pour rendre favorable de nouvelles zones de nidification et permettre la dispersion des couples. L’Échasse blanche et l’Avocette élégante préférant des niveaux d’eau bas pour pouvoir construire leur nid sur le sol ou sur des substrats, les niveaux d’eau de la zone Grand Large ont été baissés (notamment à la suite des travaux de réparation de la digue entrepris de février à début avril).
🔹 La saison de nidification 2024 a été fructueuse pour l’Échasse blanche, avec une vingtaine de couples et au moins 6 jeunes volants, ainsi que pour la Mouette rieuse, avec 43 couples nicheurs et au moins 35 jeunes à l’envol.
🔹 Le dernier couple nicheur d’Avocette élégante observé dans la Réserve remonte à 2022, mais son retour est toujours espéré. Chez cette espèce, les couples se forment en hivernage et de nombreux effectifs sont recensés chaque année sur la Réserve.
La baisse des niveaux d’eau a été très favorable à la dispersion des couples d’Échasses blanches et à la survie des jeunes poussins. Elle a montré des comportements intéressants dans sa stratégie de nidification, qui a fait l’objet d’un suivi détaillé par Amélie Garcia.
Pour plus de détails sur les études menées, voici le rapport complet réalisé par Amélie dans le cadre de son stage en Expertise Naturaliste des Milieux (Pôle Sup Nature) :
À découvrir également :
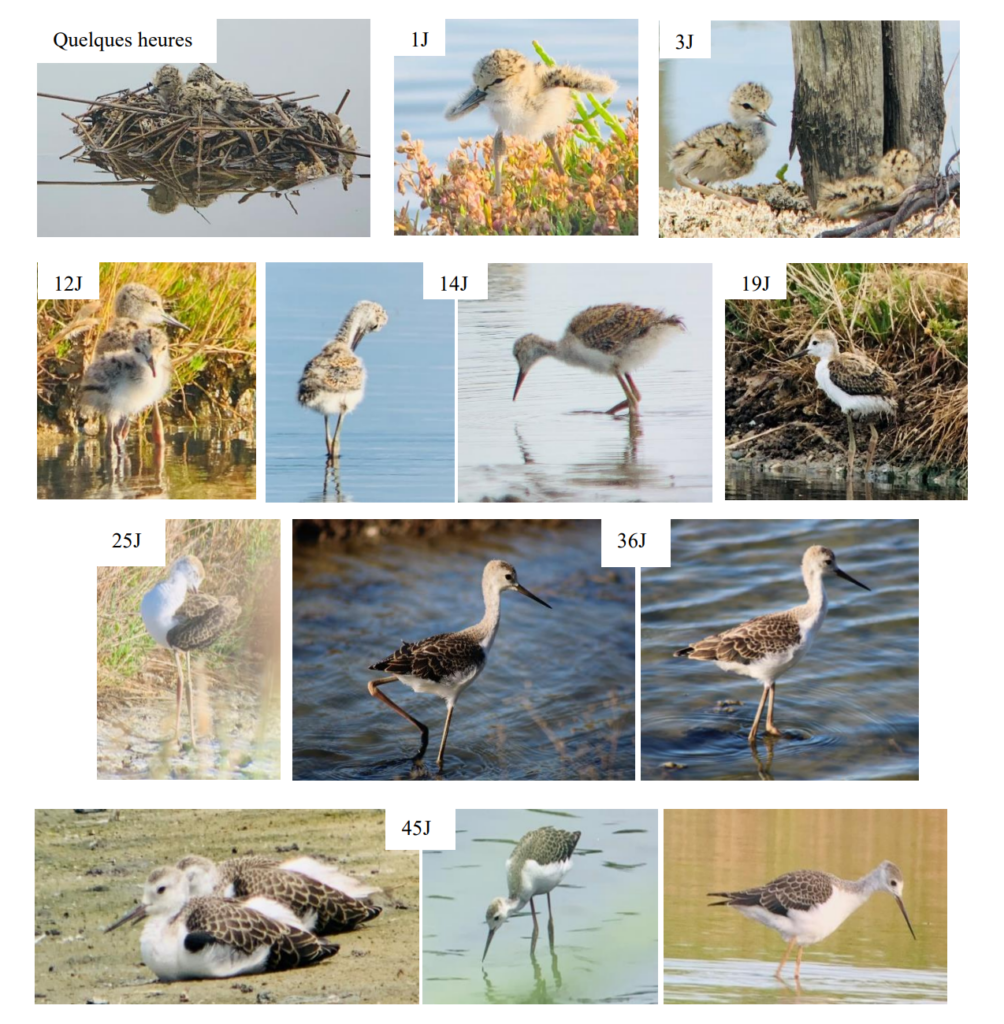
📚 Aujourd’hui, dans le petit glossaire du monde des oiseaux :
🖊️ Tenségrité
Comment les oiseaux font-ils pour dormir debout ?
Réponse détaillée avec le Muséum d’Histoire Naturelle :
“La tenségrité est un principe ayant d’abord été utilisé en architecture, avant de s’être étendu aux domaines mécaniques, biologiques et mathématiques. Il illustre le fait qu’un équilibre existe grâce à la tension de certains composants, ce qui permet un repos, une stabilité de la structure (les forces s’équilibrent). Par exemple, un pont est stable grâce à la tension contenue dans les câbles.
En s’appuyant sur l’anatomie des oiseaux, des scientifiques ont réussi à établir un modèle mathématique qui prouve que peu d’énergie serait requise pour rester en équilibre. Comme un câble tendu autour de poulies, les forces pour rester en équilibre longent chez les oiseaux les trois articulations de la patte. Cette tension permanente et l’organisation géométrique de sa jambe permettent à l’oiseau de rester en équilibre stable : même si le support bouge un peu, l’oiseau reste en tension sans effort : il peut donc dormir debout !”
Pour lire l’article en entier :
📰 https://bit.ly/3XbwJ81

Grands Cormorans au dortoir, Jacques Gillon
Depuis sa création par BirdLife International en 1993, l’EuroBirdwatch célèbre chaque premier week-end d’octobre l’incroyable voyage des oiseaux migrateurs. Partout dans le monde, des animations et des points d’observation sont organisés pour s’émerveiller devant le spectacle de la migration. Pour l’occasion, les guides naturalistes de la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon vous invitent à une matinée d’observation au cœur de la Réserve Ornithologique du Teich. Venez profiter de la quiétude de la Réserve avant son ouverture au public, un naturaliste guidera votre regard pour vous faire découvrir ses visiteurs ailés.
Petit déjeuner offert au fil de la balade !
De 8h à 12h le dimanche 6 octobre 2024.
Tout public, enfants à partir de 12 ans
Tarifs : 15€ avec petit déjeuner offert !
Tarifs réduits (enfant, étudiant, demandeur d’emploi) : 10,50€
Inscriptions obligatoires au 05 24 733 733
[COMPLET]
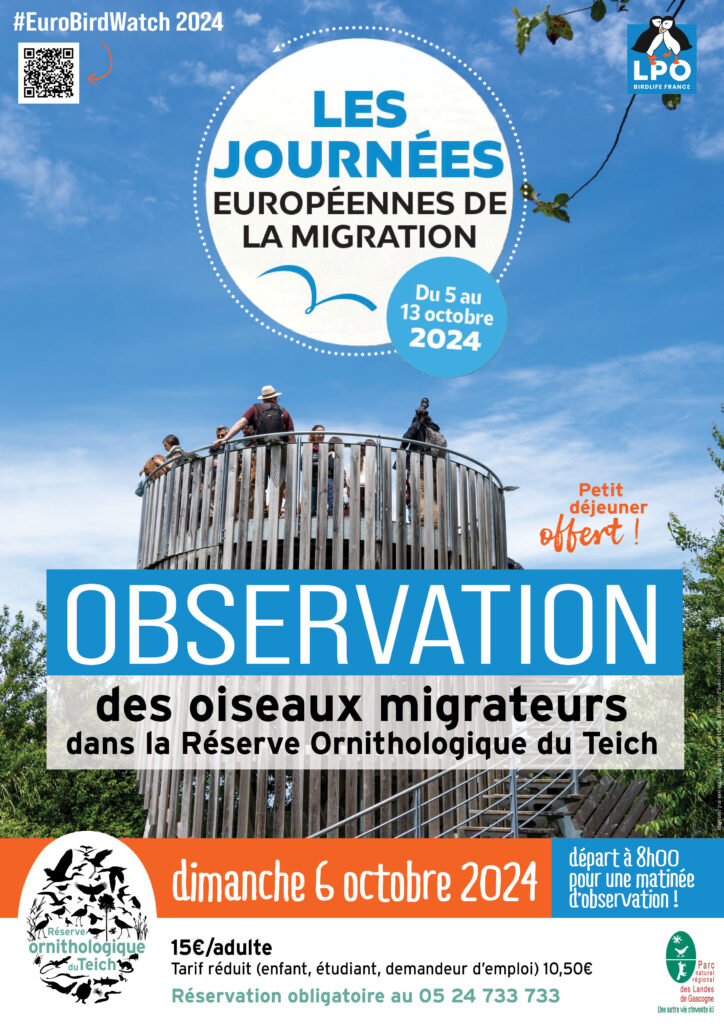
UN AN DANS LA VIE D’UN OISEAU
Chaque année voit se redessiner les grandes lignes d’un récit jalonné d’événements successifs, plus ou moins communs à toutes les espèces d’oiseaux : migration, formation des couples, reproduction, élevage et envol des oisillons, mue, hivernage… Nous vous proposons de découvrir ici, mois après mois, les diverses étapes du cycle annuel des oiseaux de la Réserve !
Les oiseaux parcourent chaque année des distances spectaculaires pour rejoindre leurs aires de reproduction puis leurs sites d’hivernage. De jour comme de nuit, par beau ou mauvais temps, comment parviennent-ils à trouver leur chemin et maintenir le cap vers leurs destinations ? Si la recherche apporte aujourd’hui une meilleure compréhension des mécanismes qui les guident, l’incroyable précision de leurs trajectoires conserve encore quelques mystères.
On sait aujourd’hui que les oiseaux possèdent un programme de migration génétique spécifique, qui varie non seulement d’une espèce à l’autre, mais aussi entre les différentes populations d’une même espèce. C’est ce programme, façonné par la sélection naturelle, qui détermine la direction que les oiseaux doivent suivre lors de leurs voyages. Ils sont guidés tout au long du parcours par une combinaison de repères propres à chaque population :
Naviguer grâce au soleil et aux étoiles
La découverte du rôle du soleil et des étoiles dans l’orientation des oiseaux remonte aux années 1950, avec les recherches de Gustav Kramer. En utilisant un dispositif de miroirs, Kramer a montré que les oiseaux ajustent leur vol en fonction de la position apparente du soleil. Mais le soleil se déplaçant sous la voûte céleste en fonction de l’heure, comment les oiseaux font-ils pour faire correspondre la direction qu’ils souhaitent suivre avec la position des astres ? Comment intègrent-ils ces informations pour naviguer avec précision ?
Les recherches suggèrent qu’une horloge interne leur permet de compenser le déplacement du soleil dans le ciel, pour interpréter correctement la direction à suivre en fonction de la position de l’astre au fil de la journée.
Cette sensibilité aux astres a été confirmée par des observations nocturnes : des oiseaux pouvant suivre une direction spécifique sous un ciel étoilé ont perdu leur orientation lors d’une nuit nuageuse. Comme le soleil durant la journée, le ciel étoilé – et surtout l’étoile Polaire – sert de guide durant la nuit.

Utiliser le champ magnétique terrestre
Une aptitude exceptionnelle permet aux oiseaux de percevoir le champ magnétique terrestre et de l’utiliser à la manière d’une boussole naturelle : la magnétoréception. Ils perçoivent des lignes magnétiques invisibles à l’œil humain. Confirmée par des expériences en laboratoire (des oiseaux en cage ont réagi aux champs magnétiques artificiellement créés par des bobines magnétiques), cette faculté leur est essentielle, notamment lors des migrations nocturnes, lorsque les repères visuels comme le soleil ou les étoiles sont absents ou que les conditions météorologiques sont mauvaises.
Selon les chercheurs, les organes sensoriels responsables de cette orientation magnétique se trouvent dans l’œil droit ou dans la partie supérieure du bec des oiseaux. Des scientifiques ont notamment identifié une protéine, appelée Cryptochrome 4, dans la rétine de Rougegorges familiers (Erithacus rubecula). C’est cette protéine qui lui permettrait de détecter les variations du champ magnétique et de se diriger avec précision lors de ses voyages entre l’Europe et l’Afrique.
Cette capacité à s’orienter grâce au champ magnétique a également été observée chez les pigeons. Leur aptitude à retrouver leur nid (homing) est fortement perturbée si un aimant est fixé sur leur queue.

Des repères géographiques et olfactifs
En complément de leur perception du champ magnétique, les oiseaux peuvent s’appuyer pour naviguer sur des repères géographiques. Le Bassin d’Arcachon, de par la cassure visuelle qu’il crée sur la ligne de côte, constitue par exemple un repère certain pour beaucoup d’oiseaux. En migration, des oiseaux tels que la Cigogne blanche s’appuient sur des repères géographiques comme les rivières ou les chaînes de montagnes pour se diriger vers l’Afrique.
Les oiseaux ont une vue exceptionnelle, ils savent détecter les rayons ultraviolets et reconnaître des motifs subtils dans leur environnement. Le Faucon pèlerin serait par exemple capable de repérer un objet de 2 mm alors qu’il vole à 18 mètres de hauteur !
En plus des repères visuels, des études menées sur le Pigeon voyageur ont montré que les odeurs transportées par le vent pouvaient jouer un rôle de repères olfactifs pour l’oiseau, qui est alors capable de mémoriser de véritables “cartes odorantes”. Les pigeons voyageurs peuvent utiliser leur sens de l’odorat pour détecter à des centaines de kilomètres les odeurs spécifiques qui les guident vers leur nid.

La mémoire et l’apprentissage
La mémoire joue aussi un rôle essentiel dans l’orientation des oiseaux migrateurs. De nombreuses espèces, comme les Oies ou les Grues, apprennent dès leur jeune âge les routes migratoires spécifiques en suivant des adultes expérimentés. Ces itinéraires, souvent millénaires, sont transmis de génération en génération. Cette mémoire leur permet de naviguer efficacement, d’éviter les dangers, et de trouver des zones de repos et de nourriture. Elle réduit les risques pour les jeunes et renforce la cohésion familiale, souvent maintenue par des cris constants de jour comme de nuit.
Une expérience menée par Perdeck dans les années 50 s’est penchée sur le comportement des Étourneaux sansonnets. Capturés durant leur migration postnuptiale à La Haye et relâchés en Suisse, les jeunes Étourneaux ont continué dans la même direction, tandis que les adultes ont ajusté leur trajectoire pour retrouver leur chemin habituel. Alors que les adultes peuvent utiliser leur expérience pour corriger d’éventuelles erreurs de parcours, les jeunes doivent apprendre à s’orienter dans la bonne direction.
En somme, c’est la mémoire collective et l’expérience des oiseaux adultes qui assurent dans ce cas le succès des migrations. Ces mécanismes permettent non seulement d’apprendre et de transmettre des itinéraires migratoires complexes, mais aussi d’optimiser les déplacements en fonction des connaissances accumulées au fil des générations.

POUR ALLER PLUS LOIN
Sciences&Avenir – Comment les oiseaux migrateurs se dirigent-ils ? Où en sont les recherches ?
MaxiSciences – Les cryptochromes : des protéines au niveau de la rétine des oiseaux
Pour la Science – La navigation quantique des oiseaux migrateurs
LeBlob – Vidéo – Une boussole quantique dans l’œil du rouge-gorge
Ornithomedia – Le rôle de l’odorat dans l’orientation de certains oiseaux
Salamandre.org – Comment les jeunes oiseaux migrateurs trouvent-ils leur chemin ?
Migration.net – S’orienter ne suffit pas
ET AUSSI :
Rendez-vous le 6 octobre pour une matinée d’observation des oiseaux migrateurs dans la Réserve Ornithologique du Teich !
Informations et inscriptions : Journées Européennes de la Migration
Pour vous former à l’identification des oiseaux migrateurs et hivernants,
rapprochez-vous des naturalistes de la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon :
catalogue des formations
#WorldMigratoryBirdDay
Campagne internationale de sensibilisation, la Journée mondiale des oiseaux migrateurs nous rappelle chaque année la nécessité de protéger les oiseaux migrateurs et leurs habitats. Événement hors du commun à bien des égards, la migration des oiseaux est une véritable prouesse physique et physiologique, ponctuée de multiples dangers.
Tous les deuxièmes samedis de mai, la Journée mondiale des oiseaux migrateurs célèbre le voyage retour des oiseaux vers leurs sites de nidification. Cette année, l’accent est mis sur les liens qui conditionnent la survie des oiseaux à celle des insectes : protéger les insectes, c’est protéger les oiseaux. Les oiseaux migrateurs seront célébrés en deux temps : le 11 mai, puis le 12 octobre 2024.

Source d’énergie essentielle sur le trajet et sur les sites de reproduction de nombreux migrateurs, les insectes jouent un rôle déterminant dans le voyage et le succès reproducteur des insectivores. Les oiseaux en escale cherchant des insectes dans les champs, les forêts, les zones humides et divers habitats, la migration coïncide souvent avec le pic d’abondance des insectes sur les zones de repos. Principalement dues à l’agriculture intensive, au développement urbain et à la pollution chimique ou lumineuse, la perte et la perturbation des populations d’insectes sont des menaces considérables pour les oiseaux qui, sans insectes, ne trouvent plus les ressources nécessaires pour se nourrir et rester en bonne santé.
Les migrateurs insectivores apportent de multiples avantages : ils participent à la lutte contre les moustiques et les insectes susceptibles d’endommager les cultures ou de propager des maladies. Pourtant, la population d’oiseaux terrestres se nourrissant d’insectes a diminué de 2,9 milliards au cours des 50 dernières années (Tallamy & Shriver, 2021). Des liens ont été établis entre la diminution des chenilles (dont la valeur nutritionnelle est particulièrement élevée) et la santé des nids d’oiseaux : des couvées plus petites, plus de mortalités dues à la famine, moins de juvéniles, des taux de croissance plus lents et une masse corporelle plus faible ont été constatés (Tallamy et Shriver. 2021).
Pour préserver l’équilibre délicat entre les oiseaux et les insectes, des mesures de conservation proactives et efficaces doivent être mises en place à grande échelle. Maintenir et restaurer les habitats naturels le long des routes migratoires et sur les sites de reproduction est désormais crucial pour nos écosystèmes.
Même à plus petite échelle, il n’y a pas de petites actions !
Pour contribuer à la préservation des insectes (et donc des oiseaux), vous pouvez :
👉 Journée Mondiale des Oiseaux Migrateurs 2024
Vous nous rendez-visite ce 𝗺𝗮𝗿𝗱𝗶 𝟭𝟬 𝘀𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 ?
👨🌾 L’équipe de la Réserve vous informe que des techniciens de gestion seront présents dans l’après-midi au niveau de l’étang Busard (devant l’observatoire 17) pour une courte opération de fauchage. L’observatoire 17 restera ouvert au public.
🖊️ À savoir :
le meilleur créneau horaire pour observer les oiseaux ce jour-là est entre 10h et 13h. Si vous le pouvez, venez plutôt en matinée !
De courtes actions de fauchage devraient se poursuivre dans le courant de la semaine autour de cette zone (observatoire 16 et 17 notamment).
Merci pour votre compréhension.


LES JOURNEES EUROPEENES DU PATRIMOINE
à la Réserve Ornithologique du Teich et la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon

Samedi 21 septembre
de 14h à 16h30
Du haut de plage à l’estran vaseux, de la laisse de mer aux crabes dont on ne distingue que les yeux, venez découvrir, en compagnie d’un animateur nature du Parc naturel régional des Landes de Gascogne, les paysages du bassin d’Arcachon à marée basse et comprendre comment la vie s’organise avec le balancement des marées. Arpenter, explorer, chercher, contempler seront les maîtres mots de nos découvertes !
Rendez-vous : Sentier du Littoral, Gujan-Mestras
Réservation obligatoire au 05 24 733 733
GRATUIT avec le soutien du Département de la Gironde
à partir de 5 ans

Dimanche 22 septembre
de 9h30 à 12h00
Les guides naturalistes de la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon vous invitent à une balade « ornitho-historique » sur les sentiers de la Réserve. Un parcours de 4 kilomètres évoquant l’histoire du site et de ses paysages, façonnés par l’activité humaine pour les oiseaux sauvages. « Parc » devenu « Réserve » ornithologique, 110 hectares contribuent depuis 1972 à la richesse et à la protection du patrimoine naturel local. Le temps d’une matinée, venez découvrir les oiseaux et l’évolution de cet ancien lit de La Leyre.
Rendez-vous à l’accueil de la Réserve Ornithologique du Teich
Réservation obligatoire au 05 24 733 733
GRATUIT dans la limite des places disponibles.
maximum 20 places – à partir de 7 ans

Dimanche 22 septembre
de 13h30 à 17h30
Un guide naturaliste et sa longue-vue seront présents tout l’après-midi sur le Sentier du Littoral, à la pointe du Teich.
Venez à sa rencontre pour découvrir les trésors du littoral et les oiseaux du Bassin d’Arcachon !

On s’envole aujourd’hui pour l’Afrique, avec un article publié récemment par Birdlife international :
📰 Empowering Communities to Safeguard Migratory Bird Havens in Africa
Le couloir migratoire est-atlantique, qui s’étend sur 49 pays, est emprunté chaque année par des millions d’oiseaux. Au cours de leur spectaculaire voyage, ces oiseaux sont confrontés à divers dangers et à une destruction accélérée de leurs habitats. Conscients de ces défis, les partenaires de BirdLife ont créé l’East Atlantic Flyways Initiative (EAFI). En 2020, un groupe de travail soutenu par Vogelbescherming Nederland (VBN) a lancé un programme de subvention (EAFI Small Grants Program) pour encourager les efforts de protection tout au long de cette voie de migration. Plusieurs initiatives, financées à hauteur de 15 000 euros par organisation, ont ainsi vu le jour dans diverses régions d’Afrique :
🇳🇬 Au Nigéria, la Nigerian Conservation Foundation (NCF) a effectué en janvier 2022 un recensement des oiseaux d’eau avec une étude approfondie de toute la côte nigériane. 2 871 oiseaux d’eau appartenant à 55 espèces et 16 familles ont été recensés et des sites nécessitant une attention particulière ont pû être identifiés.
🇬🇼 Dans le bassin de Mansôa (Guinée-Bissau), deux suivis ont été mis en place : un pour la Barge à queue noire (Limosa limosa) et un pour la Grue couronnée (Balearica Pavonina). De toutes premières recommandations ont pû être formulées pour la gestion de cette zone en faveur de ces espèces, malgré l’expansion des rizières et l’utilisation d’engrais,
🇸🇳 Au Sénégal, dans la Réserve Naturelle Communautaire de Tocc Tocc (site Ramsar d’une superficie de 273 ha), les subventions ont permis la construction d’infrastructures d’écotourisme et l’amélioration des suivis effectués sur la lagune (à l’aide d’un bateau notamment).
🇨🇮 En Côte d’Ivoire, les forêts et les îles du Parc National des Îles Ehotilé (550 ha) sont une bouée de sauvetage pour des oiseaux tels que le Courlis cendré, mais elles sont restées très peu étudiées. Ici, les subventions ont permis de former 26 scientifiques (tous citoyens locaux), pour documenter les plus de 30 espèces d’oiseaux dont la survie nécessite des actions de protection.
🇲🇦 Au Maroc, les chercheurs du GREPOM ont élaboré un plan national d’action pour la préservation des oiseaux limicoles. L’objectif est de mettre en œuvre des politiques ciblées dans des zones humides telles que Bas Loukkos (3 600 ha dans le nord-ouest du Maroc). Site Ramsar, les marais de Bas Loukkos accueillent chaque année des milliers de Barges en migration depuis l’Europe.
🇿🇦 En Afrique du Sud, BirdLife South Africa a travaillé avec les autorités municipales pour revoir la réglementation des activités de loisir et établir des zones « sans vagues » là où le sillage des bateaux érode les rives de l’estuaire. Des panneaux délimitant ces zones et d’autres zones sensibles à l’érosion ont été érigés sur l’ensemble de l’estuaire. Plus de 40 résidents et des équipes de travail ont également été formés aux techniques de restauration et de gestion des habitats.

avec Olivier, technicien de gestion de la Réserve Ornithologique du Teich
Célébrée le 6 septembre, la Journée Mondiale des Oiseaux Limicoles invite les ornithologues amateurs et expérimentés du monde entier à participer au recensement international des oiseaux limicoles : une semaine pour compter et faire connaître les limicoles de tous horizons.
Vous êtes abonnés à la Réserve et souhaitez participer ?
Venez exercer votre regard avec les limicoles de la Réserve en compagnie d’un technicien de gestion du site !
Le temps d’une matinée, Olivier vous donnera les clés d’identification à appliquer lors de vos observations, tout en partageant les conseils de l’équipe de gestion de la Réserve pour compter les oiseaux !
QUAND ?
Jeudi 5 septembre
Départ à 7h30 de l’entrée de la Réserve Ornithologique du Teich
Réservation obligatoire
au 05 24 733 733 ou par email : 📧 photosabonnes.rot@gmail.com
Important :
Cette animation n’est pas une sortie photo, privilégier les jumelles plutôt que le téléobjectif (possibilité d’en emprunter à la Réserve le temps de la balade).
Pour aller plus loin :
JOURNEE MONDIALE DES LIMICOLES 2024
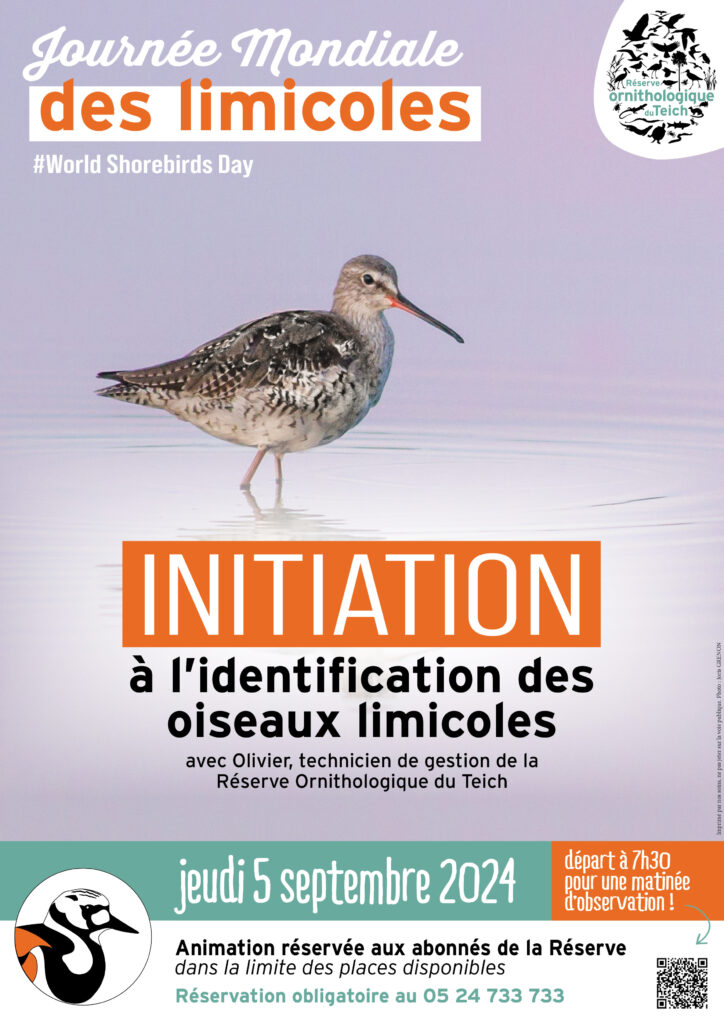
📚 Aujourd’hui, dans le petit glossaire du monde des oiseaux :
🖊️ 𝗨𝗿𝗼𝗵𝘆𝗱𝗿𝗼𝘀𝗲
Comment les oiseaux régulent-ils la température de leur corps quand il fait chaud ?
Réponse avec la plateforme Ornithomedia :
“Pour diminuer leur température corporelle, les oiseaux peuvent se mettre à l’ombre ou se baigner. Mais en plein soleil ou quand il n’y a pas d’eau disponible, par exemple quand ils couvent sur leur nid, ils doivent trouver d’autres solutions : ils peuvent ouvrir leur bec, écarter leurs ailes ou, chez certaines familles comme les Ciconiidés et les Cathartidés (les vautours du Nouveau Monde), pratiquer l’urohydrose.
Il s’agit d’un comportement étonnant et méconnu qui consiste à déféquer et uriner (les fientes sont composées des selles et de l’urine) sur la partie déplumée de leurs pattes en profitant de l’évaporation de l’eau de leurs fientes : en effet, leurs pattes sont richement irriguées, et un refroidissement du sang qui y circule réduit la température générale du corps.”
🎬 Cigogne aux pattes blanchies par l’urohydrose, webcam Tudela, Espagne, juin 2024

©Darius
Les températures devant dépasser les 40 degrés dès le début d’après-midi,
la Réserve ouvrira exceptionnellement ses portes dès 9h00 et fermera à 14h00 ce dimanche 11 août.
Dernières entrées à 12h30.
Pour les visites du matin :
👒 N’oubliez pas vos chapeaux !
💧 Prévoyez assez d’eau : des points d’eau potable sont à votre disposition à l’entrée et au premier tiers du sentier.
🌿 Venez plus tôt ! Commencez votre visite dès l’ouverture (à 10h) pour profiter de la fraîcheur du matin et éviter les trop fortes chaleurs de l’après-midi.
CE DIMANCHE 11 AOÛT :
Ouverture en matinée dès 9h00.
Fermeture exceptionnelle de la billetterie à 12h30.
Fermeture des portes de la Réserve à 14h00.
La Boutique de l’Oiseau vous accueillera entre 11h00 et 14h00.
Merci pour votre compréhension !

UN AN DANS LA VIE D’UN OISEAU
Chaque année voit se redessiner les grandes lignes d’un récit jalonné d’événements successifs, plus ou moins communs à toutes les espèces d’oiseaux : migration, formation des couples, reproduction, élevage et envol des oisillons, mue, hivernage… Nous vous proposons de découvrir ici, mois après mois, les diverses étapes du cycle annuel des oiseaux de la Réserve !
Pourquoi changer de plumes ?
Chaque année, à l’approche du solstice d’été, les oiseaux entrent en période de mue : leur plumage, usé par les frottements, les parasites ou les rayons UV, doit être remplacé pour pouvoir continuer d’assurer ses fonctions pour le vol, la protection contre l’eau et l’isolation thermique. En plus de ces bénéfices, le plumage joue un rôle social particulièrement important chez les oiseaux. Couleurs et motifs envoient des signaux différents en période nuptiale et inter-nuptiale. Souvent plus coloré, le plumage nuptial contribue au succès des parades, alors que le plumage postnuptial, plus neutre, facilite pour beaucoup d’espèces la vie sociale en hiver.
Quand muer ?
La migration et la reproduction exigeant toutes deux beaucoup d’énergie, la majorité des oiseaux muent entre ces deux périodes. Beaucoup effectuent une mue complète en été, dans la période qui suit la nidification et précède la migration automnale. D’autres optent pour une mue plus tardive, continue ou partielle. Chez certaines espèces, la mue ne se termine qu’après la migration d’automne, à l’arrivée sur les sites d’hivernage.
À quel rythme ?
La majorité des espèces renouvellent toutes leurs plumes d’une seule traite. Pour d’autres ou pour les juvéniles, la mue se fera en plusieurs étapes, à différentes périodes de l’année. On peut alors parler de mue partielle ou, selon les cas de figure, de mue suspendue. Chez certains, le renouvellement du plumage est progressif. Les rémiges des grands Rapaces ou des Cigognes seront par exemple remplacées une à une sur plusieurs mois. Les nouvelles plumes ne grandissant que de 5 à 10 mm au maximum par jour, toutes les rémiges ne repoussent pas en même temps, elles sont remplacées l’une après l’autre pour ne pas affecter le vol. Parmi les grands oiseaux, seule la Grue cendrée adopte une stratégie de mue similaire à celles des Canards ou des Oies : en été (mais pas tous les étés), elle perd toutes ses rémiges, et donc ses capacités de vol.
Chez les Canards colverts, la période de mue est tout à fait particulière : les mâles muent en deux temps. Ils adoptent un plumage de transition appelé plumage d’éclipse, avant de retrouver leur plumage nuptial. Ce plumage d’éclipse ressemble à celui des femelles, seul le bec conserve sa couleur jaune. Cryptiques, leurs nouveaux motifs permettent d’être plus discrets pour survivre sans avoir besoin de voler, à l’abri des hautes herbes ou des roseaux… Il faudra au moins 3 à 4 semaines à ces messieurs Colverts pour retrouver toutes les capacités conférées à leur plumage nuptial. De leur côté, les canes muent aussi, mais seulement une fois par an et de façon moins ostentatoire. Leur mue intervient en même temps que l’élevage des poussins (qui devront eux aussi perdre leurs plumes juvéniles).
Connaître les périodes de mue permet de déterminer si l’oiseau est jeune ou adulte, l’âge étant un critère indispensable à la détermination d’une espèce ou du sexe d’un individu. C’est, par exemple, particulièrement intéressant chez de nombreuses espèces de Laridés, dont le plumage adulte n’est atteint qu’après une série de mues effectuées sur plusieurs années calendaires.
Pour résumer, voici quelques exemples :
1 MUE COMPLÈTE PAR AN
Un remplacement de l’intégralité du plumage est effectué suite à la période de reproduction. Le plumage internuptial s’usera petit à petit en automne et en hiver, jusqu’à laisser apparaître le plumage nuptial.
Ex : la majorité des passereaux

Pinson des arbres mâle en plumage internuptial (en hiver) ©J. Gillon

Pinson des arbres mâle au mois de mars dans la Réserve ©M. Dal Bello
En s’usant, les plumes du plumage internuptial (acquis après la saison de reproduction)
vont révéler le plumage nuptial, plus coloré.
2 MUES COMPLÈTES PAR AN
Le Pouillot fitis est le seul oiseau de nos régions à effectuer deux mues complètes chaque année, une mue postnuptiale complète (pour les adultes) puis une mue prénuptiale complète.
MUE PARTIELLE
Certaines espèces ne remplacent qu’une partie de leur plumage. La mue partielle comprend la mue post-juvénile de nombreuses espèces. Chez certains oiseaux, deux mues sont aussi effectuées chaque année chez les adultes : une mue postnuptiale complète et une mue prénuptiale partielle.
Ex : Mouette rieuse ou Canard colvert (qui aura en plus un plumage d’éclipse)

Canard colvert mâle en train de muer
Réserve Ornithologique du Teich ©Samantha Peytoureau


Mouettes rieuses, immatures premier été
Réserve Ornithologique du Teich, Mai 2023 ©Marion Dal Bello
MUE SUSPENDUE
Les oiseaux commencent à muer avant le départ en migration, mais la mue ne se poursuivra qu’une fois arrivés sur leur site d’hivernage.
Ex : Pigeon ramier, Guêpier d’Europe
MUE ARRÊTÉE
Il arrive que la mue s’arrête chez les oiseaux, juvéniles notamment, qui font face à diverses difficultés : ressources alimentaires faibles, mauvais état de santé, conditions météorologiques difficiles… Contrairement à la mue suspendue, leur plumage ne sera pas remplacé avant la mue de l’année suivante.
Ex : cette « économie d’énergie » est souvent observée chez les Martinet noirs
MUE CONTINUE
Des plumes neuves viennent une à une remplacer les plumes abîmées. La mue peut être permanente ou répartie sur plusieurs mois ou plusieurs années.
Ex : grands Rapaces, Cigognes

Vautour fauve ©Jacques Gillon
Chez cette espèce, la mue s’effectue en général entre entre juin et septembre,
mais les rémiges primaires peuvent muer toute l’année,
les couvertures alaires peuvent être remplacées d’avril à novembre.
À LIRE :
ORNITHOMEDIA – Comprendre la mue chez les oiseaux.
https://www.ornithomedia.com/pratique/debuter/mue-chez-oiseaux-00571/
NATAGORA – La mue chez les oiseaux : quelques espèces.
https://bruantwallon.be/2015/06/15/la-mue-chez-les-oiseaux-quelques-especes/
ORNITHOMEDIA – La succession des plumages du Goéland brun (Larus fuscus).
https://www.ornithomedia.com/pratique/identification/succession-plumages-goeland-brun-larus-fuscus-00999/
DELACHAUX ET NESTLE – Une aide pour l’ornitho de terrain.
« Comprendre la mue des oiseaux »
Marc DUQUET – Sébastien REEBER – éditions Delachaux et Nestlé
Si vous êtes venus dans la Réserve il y a quelques années, vous n’avez pas pu manquer les nombreux nids de Cigognes qui trônaient sur les pins. L’un d’entre eux coiffait d’ailleurs fièrement le toit de la Maison de la Nature. Le claquement de ces majestueux échassiers a longtemps résonné dans la Réserve, qui a vu naître de nombreux cigogneaux. Mais alors, nous direz-vous, où sont-ils aujourd’hui ?
Rappelons pour commencer que les Cigognes sont des oiseaux migrateurs. Leur cycle migratoire les a longtemps conduites à traverser l’Europe pour rejoindre l’Afrique, où la nourriture abonde en hiver. Ces dernières années cependant, plusieurs études ont souligné une importante sédentarisation des populations : les Cigognes ont raccourci leur migration, elles ne traversent plus la mer, préférant profiter de la nourriture illimitée prodiguée dans le Sud de l’Europe par les décharges à ciel ouvert. Un changement crucial pour les populations, qui évoluent désormais parmi les sacs plastiques.
Les Cigognes nichant dans l’Ouest longent aux mois d’août et de septembre la façade Atlantique pour aller traverser la chaîne des Pyrénées et rejoindre Gibraltar. En Gironde, où la population nicheuse comptait à minima 395 couples en 2023 (source LPO), les programmes de suivis ont permis de confirmer la sédentarisation et la migration partielle de certains individus. Des changements climatiques et l’abondance de nourriture (centres d’enfouissement ou présence en quantité suffisante d’Écrevisses américaines) peuvent expliquer ces changements de comportements.

Un matin avec les Cigognes blanches ©Jacques GILLON
Si les Cigognes continuent de venir s’alimenter ou se reposer dans la Réserve, elles n’y nichent plus…
et ce n’est pas une si mauvaise nouvelle !
Dans la Réserve, il semble que les sites de nidification aient été peu à peu abandonnés suite à la fermeture, en 2007, de la gigantesque décharge à ciel ouvert d’Audenge (située à quelques battements d’ailes au Nord de la commune du Teich).
De l’an 2000 à 2007, les populations hivernantes du département se concentraient en très grande majorité sur le Bassin d’Arcachon. Elles ne cessaient d’augmenter, mais dès 2008, la population s’est considérablement réduite : ne pouvant plus compter sur la décharge, les Cigognes se sont dispersées dans différentes zones humides de la région Aquitaine. Contraintes d’abandonner la toxicité des déchets devenus inaccessibles, elles ont revu leur mode de vie de façon à homogénéiser l’accès à d’autres ressources alimentaires (vers, orthoptères, amphibiens, reptiles, poissons, crustacés, petits mammifères…).
Si aucune zone ne concentre aujourd’hui d’effectifs aussi importants que ceux du Bassin d’Arcachon avant 2007, la population reste en croissance et semble mieux répartie à l’échelle de la région (cf. Atlas des oiseaux migrateurs et hivernants d’Aquitaine). La population nicheuse du Teich s’est très probablement disséminée sur les Charentes et dans le Médoc.
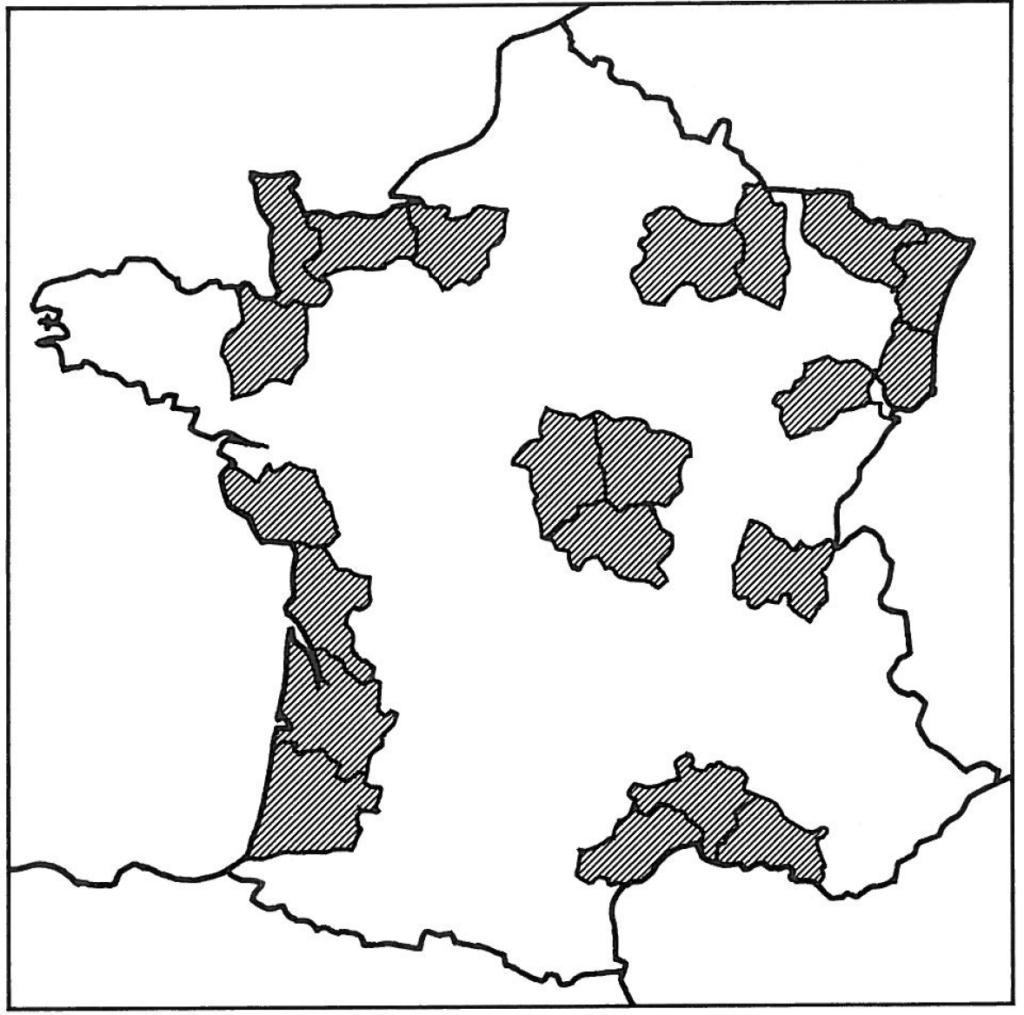
Carte de répartition des Cigognes en France,
dessinée par ©Pierre PETIT
Pour aller plus loin :
Suivis de la migration des Cigognes blanches par balise GPS :
– https://www.acrola.fr/cigognes/migration-balise/
– https://cigognesdesaintonge.wordpress.com/gps/
Programme de baguage des Cigognes blanches en France :
– https://www.ciconiafrance.fr/
Études internationales :
–https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/oiseaux/des-cigognes-opportunistes-se-delectent-des-dechets-des-hommes_102951
–https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.1500931
–https://fr.hespress.com/328371-risque-pour-la-biodiversite-quand-les-oiseaux-migrateurs-se-nourrissent-des-dechets.html
Réhabilitation de la décharge d’Audenge :
– https://www.youtube.com/watch?v=sHjU5Vm0jKM&ab_channel=ademe
En migration postnuptiale, les Barges se rassemblent pour se déplacer, se nourrir et se reposer. Généralement plus importants au mois d’août, les groupes de passage dans la Réserve peuvent aller de quelques individus à plusieurs centaines d’oiseaux. Différencier les Barges à queue noire des Barges rousses peut s’avérer plus simple en plumage nuptial qu’en hiver.
Profitez de l’été pour vous entraîner à les reconnaître au premier coup d’œil :

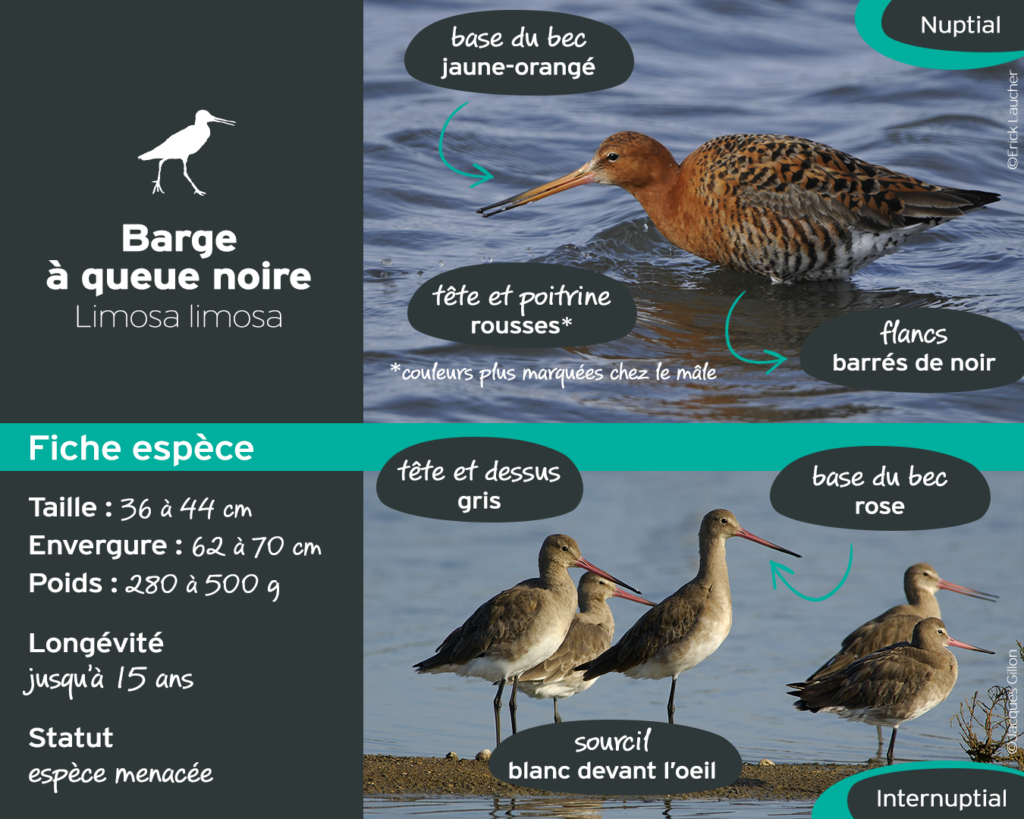
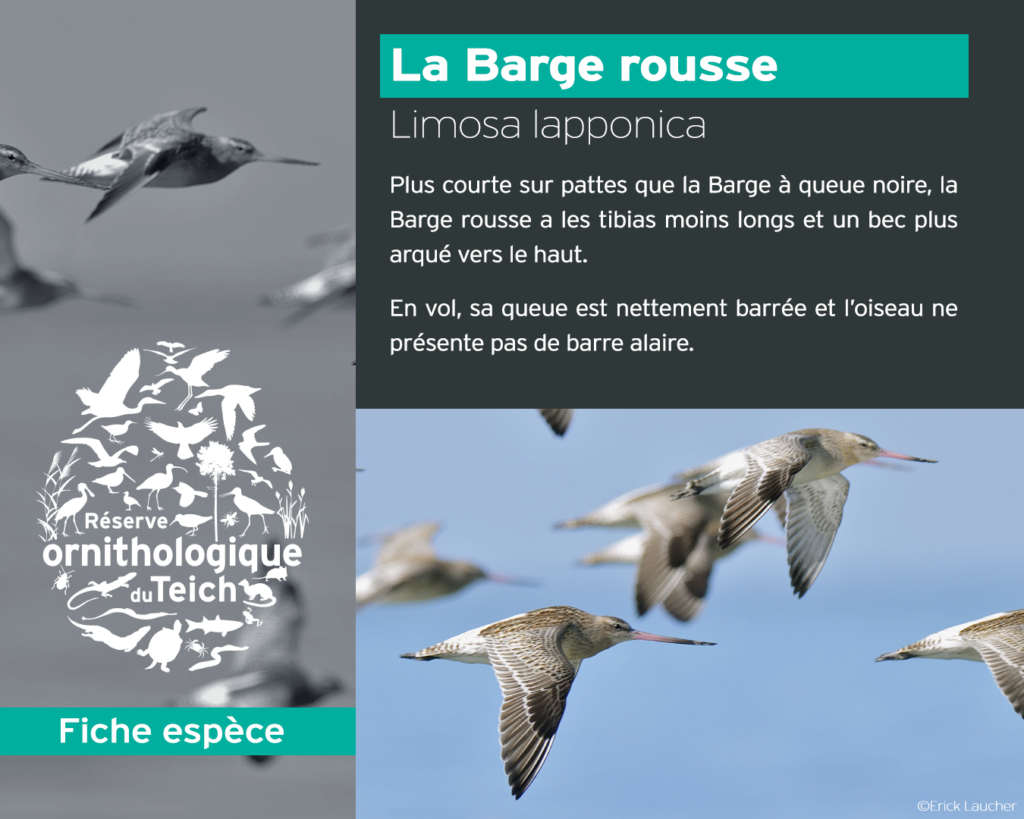
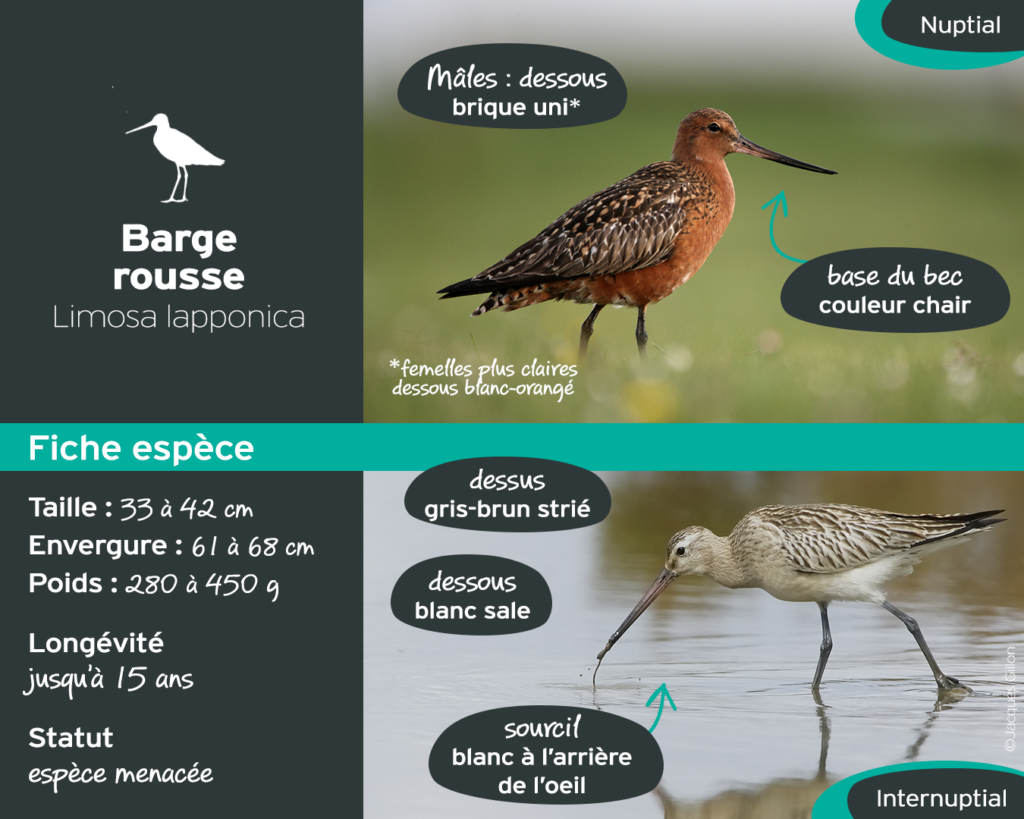
📚 [ORNITHO DICO]
Aujourd’hui, dans le petit glossaire du monde des oiseaux :

🖊️ DIGITIGRADE
On dit des oiseaux qu’ils sont “digitigrades” (du latin digitus/doigt et gradi/marcher) : ils ne marchent pas sur leurs pieds, mais bel et bien sur leurs orteils ! Contrairement aux plantigrades (que nous sommes quand nous ne courons ou ne marchons pas sur la pointe des pieds), les oiseaux ont des talons qui ne touchent pas le sol, leurs articulations sont placées beaucoup plus haut dans le squelette.
Il serait facile, en observant une Échasse blanche par exemple, de penser que ses genoux plient dans le sens inverse des nôtres. En réalité, nous ne pouvons voir que son talon. Sa cuisse (fémur) étant cachée dans le corps de l’oiseau, son véritable genou est proche du corps, à l’abri du plumage.
L’os qui sépare le talon des orteils est appelé “tarsométatarse.” C’est une version allongée et fusionnée de ce qui, chez nous, correspond aux os de la cheville et du pied (tarse et métatarse).
UN AN DANS LA VIE D’UN OISEAU
Chaque année voit se redessiner les grandes lignes d’un récit jalonné d’événements successifs, plus ou moins communs à toutes les espèces d’oiseaux : migration, formation des couples, reproduction, élevage et envol des oisillons, mue, hivernage… Nous vous proposons de découvrir ici, mois après mois, les diverses étapes du cycle annuel des oiseaux de la Réserve !
Chez les oiseaux, il existe plusieurs stratégies de nidification pour mener à bien la naissance et les premiers jours de vie des oisillons. On parle par exemple d’oiseaux Nidicoles ou Nidifuges. Voici quelques pistes pour les différencier :
🐣 Chez les Nidicoles, les oisillons naissent nus et aveugles, ils sont totalement dépendants de leurs parents et devront rester au nid jusqu’à ce qu’ils soient capables de voler de leurs propres ailes.
C’est par exemple le cas de tous les passereaux.
🐣 Chez les Nidifuges, les oisillons quittent le nid juste après l’éclosion. Ils sont protégés à l’extérieur du nid par leurs parents et imitent leur mère pour apprendre à se nourrir seuls.
C’est ce que font les Cygnes, la plupart des Canards, les Oies…
Pour aller plus loin, il existe encore quelques nuances :
🐣 Les poussins Semi-Nidifuges naissent pourvus de plumes. Ils sont capables de voir et d’entendre dès l’éclosion mais ne pourront pas voler tout de suite. Ils restent à proximité ou dans le nid pour que leurs parents les nourrissent et les réchauffent. Les Mouettes et les Sternes entrent par exemple dans cette catégorie.
🐣 Les oisillons Sous-Nidifuges quittent le nid juste après l’éclosion mais – contrairement aux Nidifuges – continueront d’être nourris et protégés encore un certain temps par leurs parents. Vous avez, par exemple, peut-être déjà observé des Grèbes huppés offrant à leurs poussins de petites plumes et des poissons ? Les jeunes Grèbes ont besoin d’un certain temps pour apprendre à pêcher et à se réchauffer seuls.
🐣 Existe aussi un groupe pour les Semi-Nidicoles, qui naissent avec du duvet mais sont aveugles et ne se déplacent pas tout de suite en dehors du nid : Cigognes, Engoulevent d’Europe, Hérons et Aigrettes…

Saviez-vous que la France compte près de 1000 espèces d’abeilles ?
Les Hyménoptères (abeilles, bourdons, guêpes …) rendent un service inestimable à la reproduction des plantes à fleurs sauvages et cultivées. Pour contribuer à leur préservation, la Région Nouvelle-Aquitaine s’est engagée auprès de l’Office pour les insectes et leur environnement (OPIE) pour la mise en œuvre d’un Plan régional en faveur des pollinisateurs. Les 5 Parcs naturels régionaux de Nouvelle-Aquitaine contribuent dans ce cadre au programme LIFE « Abeilles sauvages dans les PNR de Nouvelle-Aquitaine. »
🐝 Lancé fin 2021, ce programme doit dans un premier temps évaluer la diversité des abeilles sauvages par types de milieux sur l’ensemble des 5 sites et définir les cortèges floristiques qui leurs sont favorables. D’ici 2026, des actions devraient contribuer à la recréation d’un maillage dense d’habitats propices à leur préservation ainsi qu’à la sensibilisation du grand public et des acteurs locaux.
Des relevés mensuels sont effectués dans la Réserve Ornithologique du Teich par le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. Un suivi régulier permettra d’évaluer et de comparer les effectifs et l’état de santé de nos populations d’abeilles sauvages.
Pour en savoir plus :
👉 Programme LIFE Abeilles Sauvages

Fauche du foin dans les prairies de la Réserve

🦟 Le retour de la chaleur et des beaux jours réveille en nous un réflexe irrépressible mis de côté pendant l’hiver : claquer des mains dans l’espoir d’exécuter les petites bêtes qui viennent titiller nos oreilles de leurs bzz bzz intempestifs !
Il est vrai que, dans la Réserve, les moustiques sont de retour et se délectent parfois sans modération du passage de nos chers visiteurs. Hématophages, ces terribles carnivores voltigent autour de nous avec une assurance exaspérante… au grand dam de leurs cousins pourtant végétariens : les chironomes ! Du même ordre que les moustiques, ces innocents pacifistes sont encore trop souvent confondus et abattus sans autres formes de procès..
🔎 Absolument inoffensifs, les chironomes ont des plumeaux au niveau des antennes. Ce sont de petits insectes qui volent à proximité des zones humides et n’ont d’autre tort que celui de ressembler aux moustiques. Espèce abondante, on retrouve leur larve dans presque tous les milieux aquatiques. Ils sont particulièrement utiles à la chaîne alimentaire pour nourrir les poissons ou les oiseaux.
Attention donc, à ne pas les condamner lorsqu’ils viennent vous chatouiller le nez. Dans la Réserve, les nuées d’insectes volants sont bien des chironomes, pas des moustiques. Au printemps comme en été, les essaims peuvent être constitués de plusieurs milliers d’individus !
POUR PLUS D’INFOS :
👉 CHIRONOMIDÉS

📚 [ORNITHO DICO]
Aujourd’hui, dans le petit glossaire du monde des oiseaux :

🖊️ Espèce parapluie
L’expression “espèce parapluie” peut s’appliquer à toutes les 𝑒𝑠𝑝𝑒̀𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑛𝑡 𝑙’ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑜𝑖𝑡 𝑒̂𝑡𝑟𝑒 𝑠𝑎𝑢𝑣𝑒𝑔𝑎𝑟𝑑𝑒́ 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑜𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒́𝑒𝑠 𝑑’𝑎𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒̀𝑐𝑒𝑠. En protégeant le domaine vital d’une espèce, on protège, plus ou moins indirectement, l’ensemble des espèces qui fréquentent le même écosystème. Chez nous, on peut considérer que la Loutre d’Europe, le Hérisson, le Castor ou encore l’Hirondelle sont des espèces parapluie.
☂️ D’après le magazine GEO, “dans l’estuaire de la Gironde, la protection de l’esturgeon a servi d’argument pour empêcher des projets d’extraction de granulat dans le fleuve. La raison ? Ce poisson se nourrit de vers évoluant dans les sédiments de la Gironde. Si ces vers venaient à disparaître, la survie de l’esturgeon serait compromise. Ainsi, la protection de l’esturgeon en a fait une espèce parapluie pour les écosystèmes cachés dans les fonds du fleuve, tout comme la protection du castor d’Europe a permis d’éviter l’artificialisation de certains écosystèmes aquatiques.”
Pour aller plus loin :
Découvrez avec l’émission Zoom Zoom Zen comment protéger les espèces parapluie ? Quelle est la différence avec « les espèces protégées » et les espèces dites « clés de voûte » ?
👉 https://bit.ly/458mUeS
UN AN DANS LA VIE D’UN OISEAU
Chaque année voit se redessiner les grandes lignes d’un récit jalonné d’événements successifs, plus ou moins communs à toutes les espèces d’oiseaux : migration, formation des couples, reproduction, élevage et envol des oisillons, mue, hivernage… Nous vous proposons de découvrir ici, mois après mois, les diverses étapes du cycle annuel des oiseaux de la Réserve !
Généralement de forme ovoïde, les œufs des oiseaux présentent des caractéristiques variables selon les espèces. Formes, couleurs, dimensions, poids… de nombreuses hypothèses ont tenté d’expliquer l’ensemble de ces particularités.
Jusqu’à récemment, on expliquait la grande diversité de formes des œufs chez les oiseaux par des divergences dans leurs cycles de vie ou par des différences dans les ressources ou les milieux dans lesquels ils établissent leurs nids. On suggérait, par exemple, que les œufs des oiseaux nichant sur les falaises avaient évolués de façon à ne pas rouler hors du nid (un œuf plus pointu tourne par exemple sur lui-même au lieu de rouler).
Depuis 2017, les résultats d’une étude réalisée par l’équipe de Mary Stoddard (Université de Princeton), indiquent que les différences de formes et de tailles des œufs seraient en réalité plus probablement liées aux aptitudes de vol de chaque espèce. 49 175 œufs de 1 400 espèces d’oiseaux ont été étudiés pour répondre à la question : l’aérodynamisme pourrait-il déterminer la forme d’un œuf ?
Les recherches ont montré que le corps des oiseaux, qui s’est adapté au fil des siècles pour mieux voler, a subi divers changements morphologiques, dont une réduction de la cavité abdominale et du tractus génital (plus particulièrement de l’isthme, la section du tractus où se forme la membrane qui entoure l’œuf). Selon les besoins d’adaptation de chaque espèce pour le vol, la cavité abdominale des oiseaux s’est plus ou moins réduite. Plus elle est devenue étroite, plus les œufs se sont affinés. Il semble donc que les oiseaux les moins adaptés au vol pondent des œufs relativement gros et sphériques, alors que les plus agiles – les espèces au corps plus léger et plus fuselé – pondent des œufs plus asymétriques, plus elliptiques.

En plus de ne pas avoir la même forme, tous les œufs n’ont pas la même couleur. Trois pigments sont à l’origine des différentes teintes : un pour les bleus, un pour les nuances de rouge à noir (sur une coquille blanche ces couleurs pourront former des nuances de jaunes ou de verts) et, chez certaines espèces, un pour la couleur rosée des coquilles d’œufs tout juste pondus.

En 2018, des chercheurs Américano-australiens ont étudié la brillance et la couleur des œufs de 634 espèces différentes. Une cartographie des résultats a permis d’établir un lien entre la couleur des œufs et leur position géographique : les œufs sont plus foncés quand la radiation solaire et les températures baissent. Les œufs des espèces qui nichent au sol et à ciel ouvert seraient ainsi plus teintés que ceux des autres oiseaux. Plus un œuf est sombre, mieux il se réchauffe au contact des rayons solaires, et plus il conserve sa chaleur.
La pigmentation a donc un grand rôle à jouer dans l’incubation des œufs. En plus de favoriser le réchauffement de l’œuf dans les milieux froids, le fait qu’elle permette de conserver une certaine chaleur permet aux parents de chercher de la nourriture plus loin ou plus longtemps.



Les œufs n’étant pas tous pondus en même temps, deux options se présentent aux oiseaux pour démarrer leur incubation. Certaines espèces commencent à couver dès la ponte du premier œuf, on parle alors d’éclosion échelonnée : les œufs n’écloront pas en même temps, tous les oisillons du nid n’auront pas le même âge, ni le même gabarit. Les rapaces, les hérons, les martinets ou encore les grèbes adoptent cette stratégie.
Chez d’autres, et notamment chez les oiseaux nidifuges comme l’Échasse blanche ou la Mouette rieuse, l’éclosion simultanée sera privilégiée. La couvaison débutera seulement à la ponte du dernier œuf de la couvée. Les oisillons qui naitront auront tous le même âge et le même gabarit (un avantage considérable pour accéder à la nourriture). Dans ce cas de figure, la femelle passe moins de temps à couver, mais ses premiers œufs seront plus longtemps exposés aux prédateurs !

Nid de Mouettes rieuses dans la Réserve Ornithologique du Teich
Observer les œufs est tentant, mais le dérangement des nids par les activités humaines est, avec la prédation et les intempéries, une des principales causes d’abandon des nichées par les parents. Si vous trouvez un nid, ne le dérangez pas !
Des espèces aux œufs discrets nichent aussi sur les plages (Gravelot à collier interrompu, Grand gravelot, Sterne naine…). Lors de vos balades printanières, veillez à tenir vos chiens en laisse et à bien rester sur les sentiers balisés.
À DECOUVRIR :
___________________
*Physiologie, rôles et fonctions de la coquille, de la forme et de la couleur des œufs :
– https://www.ornithomedia.com/pratique/debuter/oeufs-00704/
*L’influence du vol, étude de Stoddard et al. :
– https://www.science.org/doi/10.1126/science.aaj1945
– https://www.pourlascience.fr/sd/biologie-animale/pourquoi-les-oeufs-d-oiseaux-ont-ils-des-formes-si-differentes-12625.php
* La forme des œufs et les mathématiques :
– https://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/mathematiques/est-il-possible-de-decrire-mathematiquement-la-forme-de-l-oeuf_170296
*Pourquoi les œufs sont-ils de différentes couleurs ?
– https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/oiseaux/une-etude-explique-pourquoi-les-oeufs-d-oiseaux-sont-de-differentes-couleurs_138626
*Les œufs d’oiseaux et l’ultraviolet, quelques découvertes :
– https://www.ornithomedia.com/breves/oeufs-oiseaux-ultraviolet-quelques-decouvertes-02125/
*Reconnaître les œufs des oiseaux du jardin :
– https://magazine.hortus-focus.fr/blog/2020/04/30/reconnaitre-les-oeufs-des-oiseaux-des-jardins/
* « Attention ! On marche sur des œufs » :
– https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/actus-2022/plages-attention-on-marche-sur-des-aeufs
*le développement embryonnaire et la couvaison chez les oiseaux :
– https://www.ornithomedia.com/pratique/debuter/developpement-embryonnaire-couvaison-chez-oiseaux-00423/

👷♂️ La Réserve entre ce mois-ci dans une période de petits travaux.
La fin de la période de nidification et les semaines qui précèdent les grandes migrations offrent une fenêtre confortable pour réparer ou réaménager nos structures sans déranger les populations d’oiseaux. Des bruits liés aux travaux pourront donc être entendus certains jours dans cet intervalle.
La circulation du public reste possible sur l’ensemble du parcours.
Toute l’équipe vous remercie pour votre compréhension.
Nous vous tiendrons informés de l’avancée des travaux au fur et à mesure des ouvrages !
📅 À partir du mardi 18 juin 2024 :
Une partie du sentier sera temporairement fermée à la sortie de la Réserve, pour remplacement d’une passerelle et restauration de la zone au niveau de l’ancienne volière (détruite depuis plusieurs années). Ce mardi 18 juin, la passerelle à remplacer a été démontée. Le béton qui constituait les fondations de la volière ainsi qu’un petit canal est en train d’être retiré.
Le sentier de découverte reste entièrement accessible.

📅 Vendredi 21 juin 2024 :
FIN DES TRAVAUX SUR LES PASSERELLES : LA NOUVELLE PASSERELLE EST OUVERTE !

📅 Mercredi 3 juillet 2024 :
Début des réparations pour le passe-mesure endommagé par les tempêtes hivernales.
Situé entre les observatoires 8 et 9, cet ouvrage permet de maintenir le niveau d’eau du Marais centre.
Les travaux pour le remplacer n’occasionnent pas de changement de parcours pour les visiteurs.
Remise en eau de la zone « Marais Centre » dans la semaine du 19 août.




La Réserve Ornithologique du Teich et le Parc Naturel Marin du Bassin d’Arcachon participent, grâce aux pêches scientifiques réalisées chaque année par la Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de la Gironde, à l’amélioration des connaissances sur les espèces aquatiques des systèmes endigués. Une équipe de spécialistes réalise plusieurs fois par an (généralement en mai et en septembre) un inventaire des espèces présentes dans les bassins de la Réserve, composée à 70% d’eau.
Les techniciens de gestion posent des filets verveux sur différentes zones de la Réserve (voir carte ci-dessous). Ils seront relevés dès le lendemain par la Fédération de Pêche de la Gironde. Les espèces prises dans les filets sont comptées, identifiées, mesurées et pesées avant d’être relâchées à l’endroit de la capture. L’objectif est d’évaluer le peuplement en fonction des saisons, mais aussi les effets de la gestion hydraulique sur les populations des marais endiguées. Réalisé sur plusieurs années, ce suivi permet de suivre l’évolution des espèces de manière qualitative et quantitative.
En parallèle, des chaussettes sont placées au niveau de certaines écluses pour évaluer la colonisation des réservoirs d’eau par les espèces en provenance du Bassin d’Arcachon (poissons, crustacés, autres…). Un tel suivi permet, à l’échelle du Bassin d’Arcachon, de comprendre la dynamique de colonisation du site, mais aussi de définir les périodes clés d’ouverture des écluses.
Selon le dernier rapport d’étude, 3 sites du Bassin d’Arcachon présentent une diversité d’espèces particulièrement intéressante : Certes/Graveyron, le Teich et Piraillan. Au Teich comme à Certes/Graveyron, la grande superficie, les nombreuses écluses, la dynamique de l’embouchure de la Leyre et la présence d’eau à la fois douce et salée pourraient expliquer une telle diversité.



Les inventaires ont confirmé que « les réservoirs constituent un écosystème favorable aux espèces piscicoles et aux crustacés. La gestion hydraulique effectuée actuellement semble être bénéfique, puisque de nombreuses espèces en quantité parfois abondante ont pu être observées. Il semblerait que ces domaines endigués soient utilisés comme sites de recrutement et de croissance pour certaines espèces, notamment l’athérine prêtre, l’anguille d’Europe, le bar commun et le mulet porc. Ils constituent un écosystème à part entière pour des espèces qui accomplissent la totalité de leur cycle de vie dans ces domaines endigués, comme l’épinoche, le gobie commun et la gambusie orientale (espèce introduite). Plus les écluses sont maintenues ouvertes (notamment lors de gros coefficients) et plus la biomasse et la diversité des espèces dans les réservoirs est forte. »
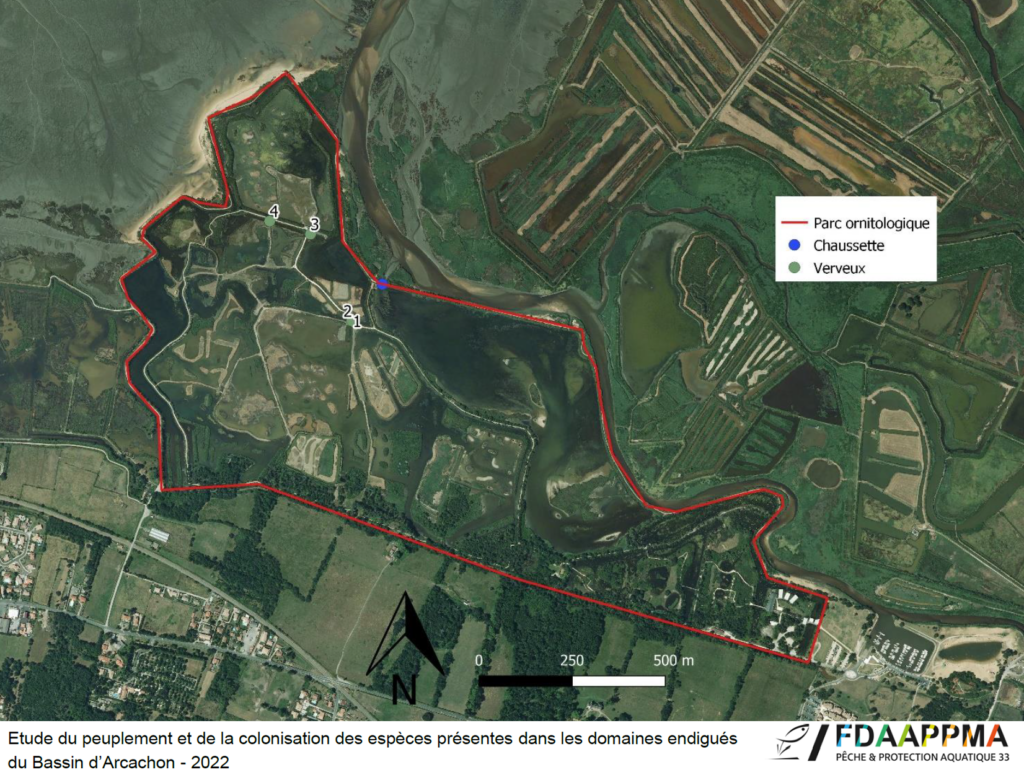
La pêche réalisée le 16 mai dernier dans la Réserve Ornithologique
a confirmé la présence de Gambusies, de nombreux Bars, d’Anguilles, de Mulets, d’Athérines,
de Gobies, de Crevettes, de Crabes et de superbes Blennies paons.
Pour aller plus loin :
Découvrez les suivis piscicoles des domaines endigués du Bassin d’Arcachon
1 AN DANS LA VIE D’UN OISEAU
Chaque année voit se redessiner les grandes lignes d’un récit jalonné d’événements successifs, plus ou moins communs à toutes les espèces d’oiseaux : migration, formation des couples, reproduction, élevage et envol des oisillons, mue, hivernage …
Nous vous proposons de découvrir ici, mois après mois, les diverses étapes du cycle annuel des oiseaux de la Réserve.
🌱 LE PRINTEMPS
A qui est ce nid ?
L’occupation des nids est bien visible dans la Réserve au printemps. En ce début du mois de mai, les Mouettes rieuses (observatoires 14 et 15) et les Échasses blanches (observatoires 2, 11 ou 12 notamment) sont occupées à couver alors que de jeunes Colverts et les premiers Cygnons ont déjà quitté leur coquille. En levant les yeux, on distingue les Milans dans les houppiers, quelques Pics autour des troncs et divers passereaux transportant tantôt des insectes, tantôt des matériaux.
Alors que certaines espèces réutilisent le même nid d’une année sur l’autre (les nids d’Hirondelles rustiques sont parfois même récupérés par des Moineaux domestiques en mal d’anfractuosités), d’autres optent pour un nid tout neuf à chaque nichée, quitte à construire plusieurs nids au cours d’une même saison. A l’inverse, certains ne prennent pas le temps de construire de nids du tout. Les faucons Hobereaux et Crécerelles peuvent, par exemple, utiliser d’anciens nids de corvidés, d’écureuils ou de pigeons. Exemple le plus connu, la femelle du Coucou gris ira pondre directement dans les nids d’autres espèces (9 en moyenne !), elle laisse aux parents des nids qu’elle parasite le soin d’élever chacun de ses petits.
La forme, les matériaux utilisés et le type de construction sont d’excellents indices pour identifier l’espèce à l’origine d’un nid. Attention toutefois à bien garder vos distances lors de la saison de reproduction : s’approcher d’un nid le rend vulnérable et la perturbation intentionnelle est un délit interdit par la loi. Pour observer les nids de plus près, mieux vaut patienter jusqu’à l’automne.
Pour construire leur nid, les oiseaux utilisent toutes sortes de matériaux : des végétaux, des poils ou des plumes (la femelle Colvert découvre sa plaque incubatrice en arrachant les fines plumes qui viendront tapisser son nid), des os, de la soie d’araignée (à la fois abondante, solide et collante), de la boue et parfois même des matières synthétiques (voir nids de Fous de Bassan). Les nids peuvent être installés partout : au sol, sur l’eau, dans des buissons, dans le feuillage, un trou ou le sommet d’un arbre, dans des terriers (les Tadornes de Belon apprécient par exemple les terriers de lapins), des galeries (le Martin-pêcheur creuse lui-même ses galeries dans les berges), sur des bâtiments ou diverses cavités.

Alors que les passereaux construisent de petits nids en coupe ou en boule garnis de matériaux et cachés dans des cavités ou dans la végétation, les non-passereaux privilégient les nids en plateforme (en général un amoncellement de végétaux) construits sur des zones supposées difficiles d’accès pour les prédateurs (dans les grands arbres, les falaises rocheuses, au sommet des bâtiments, sur l’eau…).


Chez certaines espèces, le nid peut être particulièrement rudimentaire. Les Petits Gravelots déposent par exemple leurs œufs dans un trou de sable peu profond (2-3 cm) simplement entourés de quelques galets.

Chez d’autres, l’édifice est digne des plus grands architectes. Le nid de nombreux passereaux est ainsi composé de plusieurs couches : de la mousse, des morceaux d’écorce, des lichens ou des fibres végétales à l’extérieur, des plumes et des poils doux et chauds à l’intérieur.


📚 A LIRE :
– Pourquoi et comment les oiseaux font-ils leurs nids
– Identifier les nids et les oeufs des oiseaux des villes et des jardins
– « Attention, on marche sur des œufs ! »
En migration et pendant la saison de reproduction, le plumage de certains oiseaux peut jouer des tours à bien des ornithologues !
Nous revoilà à une période de l’année où des Chevaliers arlequins pas encore tout à fait en plumage nuptial peuvent côtoyer des Chevaliers gambettes…
Savez-vous faire la différence ?
Voici quelques clés pour vous aider à les distinguer :
👉 Différencier les Chevaliers gambettes des Chevaliers arlequin
A l’occasion de la Fête de la Nature, la Réserve Ornithologique du Teich et la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon vous invitent à venir explorer les paysages du Bassin d’Arcachon en compagnie de guides naturalistes. Voguer sur La Leyre, observer les poussins, découvrir des histoires, se balader la tête en l’air ou à la recherche de petites graines… à vous de choisir !
Mercredi 22 mai de 14h à 16h30
Visite guidée gratuite de la Réserve Ornithologique
pour les enfants de 7 à 10 ans accompagnés de leur(s) parent(s)
Gratuit – Réservation obligatoire au 05 24 73 37 33
Vendredi 24 mai de 18h à 20h30
Balade contée en Canoë
Départ de la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon (à l’entrée de la Réserve Ornithologique du Teich)
26 euros/adulte – 22 euros/enfants
Réservation obligatoire au 05 24 73 37 33
maison-nature-canoe@parc-landes-de-gascogne.fr
Samedi 25 mai de 14h à 17h
Accueil posté sur les sentiers de la Réserve Ornithologique du Teich
Focus sur la nidification des oiseaux : Amélie et sa longue-vue vous attendront sur les sentiers de la Réserve pour vous faire découvrir les laridés et les limicoles qui nichent dans la Réserve au printemps.
Accès à la Réserve au tarif habituel – www.reserve-ornithologique-du-teich.com
Dimanche 26 mai de 10h à 18h
Exposition « GRAINES »
Rendez-vous à l’entrée de la Réserve Ornithologique du Teich pour découvrir les graines dans leur diversité et leur dissémination, en compagnie d’un animateur de la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon.
gratuit – sans réservation
Dimanche 26 mai de 10h à 18h
Accueil posté sur les sentiers de la Réserve Ornithologique du Teich
Focus sur la nidification des oiseaux : un spécialiste et sa longue-vue seront présents toute la journée sur les sentiers de la Réserve, pour vous faire découvrir les oiseaux qui nichent dans la Réserve au printemps.
Accès à la Réserve au tarif habituel – www.reserve-ornithologique-du-teich.com

Fragilisée par les tempêtes hivernales, la digue du Sentier du Littoral n’a pas résisté aux forts coefficients de marée engendrés sur la commune du Teich à partir du 10 février 2024 par la tempête Karlotta. D’importants travaux ont été entrepris du 19 février jusqu’au mois d’avril par le Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA).
Samedi 10 février, plusieurs zones d’érosion sur des portions du Sentier déjà fragilisées par les tempêtes successives de l’hiver et un débordement avec surverse de la Pointe jusqu’à Boucolle (du tronçon D06 au tronçon D14) ont été constatés. Seules des portions des tronçons D09 et D12 ont débordé sans surverse.
La surverse s’est poursuivie dimanche 11 février sur la totalité du linéaire entre les tronçons D06 et D14. Un débordement a également été constaté du tronçon D01 au tronçon D06. Les équipes de gestion ont relevé plusieurs points d’érosion et d’effondrement, ainsi qu’une importante brèche localisée sur des zones fragilisées par la tempête Domingo : D10 et D11.

Sur la marée du dimanche 11 au matin, les niveaux d’eau ont atteint 5,60 mètres. Coupant le Sentier sur plus de 4 mètres, la brèche s’est élargie dans les jours qui ont suivi pour atteindre les 20 mètres le mardi 13 février.

En parallèle du chantier mis en place par le SIBA, les techniciens de gestion de la Réserve Ornithologique ont adapté la gestion des niveaux d’eau des bassins aux conditions imposées par les dégâts. Plusieurs ouvrages ont été touchés, dont un passe-mesure permettant de maintenir le niveau d’eau du Marais centre, resté vide pendant une dizaine de jours. Si le niveau a pu être rehaussé, il a été maintenu plus bas que d’ordinaire pour accueillir les oiseaux migrateurs en halte et les premiers oiseaux nicheurs.
Entre le 11 et le 19 février (début des travaux), la brèche d’une vingtaine de mètres ne permettait plus la maitrise des niveaux d’eau sur la lagune Grand Large. Les marées hautes sont venues recouvrir entièrement les bancs de sable du bassin Grand Large, un des principaux reposoirs pour les oiseaux (principalement pour les limicoles qui, plus courts sur pattes que les échassiers, se reposent ou se nourrissent généralement sur les étendues d’eau ne dépassant pas la dizaine de centimètres de haut). Entièrement soumis au rythme des marées pour se remplir et se vider, le bassin Grand Large s’est retrouvé trop haut à marée haute et trop bas à marée basse. Seuls quelques individus à la recherche de nourriture sont venus s’y alimenter, suivis à marée haute par de rares Mouettes rieuses et quelques Canards.
Pour temporiser, l’équipe de gestion a reporté la fonction de reposoirs sur d’autres bassins de la Réserve. Les niveaux d’eau des unités Vasière Spatule et Lagune Quancard ont été baissés pour accueillir à marée haute les groupes de Bécasseaux variables, Avocettes élégantes, Pluviers argentés, Barges à queue noire et autres limicoles.

La brèche a pu être comblée dès le début des travaux le 19 février (recréation d’un cœur argileux avec remblai présent sur site puis consolidation par enrochement), permettant aux gestionnaires de reprendre rapidement la main sur les niveaux d’eau de l’unité Grand Large.
Un niveau bas a été maintenu sur toute la durée des travaux pour assurer le retour à la fonction de reposoir et de zone d’alimentation du bassin qui, dès fin février, a pu accueillir les oiseaux migrateurs de retour ou de passage dans la région à l’approche du printemps.
Depuis la fin des travaux en avril dernier, le niveau de l’unité Grand Large a légèrement augmenté, mais l’équipe de gestion l’a maintenu assez bas pour favoriser les haltes migratoires et l’installation d’oiseaux nicheurs tels que les Échasses blanches, qui ont donné naissance à leurs premiers poussins le 14 mai.
Les promeneurs l’auront remarqué, les travaux ont quelque peu modifié le paysage du Sentier du Littoral qui s’est élargi pour permettre le passage des engins et reste encore très ensablé. Par sécurité et pour préserver le site, il est demandé aux visiteurs de limiter leur vitesse à vélo et de veiller à bien rester sur le Sentier.

🔎 Le saviez-vous ?
La Réserve, composée au trois-quarts d’eau, est située derrière des digues. Des écluses (portes installées dans les digues) et un réseau de tuyaux permettent de gérer les niveaux d’eau des secteurs aménagés pour les oiseaux. L’équipe de gestion de la réserve actionne ces écluses. Maintenir une faible hauteur d’eau dans les lagunes et les marais favorise la présence des oiseaux. Par exemple, cela permet aux limicoles de trouver des zones découvertes ou très peu profondes pour dormir et se toiletter en toute tranquillité.
Lors de certaines marées hautes, les écluses sont ouvertes pour renouveler l’eau de la réserve. L’eau salée du bassin d’Arcachon et l’eau saumâtre (mélange d’eau douce et salée) du delta de l’Eyre entrent alors dans la Réserve. Cela amène au passage de la nourriture (poissons, larves d’insectes, plancton…) pour les oiseaux. Suite à de fortes pluies, la hauteur d’eau peut être trop élevée : le surplus d’eau est alors évacué à marée basse en ouvrant les écluses.
📚 [ORNITHO DICO]
Aujourd’hui, dans le petit glossaire du monde des oiseaux :

🖊️ RHYNCHOKINÈSE
Les oiseaux sont capables d’une prouesse : la kinésie crânienne. Ils peuvent déplacer les os et les articulations de leur crâne. On appelle “rhynchokinèse” le mécanisme qui permet à certaines espèces (Limicoles, Grues, Colibris,…) de courber leur mandibule supérieure.
Ce mouvement exceptionnel permettrait aux oiseaux de rivages de mieux chercher et manipuler leurs proies dans le substrat. Pour les migrateurs longues distances, une telle capacité offre plus de flexibilité dans la recherche de nourriture sur le trajet.
Avez-vous déjà eu la chance d’observer ce phénomène ?
On a sélectionné pour vous quelques exemples en vidéos :
👉 Barge rousse
👉 Barge rousse
👉 Bécassine des marais
👉 Bécasseau minute
Pour aller plus loin :
📰 Mieux comprendre l’évolution du crâne des oiseaux
📰 Etude : Utilisation de la rhynchokinèse distale par les oiseaux se nourrissant dans l’eau (🇬🇧)
Le Sentier du Littoral est de nouveau accessible !
Le SIBA, en partenariat avec la Ville Le Teich, vient de terminer les travaux nécessaires pour recréer, renforcer et stabiliser la digue. Ces lourds travaux changent le paysage du sentier qui s’est élargit.
Le sentier du littoral sera donc de nouveau praticable à partir du mercredi 24 avril 2024 :

ARCHIVES :
_ _ _ _ _
Cliquez-ici pour consulter l’arrêté portant fermeture temporaire du sentier.

Les forts coefficients de marée du 11 février dernier lors de la tempête Karlotta ont causé d’importants dégâts sur les digues du Sentier du littoral. Les travaux du SIBA ont commencé ce lundi 19 février.
Par sécurité et pour le bon déroulement des travaux, l’interdiction de circuler sur le sentier du littoral est maintenue jusqu’à nouvel ordre.
Quelles conséquences sur la Réserve ornithologique ?
Les techniciens de gestion sont à pied d’œuvre pour réparer les ouvrages touchés et maintenir les niveaux d’eau des bassins Grand Large et Marais centre. Les sentiers à l’intérieur de la Réserve restent praticables mais les travaux pourront causer quelques perturbations auprès des oiseaux.
𝗧𝗮𝗿𝗶𝗳 𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲 𝟱€ 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝘁𝗼𝘂𝘀 𝗹𝗲𝘀 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘁𝗲𝘂𝗿𝘀
durant la première période des travaux du mardi 20 au vendredi 23 février 2024.
Ouverture de la Réserve aux horaires et tarifs habituels à partir du 24 février 2024.
Pour une meilleure visite, prévoyez des bottes !
Découvrez la vie sauvage qui peuple la Réserve au travers d’espaces contemplatifs et des installations ludiques et pédagogiques du Sentier de découverte : une boucle d’1,5 km qui, depuis le Belvédère, offre de beaux points de vue sur le delta.
Merci à tous pour votre compréhension !
Créée en 2017 par Mary Colwell (présidente en Angleterre du Curlew Recovery Partnership), la Journée Mondiale du Courlis (World Curlew Day) célèbre le 21 avril les Courlis et les initiatives prises à travers le monde pour les protéger et conserver leurs habitats et leurs populations.

📍 En France, le Courlis cendré niche dans la moitié nord du pays (moins de 1500 couples). Dans notre région, le Bassin d’Arcachon est son principal quartier d’hivernage. Il joue un rôle de refuge climatique pour les Courlis qui s’y réfugient pendant les vagues de froid d’Europe de l’Ouest. Quasi menacés en Europe, les pays nordiques et les îles Britanniques accueillent les populations européennes les plus importantes.
🔎 Plus grand de tous les oiseaux limicoles, le Courlis cendré enfonce son long bec arqué et tactile (celui du mâle étant plus court que celui de la femelle) dans la vase pour y trouver sa nourriture. Son plumage est rayé, tacheté de gris brunâtre. Le nom de « Courlis » viendrait de son cri de contact, un sifflement sonore légèrement flûté : 👉 écouter son cri
📅 Dans la Réserve, il est possible de l’observer à partir du mois d’août, jusqu’au mois d’avril.
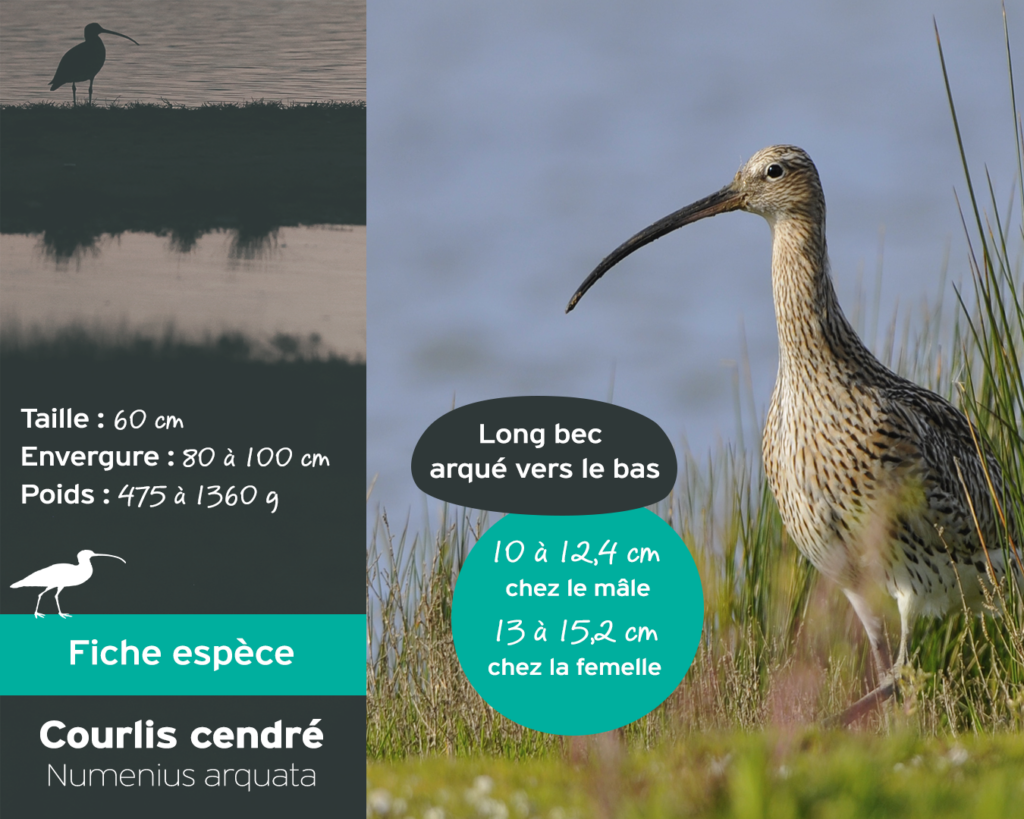
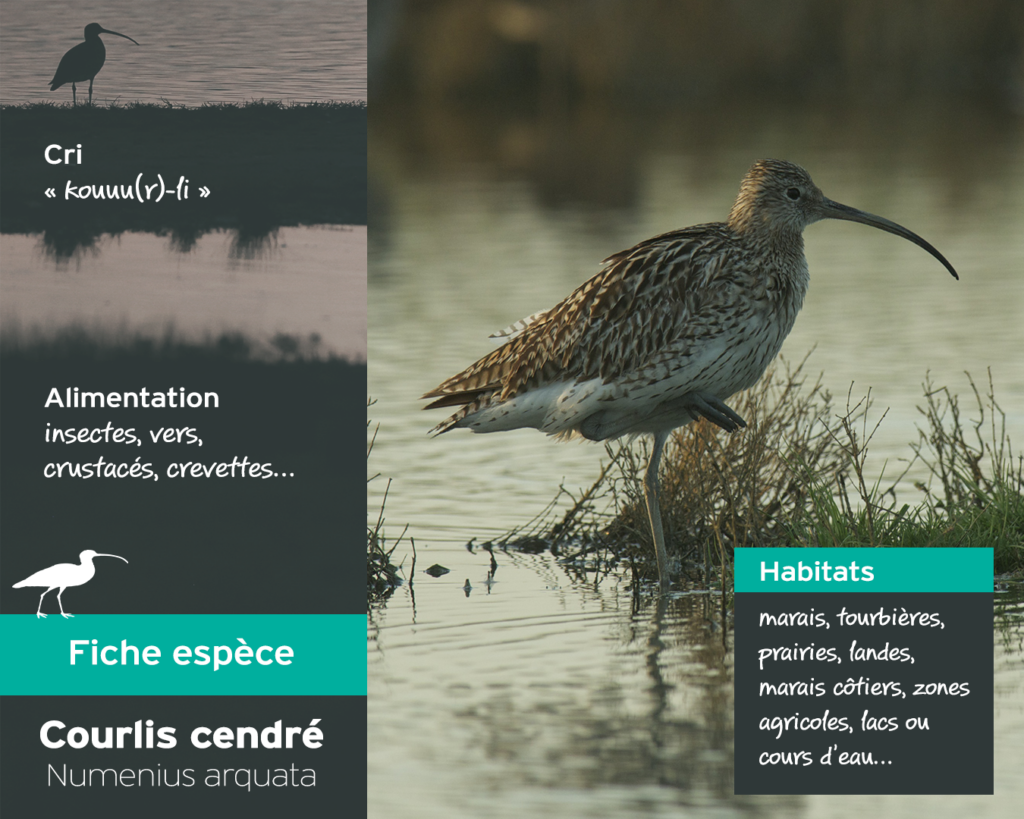
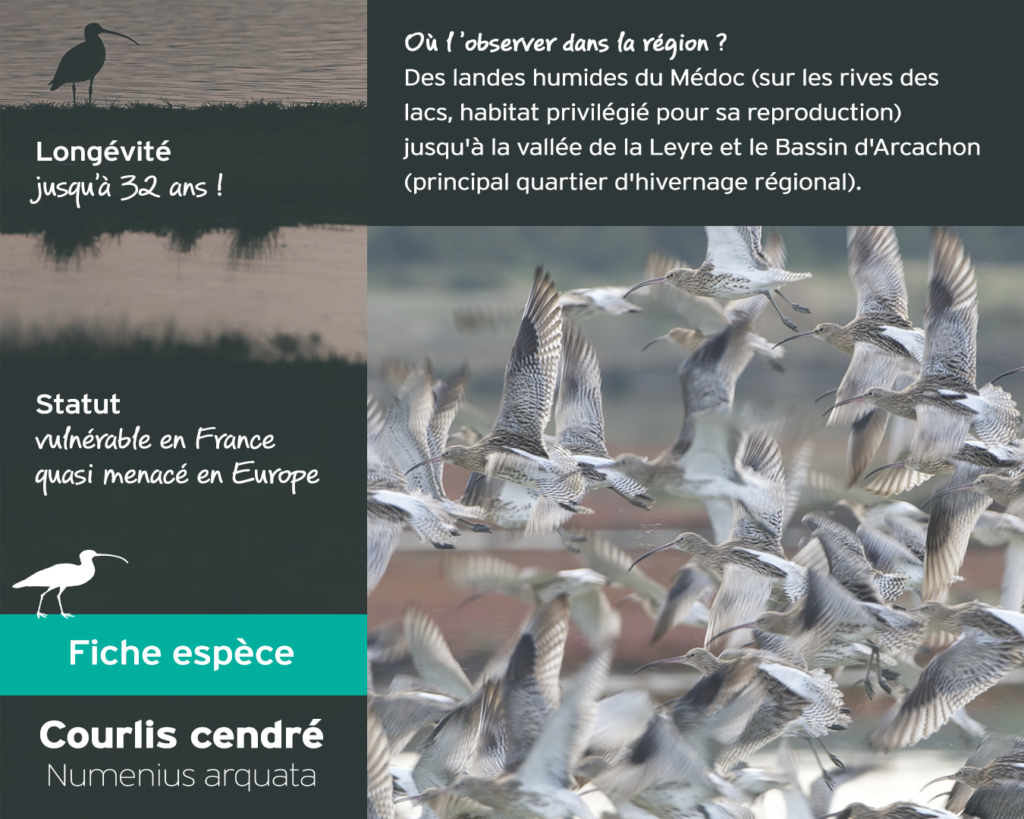
Alors que les oiseaux commencent à occuper les sites de nidifications, l’équipe de gestion de la Réserve est heureuse d’accueillir Amélie !
Après une licence Biologie-Ecologie à la Fac des Sciences de Montpellier, Amélie a passé plusieurs mois sur le terrain au CEN Occitanie. Elle renforce aujourd’hui ses connaissances naturalistes, réglementaires et techniques (méthodes d’inventaires et de suivis) avec la formation Expertise Naturaliste des Milieux (option Ecosystèmes marins), de l’école Pôle Sup Nature de Montpellier. Elle passera, dans le cadre d’un stage long, le printemps et tout l’été aux côtés des gestionnaires de la Réserve.

Sa mission ? Suivre la nidification des laro-limicoles dans la Réserve (Echasses blanches, Avocettes élégantes et Mouettes rieuses).
Comment ? En reprenant et en adaptant les protocoles passés, pour évaluer les paramètres qui influencent l’installation et le succès reproducteur de ces espèces. L’objectif cette année étant de mieux identifier et quantifier la pression prédation (par les Milans noirs, les Goélands et la Corneille notamment).
Équipée d’une paire de jumelles, de sa longue-vue et de cartes détaillées, Amélie inspecte chaque matin les nids qu’elle a répertoriés, principalement sur le Marais-Ouest, Grand-Large Est et la Lagune Avocette, mais aussi dans les boisements où nichent déjà quelques Milans.

©Amélie Garcia
Bonne chance Amélie !
Rendez-vous à la fin de l’été pour un rapport détaillé.



©Amélie Garcia
UN AN DANS LA VIE D’UN OISEAU
Chaque année voit se redessiner les grandes lignes d’un récit jalonné d’événements successifs, plus ou moins communs à toutes les espèces d’oiseaux : migration, formation des couples, reproduction, élevage et envol des oisillons, mue, hivernage…
Nous vous proposons de découvrir ici, mois après mois, les diverses étapes du cycle annuel des oiseaux de la Réserve !

🌱 LE PRINTEMPS
𝗣𝗮𝗿𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗲𝘁 𝗮𝗰𝗰𝗼𝘂𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀
Au printemps chez les oiseaux, l’heure est à la séduction. Trouver un territoire est une chose, mais encore faut-il que le lieu, ses ressources et son hôte soient à la hauteur ! Pour assurer leur descendance, les mâles adoptent au printemps des comportements de séducteurs. Chez la plupart des espèces, c’est aux femelles que revient le choix du partenaire Pour prendre leur décision, Mesdames s’appuient sur différents critères :
![]() la quantité de ressources alimentaires et la sécurité du territoire défendu par le mâle
la quantité de ressources alimentaires et la sécurité du territoire défendu par le mâle
![]() la qualité de son plumage, indicateur de bonne santé
la qualité de son plumage, indicateur de bonne santé
![]() la qualité de son chant et de ses performances
la qualité de son chant et de ses performances
![]() la capacité du mâle à fournir des offrandes (preuve par exemple que le mâle pourra contribuer au nourrissage des oisillons)
la capacité du mâle à fournir des offrandes (preuve par exemple que le mâle pourra contribuer au nourrissage des oisillons)
Chacun de ses éléments est présenté à la femelle dans une parade nuptiale visant à mettre en valeur les atouts et attributs de chaque espèce. Si le spectacle est convainquant, la femelle sollicitera l’accouplement.
Certaines espèces tendent à former un couple à vie (Cygnes tuberculés, Moineaux domestiques…). D’autres ne se retrouvent que pour quelques saisons (Merle noir, Pinson des arbres…). Il arrive aussi que les couples ne se forment que le temps d’une saison, voire même d’une nichée (Grèbe huppé, Hirondelles rustiques…). Notez que tous les oiseaux ne sont pas ou ne restent pas monogames : chez certaines espèces, le mâle a plusieurs femelles (Combattant varié, Tétras lyre…). On parle alors de Polygynie : un mâle se reproduit avec plusieurs femelles en une période de temps limitée. Chez d’autres, c’est la femelle qui a plusieurs mâles (Phalaropes, Accenteur mouchet…). Il s’agit de Polyandrie : au cours d’une saison de reproduction, la femelle s’accouple avec plusieurs mâles. La polygamie existe même chez les espèces majoritairement monogramme, il peut par exemple arriver aux mâles nicheurs de rendre visite à des femelles voisines pour augmenter leur succès reproducteur. Les œufs d’un même nid ne seront donc pas nécessairement porteurs du même patrimoine génétique !

𝗔𝘃𝗲𝘇-𝘃𝗼𝘂𝘀 𝗱é𝗷à 𝗽𝗿𝗶𝘀 𝗹𝗲 𝘁𝗲𝗺𝗽𝘀 𝗱’𝗼𝗯𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗲𝘀 𝗼𝗶𝘀𝗲𝗮𝘂𝘅 𝗮𝘂 𝗽𝗿𝗶𝗻𝘁𝗲𝗺𝗽𝘀 ?
Dans la Réserve, c’est le moment idéal pour décrypter la moindre de leurs interactions.
![]() Chez les Échasses par exemple, les disputes pour la défense d’un territoire laissent petit à petit place à des salutations empreintes de bien des élégances : les becs se croisent, les cous s’allongent, le mâle nettoie ses plumes ou fait mine de se nourrir… Ces “pas de danse” se répètent jusqu’à l’accouplement et se terminent, une fois le mâle redescendu, par un ultime rapprochement : le mâle passe une aile sur la femelle, les becs se rencontrent et, comme pour clore un rituel, chacun s’élance en courant sur un tout petit mètre.
Chez les Échasses par exemple, les disputes pour la défense d’un territoire laissent petit à petit place à des salutations empreintes de bien des élégances : les becs se croisent, les cous s’allongent, le mâle nettoie ses plumes ou fait mine de se nourrir… Ces “pas de danse” se répètent jusqu’à l’accouplement et se terminent, une fois le mâle redescendu, par un ultime rapprochement : le mâle passe une aile sur la femelle, les becs se rencontrent et, comme pour clore un rituel, chacun s’élance en courant sur un tout petit mètre.
Pour découvrir quelques exemples de parades et comportements des oiseaux au printemps, voici une petite sélection de vidéos :
Savez-vous reconnaître les bergeronnettes ?
Pour les observer dans la Réserve, prenez le temps de regarder les oiseaux perchés sur les piquets (entre les observatoires 9 et 11 par exemple) et prêtez attention aux berges de la lagune Avocette (observatoires 11 et 12). Leur vol ondulé accompagné de petits cris sont de bons indices pour les repérer !
Présence dans la Réserve : d’avril à octobre
Pour aller plus loin, apprenez à différencier les espèces qui visitent la Réserve avec ces quelques clés d’identification :
👉 LES BERGERONNETTES

📸 Erick Laucher
🐧 Suite à la détection de grippe aviaire chez des Manchots royaux, des chercheurs interrompent le suivi des colonies d’animaux de l’Antarctique. Plusieurs projets d’études ont été suspendus dans l’espoir de freiner la propagation du virus.
« C’est la première fois depuis le début de ma carrière en 1996 que l’accès aux colonies animales de l’Antarctique est aussi réduit » a déclaré le microbiologiste Antonio Quesada del Corral, qui dirige le programme espagnol de recherche sur ce continent.
Le virus de la grippe aviaire avait été détecté chez des oiseaux morts (Labbes et Goélands) sur le territoire Britannique de Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud en octobre 2023. Depuis, seuls les chercheurs spécialisés dans les maladies infectieuses et les virus ont eu accès aux colonies animales. Dans la région subantarctique, le virus s’est déjà propagé aux éléphants de mer, aux otaries à fourrure, aux albatros, sternes, manchots papous et manchots royaux…
Par précaution, les scientifiques impliqués dans les projets nécessitant de télécharger des informations à partir de capteurs situés dans les colonies de manchots, d’otaries, d’éléphants ou de léopards de mer ont cessé tous relevés. Leurs craintes se sont malgré tout confirmées le 23 février dernier, jour où le H5N1 a été détecté pour la première fois sur le continent Antarctique chez des Labbes morts à proximité de la station de recherche Primavera.
📰 Source : https://www.nature.com/articles/d41586-024-00807-0
⬇️📸 Manchots royaux, Géorgie du Sud

UN AN DANS LA VIE D’UN OISEAU
Chaque année voit se redessiner les grandes lignes d’un récit jalonné d’événements successifs, plus ou moins communs à toutes les espèces d’oiseaux : migration, formation des couples, reproduction, élevage et envol des oisillons, mue, hivernage…
Nous vous proposons de découvrir ici, mois après mois, les diverses étapes du cycle annuel des oiseaux de la Réserve !
 Rougequeue noir (femelle), par Erick Laucher
Rougequeue noir (femelle), par Erick Laucher
🌱 LE DÉBUT DU PRINTEMPS
Chants & territoires
Avez-vous remarqué que les oiseaux commencent à chanter bien avant le premier jour du printemps ?
Le chant des Mésanges bleues et des Mésanges charbonnières se fait entendre dans les jardins dès le mois de janvier, alors qu’elles se mettent à la recherche des cavités qui leur serviront de nichoir. La fin de l’hiver annonce le retour des oiseaux migrateurs : les premiers mâles commencent à s’installer sur les sites de nidification dès le mois de février. Augmentant petit à petit à partir du solstice d’hiver, c’est le taux de testostérone présent dans le sang des oiseaux qui, grâce aux récepteurs des cellules musculaires de leur syrinx, les pousse à chanter : 👉 https://bit.ly/3wszXdR
Voués à la nidification, les territoires défendus par les oiseaux au printemps peuvent être de taille variable mais doivent comprendre des lieux stratégiques : des postes de chants bien situés et des ressources suffisantes pour la survie des couples et l’élevage de leur(s) nichée(s).
Un poste de chant haut et dégagé permet à l’oiseau de chanter et de parader tout en surveillant ses congénères. Les vocalises de la fin de l’hiver/début du printemps indiquent aux autres mâles que le territoire est déjà pris. Pour les femelles, qui arrivent en général plus tard que les mâles, le chant des mâles est une invitation à partager un territoire et ses ressources pour y élever les jeunes de l’année.
Notez que chez les passereaux nicheurs, tous les mâles n’ont pas de territoire ! Les individus non-territoriaux tenteront leur chance auprès de femelles momentanément isolées. Il leur arrive aussi de récupérer les territoires abandonnés en cours de saison.
Autre surprise : encore peu étudié, le chant des femelles n’est pourtant pas si rare ! On sait aujourd’hui que chez plus de 100 espèces de passereaux européens, les femelles chantent de façon régulière. Avec une syrinx identique à celle du mâle, elles vocalisent pour diverses raisons :
👉 https://bit.ly/3SGiWEo (Ornithomedia)
👉 https://bit.ly/3uLGobh (RadioFrance)
Pour aller plus loin, nous vous donnons rendez-vous dans la Réserve le samedi 16 mars pour une journée de formation organisée par la MNBA :
“ La reproduction et les oiseaux chanteurs”
Infos et inscriptions : 👉 https://bit.ly/3Zg8S7M
Rendez-vous le mois prochain pour découvrir
ce qui occupe les oiseaux au mois d’avril !
L’occasion pour nos équipes de mettre à l’honneur les espèces qui fréquentent la Réserve :
![]() Une expo photo vous attend dans la Réserve du côté de l’observatoire numéro 3.
Une expo photo vous attend dans la Réserve du côté de l’observatoire numéro 3.








📚 Aujourd’hui, dans le petit glossaire du monde des oiseaux :
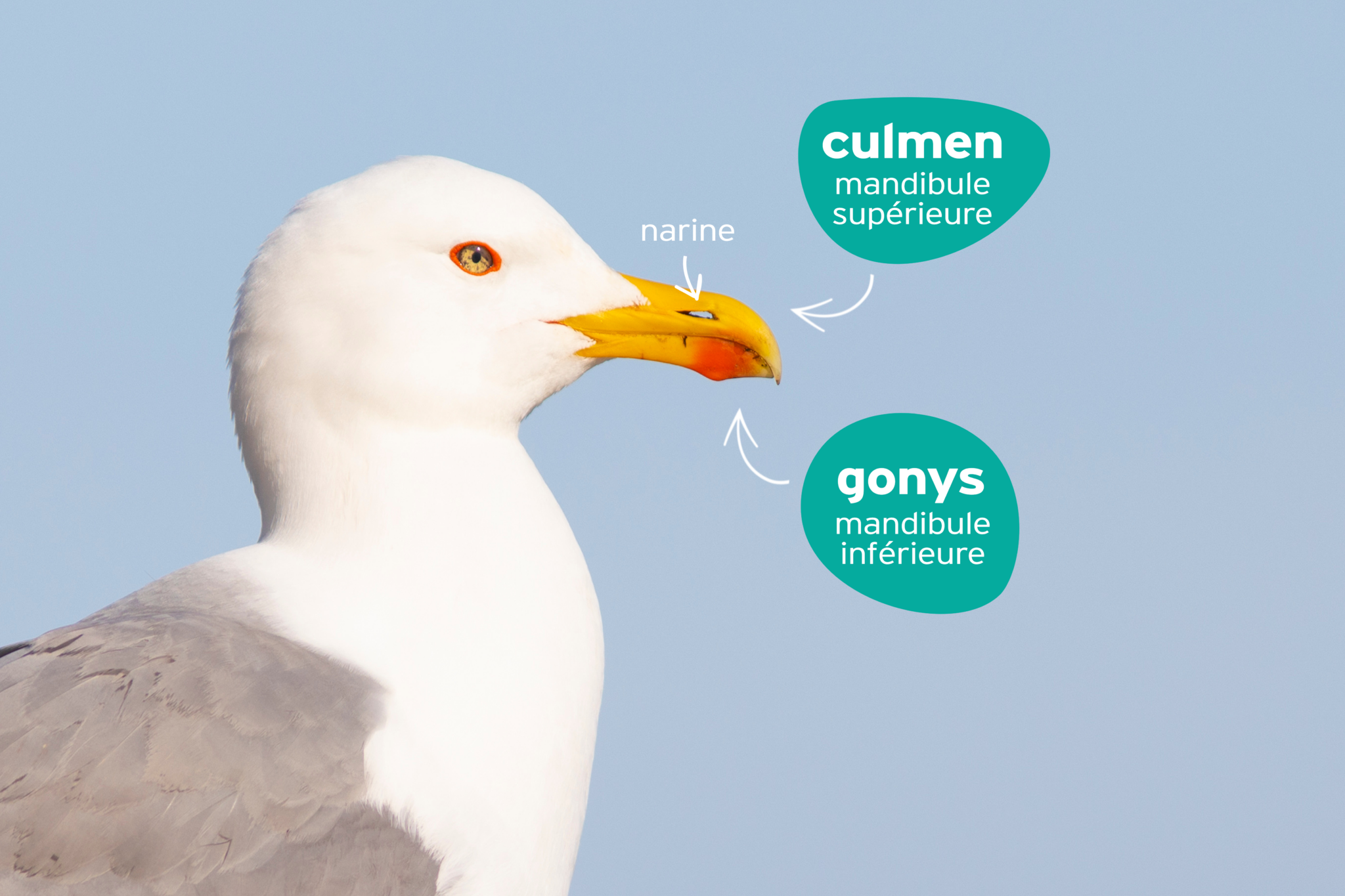
🖊️ 𝗖𝗨𝗟𝗠𝗘𝗡 ou 𝗚𝗢𝗡𝗬𝗦 ?
Vous savez très certainement distinguer sur le bec des oiseaux la mandibule supérieure de la mandibule inférieure. Mais saviez-vous que même les arêtes du bec portaient un nom ? Certaines espèces ayant des arêtes plus marquées, il peut être important d’en connaître les caractéristiques.
𝐶𝑢𝑙𝑚𝑒𝑛 est le mot utilisé pour désigner l’arête supérieure du bec. 𝐺𝑜𝑛𝑦𝑠 est l’arête inférieure. La photo ci-dessous illustre bien le fait que, chez ce Goéland, le gonys forme au niveau de la mandibule inférieure un angle particulièrement marqué, alors que le culmen est plutôt abrupt et crochu.
🔎 Et cette petite tache rouge sur le bec du Goéland ? Des études ont montré qu’elle servirait à stimuler la régurgitation de nourriture par les parents ! Dans les deux premières semaines de leur vie, les oisillons vont tapoter de leur bec cette zone rouge facilement identifiable. C’est ce réflexe instinctif qui pousse les parents à recracher pour eux la nourriture ingurgitée.
Le Festival Territoires Sauvages revient pour Pâques, à la Halle du Port du Teich !
Du 29 mars au 1er avril, des films, des conférences et des expositions en accès libre et gratuit mettront LA FORÊT à l’honneur.
Profitez du week-end de Pâques pour faire plus ample connaissance avec les trésors de la nature : balades guidées, arts vivants, ateliers, concerts, rencontres au forum des acteurs …
🕐 Ouverture des inscriptions le 1er mars 2024 !
Rendez-vous ici pour découvrir le programme : 👉 https://bit.ly/49AUmvh
🌿 Les équipes de la Réserve Ornithologique du Teich et la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon tiendront un stand sous la Halle, venez nous rencontrer !
Votre adresse e-mail est uniquement utilisée pour vous envoyer notre newsletter.
Lisez notre politique de confidentialité
REJOIGNEZ-NOUS